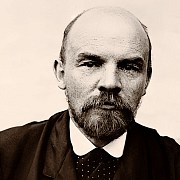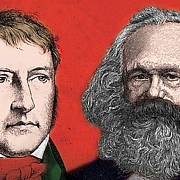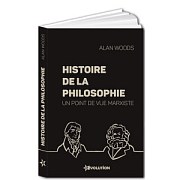Ce texte d’Alan Woods a été publié pour la première fois en juin 2013, en anglais. Nous l'avons publié sous forme de livre en vente ici : Les idées de Karl Marx
Marx est mort il y a 130 ans. Pourquoi commémorer un homme mort en 1883 ? Au début des années 1960, en Grande-Bretagne, le Premier ministre travailliste Harold Wilson nous déconseillait de chercher des solutions dans le cimetière de Highgate, où Marx est enterré. Comment ne pas être d’accord avec lui ? Dans ce cimetière, on ne peut trouver que de vieux os, de la poussière et une stèle assez laide.
Cependant, lorsque nous parlons de la pertinence de Karl Marx, aujourd’hui, nous ne faisons pas référence aux cimetières, mais aux idées – aux idées qui ont résisté à l’épreuve du temps et en sont sorties triomphantes, ce que même des ennemis du marxisme sont forcés d’admettre. L’effondrement économique de 2008 a montré qui est dépassé – et ce n’est pas Karl Marx.
Pendant des décennies, les économistes ont répété sans relâche que les prédictions de Marx sur le cycle économique étaient totalement désuètes. Elles étaient considérées comme des idées du XIXe siècle – et ceux qui les défendaient encore comme d’incurables dogmatiques. Mais il s’avère que, finalement, ce sont les idées pro-capitalistes qui doivent être reléguées dans la poubelle de l’histoire. Les idées de Marx, elles, ont été complètement validées.
Il y a quelques années, l’ex-Premier ministre britannique Gordon Brown proclamait avec assurance « la fin du cycle croissance-récession ». Après le krach de 2008, il a dû ravaler ses propres mots. La crise de l’euro montre que la bourgeoisie européenne ne sait pas comment résoudre les crises en Grèce, en Espagne et en Italie, lesquelles menacent l’avenir de la monnaie commune et de l’Union Européenne elle-même. Cela pourrait être le catalyseur d’un nouvel effondrement économique mondial – encore plus profond que la crise de 2008.
Même certains économistes bourgeois sont obligés de reconnaître ce qui devient de plus en plus évident : le capitalisme contient en lui-même les germes de sa propre destruction ; c’est un système anarchique et chaotique caractérisé par des crises périodiques qui jettent les gens au chômage et génère une grande instabilité politique et sociale.
Le fait est que la crise économique actuelle n’était pas supposée se produire. Jusqu’à récemment, la plupart des économistes bourgeois pensaient que s’il était laissé à lui-même, le marché serait capable de résoudre tous les problèmes en établissant comme par magie une péréquation entre l’offre et la demande (« l’hypothèse du marché efficient »), de sorte qu’il ne pourrait jamais y avoir de répétition du krach de 1929 et de la Grande Dépression.
Les théories de Marx sur les crises de surproduction avaient été jetées dans la poubelle de l’histoire. On considérait comme des excentriques ceux qui défendaient encore l’idée marxiste selon laquelle le système capitaliste est déchiré par d’insolubles contradictions. La chute de l’Union Soviétique n’avait-elle pas démontré la faillite du communisme ? L’histoire n’avait-elle pas abouti au triomphe final du capitalisme, désormais le seul système socio-économique possible ?
Cependant, en l’espace de 20 ans (une courte période à l’échelle de la société humaine), la roue de l’histoire a fait un demi-tour. Aujourd’hui, les anciens critiques de Marx et du marxisme chantent une toute nouvelle mélodie. Ils prennent très au sérieux la théorie économique de Marx. Un nombre croissant d’économistes étudient de près les écrits de Marx, dans l’espoir de comprendre ce qui a mal tourné.
De précieux aveux
En juillet 2009, après le début de la récession, The Economist a organisé un séminaire, à Londres, pour discuter la question suivante : « Qu’est-ce qui ne va pas dans nos théories économiques ? » Cela révélait que, pour un nombre croissant d’économistes, la théorie dominante n’avait aucune pertinence. Le Prix Nobel Paul Krugman y a fait un aveu étonnant : « ces trente dernières années, les développements de la théorie macroéconomique ont été, au mieux, spectaculairement inutiles – au pire, positivement nuisibles. » Ce jugement est une épitaphe appropriée pour les théories des économistes bourgeois.
Les événements ayant semé quelques graines de bon sens dans les têtes de certains penseurs bourgeois, nous voyons fleurir toutes sortes d’articles reconnaissant de mauvaise grâce que, finalement, Marx avait raison. Même le journal officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, a publié en 2009 un article faisant l’éloge du diagnostic de Marx sur les inégalités de revenus, ce qui revenait à approuver l’homme ayant déclaré que la religion est l’opium du peuple. Das Kapital est aujourd’hui un best-seller en Allemagne. Au Japon, il a été publié en version manga.
George Magnus, un analyste économique de la banque UBS, a écrit un article au titre intriguant : Donnons à Karl Marx une chance de sauver l’économie mondiale. La banque suisse UBS est un pilier du secteur financier, avec des bureaux dans plus de 50 pays et plus de 2000 milliards de dollars d’actifs. Déjà, dans un essai pour Bloomberg View, Magnus avait écrit que « l’économie globale, aujourd’hui, ressemble de façon troublante à ce que Marx avait anticipé. »
Dans son article, il décrit des décideurs politiques « luttant pour comprendre le déferlement de panique financière, de manifestations et d’autres maux affligeant le monde » – et suggère qu’ils feraient bien d’étudier les travaux d’un « économiste mort il y a longtemps, Karl Marx. » Il écrit : « Considérez, par exemple, la prédiction de Marx concernant la manière dont se manifesterait le conflit entre capital et travail. Comme il l’a écrit dans Das Kapital, la course au profit et à la productivité des entreprises les mène naturellement à avoir de moins en moins besoin de travailleurs, ce qui crée une ʺarmée industrielle de réserveʺ de pauvres et de chômeurs : ʺl’accumulation de la richesse à un pôle est, par conséquent, en même temps l’accumulation de la misère à l’autre pôle.ʺ (Marx) »
Magnus poursuit : « Le processus qu’il [Marx] décrit est visible à travers le monde développé, particulièrement dans les efforts des compagnies américaines pour réduire les coûts et éviter d’embaucher, ce qui a fait monter la part des profits des entreprises américaines dans la production globale à son plus haut niveau depuis au moins 60 ans, pendant que le taux de chômage reste à 9,1 % et que les salaires stagnent.
« Pendant ce temps, les inégalités de revenus aux États-Unis sont, selon certains indicateurs, proches de leur plus haut niveau depuis les années 1920. Avant 2008, les disparités de revenus étaient atténuées par des facteurs comme le crédit facile, qui permettait aux ménages pauvres de jouir d’un niveau de vie plus prospère. Mais à présent ce problème d’inégalités revient en force. »
Le Wall Street Journal a réalisé une interview avec un économiste bien connu, le Dr Nouriel Roubini, surnommé par ses confrères « Dr Doom » suite à son anticipation de la crise financière de 2008. Il existe une vidéo de cette interview extraordinaire ; elle mérite d’être étudiée avec attention, car elle révèle ce que pensent les stratèges du Capital les plus intelligents. Roubini y explique que la chaîne du crédit est brisée et que le capitalisme est entré dans un cercle vicieux : la « surcapacité » (surproduction), la baisse de la demande et les hauts niveaux d’endettement engendrent un manque de confiance des investisseurs, ce qui va se traduire par une chute des bourses, du prix des actifs et finalement de l’économie réelle.
Comme tous les autres économistes bourgeois, Roubini n’a aucune solution réelle à la crise actuelle. Il défend juste de nouvelles injections monétaires des banques centrales pour éviter une autre débâcle. Mais il admet franchement qu’à elle seule, la politique monétaire ne sera pas suffisante, d’autant que les gouvernements et les entreprises n’aident pas. L’Europe et les États-Unis mettent en œuvre des programmes d’austérité pour essayer de résorber leurs dettes publiques massives – alors qu’ils devraient davantage recourir à une politique de relance monétaire, explique Roubini. Ses conclusions ne sauraient être plus pessimistes : « Marx avait vu juste : à un certain point, le capitalisme peut se détruire lui-même. […] Nous pensions que les marchés fonctionnaient. Ils ne fonctionnent pas. » (Nous soulignons)
Le fantôme du marxisme continue de hanter la bourgeoisie 130 ans après la mort de Marx. Mais qu’est-ce que le marxisme ? Il est impossible d’aborder correctement tous les aspects du marxisme dans l’espace d’un seul article. Nous nous limiterons donc à une explication générale, forcément sommaire, dans l’espoir que cela encouragera nos lecteurs à étudier les œuvres de Marx. Après tout, personne n’a jamais mieux exposé les idées de Marx que Marx lui-même.
De façon générale, ses idées peuvent être divisées en trois parties distinctes, bien qu’intimement liées entre elles. Lénine les désignait comme les trois parties constitutives du marxisme : la théorie économique, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Chacune a une relation dialectique avec les autres ; elles ne peuvent être comprises isolément. Le document fondateur de notre mouvement, écrit à la veille des révolutions européennes de 1848, est un bon point de départ. C’est l’une des œuvres les plus importantes et les plus influentes de l’histoire.
Le Manifeste du Parti communiste
L’immense majorité des livres écrits il y a un siècle et demi n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. Mais ce qui est le plus frappant avec le Manifeste du Parti communiste, c’est la manière dont il anticipait les phénomènes contemporains les plus fondamentaux, qui occupent aujourd’hui notre attention à l’échelle mondiale. Il est extraordinaire de voir à quel point ce livre écrit en 1847 présente une image vivante et fidèle du monde au XXIe siècle. En fait, le Manifeste est encore plus actuel aujourd’hui que lorsqu’il parut pour la première fois, en 1848.
Prenons un exemple. A l’époque de Marx et Engels, un monde dominé par de grandes entreprises multinationales n’était qu’une vision d’un futur très lointain. Malgré cela, ils expliquaient comment la libre entreprise et la compétition mèneraient inévitablement à la concentration du capital et à la monopolisation des forces productives. Il est franchement comique de lire les déclarations des apologues du marché concernant l’erreur présumée de Marx sur cette question, lorsqu’en réalité c’était l’une de ses prédictions les plus brillantes et précises.
Dans les années 1980, il était à la mode de déclarer que « ce qui est petit est beau » (« small is beautiful »). Il n’est pas question d’entrer ici dans une discussion concernant les mérites comparés du grand, du petit ou du moyen, au sujet desquels chacun a le droit d’avoir son opinion. Mais il est absolument incontestable que le processus de concentration du capital anticipé par Marx s’est produit, se produit encore et a atteint des niveaux sans précédent au cours des dix dernières années.
Aux États-Unis, où l’on peut observer ce processus de façon particulièrement claire, les 500 plus grandes entreprises américaines représentaient 73,5 % du PIB du pays en 2010. Si ces 500 compagnies formaient un pays indépendant, il serait la deuxième plus grande économie au monde, derrière les États-Unis eux-mêmes. En 2011, ces 500 firmes ont généré un profit record de 824,5 milliards de dollars, soit 16 % de plus qu’en 2010. A l’échelle mondiale, les 2000 plus grandes compagnies représentent 32 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 2400 milliards de profit, 138 000 milliards d’actifs et 38 000 milliards de valeurs marchandes. Leurs profits ont augmenté de 67 % entre 2010 et 2011 !
Lorsque Marx et Engels écrivaient le Manifeste, il n’y avait aucune preuve empirique de leurs affirmations. Au contraire, le capitalisme de leur époque reposait entièrement sur la petite entreprise, le libre marché et la concurrence. Aujourd’hui, l’économie du monde capitaliste tout entier est dominée par une poignée de monopoles transnationaux tels que Walmart et Exxon. Ces mastodontes possèdent des fonds qui excèdent les budgets nationaux de bien des pays. Les prédictions du Manifeste se sont réalisées à un point que Marx lui-même ne pouvait imaginer.
Les défenseurs du capitalisme ne pardonnent pas à Marx d’avoir été capable, à l’époque de la vigueur juvénile de ce système, d’anticiper les causes de sa dégénérescence sénile. Pendant des décennies, ils ont nié avec acharnement sa prédiction d’un processus inévitable de concentration du capital et de remplacement des petites entreprises par des grands monopoles.
Le processus de centralisation et de concentration du capital a atteint des proportions dantesques. Les rachats d’entreprises ont pris le caractère d’une épidémie dans toutes les nations industrielles avancées. Dans beaucoup de cas, ces rachats sont intimement liés à toutes sortes de pratiques véreuses : délits d’initiés, falsification des cours et autres types de fraudes, larcins et escroqueries. Cette concentration du capital ne signifie pas une croissance de la production, mais très exactement le contraire. Dans chaque cas, l’intention n’est pas d’investir dans une nouvelle usine ou une nouvelle machine, mais de fermer des usines et des bureaux, donc de licencier un grand nombre de travailleurs – le tout dans le but d’augmenter les marges de profits sans augmenter la production. Par exemple, la récente fusion de deux grosses banques suisses a débouché sur la suppression de 13 000 emplois.
Mondialisation et inégalités
Poursuivons avec une autre prédiction importante de Marx. Dès 1847, il expliquait que le développement du marché mondial rend « impossible toute étroitesse et tout individualisme national. Chaque pays – même le plus grand et le plus puissant – est maintenant totalement subordonné à l’ensemble de l’économie mondiale, qui décide du sort des peuples et des nations ». Cette brillante anticipation théorique suffit à souligner la supériorité de la méthode marxiste.
La mondialisation est généralement considérée comme un phénomène récent. Pourtant, la création d’un seul marché global, sous le capitalisme, a été anticipée dans les pages du Manifeste. L’écrasante domination du marché mondial est désormais le fait le plus évident de notre époque. L’énorme intensification de la division internationale du travail, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a démontré l’exactitude des idées de Marx d’une façon quasi expérimentale.
Malgré cela, des efforts opiniâtres ont été faits pour prouver que Marx avait tort quand il parlait de la concentration du Capital – et donc du processus de polarisation entre les classes. Cet acharnement répond aux rêves de la bourgeoisie de revenir à l’âge d’or de la libre entreprise, tout comme un vieil homme décrépit se languit des jours perdus de sa jeunesse.
Malheureusement pour lui, le capitalisme n’a pas la moindre chance de retrouver sa vigueur juvénile. Il est entré depuis longtemps dans sa phase finale : celle du capitalisme monopolistique. Malgré la nostalgie de la bourgeoisie, l’époque de la domination des petites entreprises ne reviendra pas. Dans tous les pays, les grands monopoles, étroitement liés aux banques et à l’État bourgeois, dominent la vie de la société. La polarisation entre les classes se poursuit – et tend même à s’accélérer.
Prenons la situation aux États-Unis. Les 400 familles les plus riches y ont autant de richesses que les 50 % les plus pauvres. Les six individus héritiers de Walmart « valent » à eux seuls plus que 30 % des Américains (les plus pauvres). La moitié la plus pauvre des Américains ne détient que 2,5 % des richesses du pays. Les 1 % les plus riches ont vu leur part du revenu national passer de 17,6 % en 1978 à 37,1 % en 2011.
Au cours des 30 dernières années, le fossé entre les revenus des riches et des pauvres n’a cessé de s’élargir, jusqu’à devenir un gouffre béant. Dans l’Ouest industrialisé, le revenu moyen des 10 % les plus riches est près de 9 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres. C’est une différence énorme. Et les chiffres publiés par l’OCDE montrent que ce phénomène, qui a commencé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, s’est répandu à des pays tels que le Danemark, l’Allemagne et la Suède, où les inégalités étaient traditionnellement faibles.
La richesse obscène des banquiers est un scandale public. Mais ce phénomène n’est pas confiné au secteur financier. Des dirigeants de grandes compagnies gagnent 200 fois plus que leurs employés les moins bien payés. Cette différence extrême est la source d’un ressentiment grandissant, qui se transforme en fureur et déborde dans les rues d’un pays après l’autre. La tension croissante s’exprime par des grèves, des grèves générales, des manifestations et des émeutes. Au plan électoral, elle se reflète dans des votes de protestation contre les gouvernements et tous les partis traditionnels, comme nous l’avons vu récemment lors des élections générales italiennes.
Un sondage du magazine Time montrait que 54 % des sondés ont une opinion favorable du mouvement Occupy Wall Street. 79 % pensent que le fossé entre riches et pauvres est devenu trop grand. 71 % pensent que les PDG des institutions financières devraient être poursuivis en justice. 68 % pensent que les riches devraient payer plus d’impôts. Seuls 27 % ont une opinion favorable du mouvement réactionnaire Tea Party. Bien sûr, il est trop tôt pour parler d’une révolution aux États-Unis. Mais il est clair que la crise du capitalisme engendre un sentiment critique grandissant dans de larges couches de la population. Il y a une effervescence et une remise en cause du capitalisme qui n’existaient pas auparavant.
Le fléau du chômage
Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx écrivait : « Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d’imposer à la société, comme loi régulatrice, les conditions d’existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, parce qu’elle est incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu’elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination… »
Ces mots de Marx et Engels sont devenus littéralement vrais. Il existe un sentiment grandissant, dans toute la société : nos vies sont dominées par des forces indépendantes de notre volonté. La société est rongée par un sentiment de peur et d’incertitude.
Le type de chômage de masse auquel nous faisons face, aujourd’hui, est bien pire que tout ce que Marx avait anticipé. Il parlait d’une « armée industrielle de réserve », c’est-à-dire d’« un groupe de travailleurs qui peut être utilisé pour maintenir les salaires à un bas niveau et agir comme une réserve lorsque l’économie se remet d’une récession. » Mais le type de chômage que nous voyons aujourd’hui n’est pas « l’armée de réserve » dont parlait Marx – et qui jouait un rôle utile d’un point de vue capitaliste. Ce n’est pas le type de chômage cyclique d’autrefois, qui augmentait lors d’une récession pour ensuite disparaître lorsque l’économie redémarrait. C’est un chômage permanent, structurel, organique, qui ne diminue même pas nettement lorsqu’il y a un « boom » économique. C’est un poids mort qui agit comme un frein colossal sur l’activité productive, un symptôme du fait que le système est dans une impasse.
Selon l’ONU, dix ans avant la crise de 2008, il y avait environ 120 millions de chômeurs dans le monde. En 2009, l’Organisation Internationale du Travail avançait le chiffre de 198 millions – et s’attendait à ce qu’il atteigne 202 millions en 2013. Cependant, même ces chiffres, comme toutes les statistiques officielles du chômage, sont une sous-estimation grossière de la situation réelle. Si nous incluons le nombre très important d’hommes et de femmes qui sont obligés de se contenter de toutes sortes de « jobs » précaires (notamment dans le « secteur informel »), le chiffre réel du chômage et du sous-emploi, au niveau mondial, s’élève à plus d’un milliard.
Malgré tous les discours sur « la reprise », la croissance économique en Allemagne – cette « locomotive » de l’économie européenne – est proche de zéro, tout comme la croissance en France. Au Japon aussi l’économie freine des quatre fers. Abstraction faite de la misère et des souffrances causées à des millions de familles, cela représente, d’un point de vue économique, un gaspillage colossal. Contrairement aux illusions passées des dirigeants ouvriers, le chômage de masse se répand dans le monde entier comme un cancer rongeant les entrailles de la société.
La crise du capitalisme frappe particulièrement les jeunes. Le chômage des jeunes s’envole partout. C’est la raison des manifestations et des émeutes en Grande-Bretagne, du mouvement des Indignados en Espagne, des occupations des écoles en Grèce et aussi des soulèvements en Tunisie et en Égypte (en 2011), où environ 75 % des jeunes sont sans emploi.
Le nombre de chômeurs en Europe est en constante augmentation. Le chiffre pour l’Espagne est de presque 27 % dans toute la population – et de 55 % dans la jeunesse. En Grèce, pas moins de 62 % des jeunes sont sans emploi. Toute une génération de jeunes est sacrifiée sur l’autel du profit. Beaucoup de ceux qui cherchaient un salut dans l’enseignement supérieur se retrouvent dans une voie sans issue. En Grande-Bretagne, où par le passé l’enseignement supérieur était gratuit, les jeunes doivent désormais s’endetter lourdement pour acquérir les compétences dont ils ont besoin.
A l’autre bout de l’échelle des âges, les travailleurs approchant la retraite doivent travailler plus longtemps et cotiser davantage pour toucher des pensions de misère. Jeunes ou vieux, la perspective à laquelle font face la plupart des gens est une vie d’insécurité. Toute la vieille hypocrisie bourgeoise sur la morale et les « valeurs familiales » est démasquée. L’épidémie de chômage, la pénurie de logements, l’endettement des ménages et les inégalités sociales extrêmes ont transformé toute une génération en parias, ont miné la famille et ont créé un enfer de pauvreté systémique, d’humiliation et de désespoir.
Une crise de surproduction
Dans la mythologie grecque, il existe un personnage nommé Procuste, qui avait la mauvaise habitude de couper les jambes, la tête et les bras de ses invités pour les adapter à la petite taille de son lit. De nos jours, le système capitaliste ressemble au lit de Procuste. La bourgeoisie détruit systématiquement les moyens de production pour les faire entrer dans les étroites limites du système capitaliste. Ce vandalisme économique ressemble à une politique de la terre brûlée à grande échelle.
George Soros compare ce phénomène aux énormes boules utilisées pour démolir les grands bâtiments. Mais ce ne sont pas que des bâtiments qui sont détruits ; ce sont des économies et des États entiers. La devise du moment est l’austérité, les coupes budgétaires et la chute des niveaux de vie. Dans chaque pays, la bourgeoisie pousse le même cri de guerre : « Nous devons couper les dépenses publiques ! » Chaque gouvernement capitaliste, qu’il soit de droite ou « de gauche », poursuit au fond la même politique. Ce n’est pas le résultat de caprices individuels de politiciens, de l’ignorance ou de la mauvaise foi (bien qu’il y en ait aussi beaucoup), mais une conséquence de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste.
C’est un symptôme du fait que le système capitaliste atteint ses limites ; il est incapable de développer les forces productives comme par le passé. Comme l’Apprenti Sorcier de Goethe, il a fait surgir des forces qu’il ne peut pas contrôler. Mais en coupant dans les dépenses d’État, les politiciens minent la demande et asphyxient l’ensemble du marché – juste au moment où même des économistes bourgeois admettent qu’il y a un sérieux problème de surproduction (« surcapacité ») à l’échelle mondiale.
Prenons l’exemple du secteur automobile. Il est fondamental parce qu’il implique bien d’autres secteurs, comme l’acier, le plastique, la chimie et l’électronique. La surcapacité mondiale de l’industrie automobile est approximativement de 30 %. Cela signifie que Ford, General Motors, Fiat, Renault, Toyota et tous les autres devraient fermer un tiers de leurs usines et licencier un tiers de leurs travailleurs pour être capables de vendre tous les véhicules produits et en retirer ce qu’ils considèrent comme un taux de profit acceptable. Une situation similaire existe dans beaucoup d’autres secteurs. Tant que ce problème de surcapacité ne sera pas résolu, la crise actuelle ne sera pas véritablement terminée.
Le dilemme des capitalistes peut être assez simplement résumé. Si l’Europe et les États-Unis ne consomment pas, la Chine ne peut pas produire. Si la Chine ne produit pas au même rythme qu’avant, des pays comme le Brésil, l’Argentine et l’Australie ne peuvent pas continuer à exporter autant de matières premières en Chine. Le monde entier est étroitement interconnecté. La crise de l’euro affectera l’économie américaine, qui est dans un état très fragile, et ce qui arrive aux États-Unis aura un effet décisif sur l’économie mondiale tout entière. Ainsi, la mondialisation se manifeste comme une crise mondiale du capitalisme.
Aliénation
Avec une incroyable sagacité, les auteurs du Manifeste ont anticipé les conditions auxquelles les classes ouvrières de tous les pays font face, désormais : « Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de l’ouvrier tout caractère d’autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un simple accessoire de la machine, on n’exige de lui que l’opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que coûte l’ouvrier se réduit, à peu de chose près, au coût de ce qu’il lui faut pour s’entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix du travail, comme celui de toute marchandise, est égal à son coût de production. Donc, plus le travail devient répugnant, plus les salaires baissent. Bien plus, la somme de labeur s’accroît avec le développement du machinisme et de la division du travail, soit par l’augmentation des heures ouvrables, soit par l’augmentation du travail exigé dans un temps donné, l’accélération du mouvement des machines, etc. ».
Aujourd’hui, les États-Unis occupent la même position que la Grande-Bretagne du vivant de Marx : celle du pays capitaliste le plus développé. Les tendances générales du capitalisme s’y expriment dans leurs formes les plus claires. Sur les trente dernières années, les rémunérations des PDG aux États-Unis ont augmenté de 725 %, alors que les salaires des travailleurs n’ont augmenté que de 5,7 %. Ces PDG gagnent en moyenne 244 fois plus que leurs employés. Le salaire minimum fédéral actuel est de 7,25 dollars de l’heure. D’après le Centre de Recherche de Politique Économique, si le salaire minimum avait suivi l’évolution de la productivité des travailleurs, il aurait atteint 21,72 dollars de l’heure. En tenant compte de l’inflation, le salaire médian des hommes américains est plus bas aujourd’hui qu’il ne l’était en 1968. En ce sens, la dernière phase de croissance s’est réalisée en grande partie au détriment de la classe ouvrière.
Pendant que des millions traînent une existence misérable d’inactivité forcée, des millions d’autres sont obligés d’avoir deux ou trois emplois. Ils travaillent souvent 60 heures ou plus par semaine, sans heures supplémentaires majorées. 85,8 % des hommes et 66,5 % des femmes travaillent plus de 40 heures par semaine. D’après l’Organisation Internationale du Travail, « les Américains travaillent 137 heures par an de plus que les Japonais, 260 heures par an de plus que les Britanniques et 499 heures par an de plus que les Français ».
D’après les données du Bureau des Statistiques du Travail des États-Unis, la productivité moyenne par travailleur américain a augmenté de 400 % depuis 1950. En théorie, cela veut dire que pour atteindre le même niveau de vie, un travailleur ne devrait avoir à travailler qu’un quart de la semaine moyenne de 1950, soit 11 heures par semaine. Ou alors le niveau de vie, en théorie, devrait avoir été multiplié par quatre. Or au contraire, le niveau de vie de la majorité a beaucoup baissé, cependant que le stress, les accidents et les maladies liés au travail augmentent. Cela se concrétise par une épidémie de dépressions, de suicides, de divorces, d’abus d’enfants et de conjoints, de fusillades de masse, etc.
La même situation existe en Grande-Bretagne où, sous le gouvernement Thatcher, 2,5 millions d’emplois ont été détruits dans l’industrie, alors que la production industrielle a conservé le même niveau qu’en 1979. Cela a été accompli non par l’introduction de nouvelles machines, mais par la surexploitation des travailleurs britanniques. En 1995, Kenneth Calman, alors Directeur Général de la Santé, soulignait que « le développement du travail précaire a déchaîné une épidémie de maladies liées au stress ».
La lutte des classes
Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels expliquaient que l’histoire de l’humanité – ou du moins l’histoire transmise par des textes – est marquée par un facteur central : le développement social prend place à travers une lutte des classes. Sous le capitalisme, celle-ci a été grandement simplifiée par la polarisation de la société en deux grandes classes antagonistes, la bourgeoisie et la classe ouvrière (le salariat). L’énorme développement de l’industrie et de la technologie au cours des deux derniers siècles a mené à la concentration croissante du pouvoir économique dans les mains de quelques-uns.
« L’histoire de toutes les sociétés jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes », dit le Manifeste dans une de ses phrases les plus célèbres. Ces dernières décennies, beaucoup de gens ont pensé que cette idée était dépassée, caduque. Au cours de la longue période d’expansion capitaliste qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, les économies industrielles les plus avancées connaissaient le plein emploi, des réformes progressistes (l’« État Providence ») et une augmentation des niveaux de vie. Dès lors, la lutte des classes semblait n’être plus qu’un vieux souvenir.
Marx a prédit que le développement du capitalisme mènerait inexorablement à la concentration du capital, à une immense accumulation de richesses au sommet de la société – et à une accumulation de pauvreté, de misère et d’exploitation à sa base. Pendant des décennies, cette idée a été rejetée par les économistes et les sociologues bourgeois, qui affirmaient que la société devenait toujours plus égalitaire, que tout un chacun devenait membre de la classe moyenne. Toutes ces illusions sont désormais balayées.
L’argument, tellement apprécié des sociologues bourgeois, selon lequel la classe ouvrière a cessé d’exister, a été complètement démoli. Dans la dernière période, d’importantes couches des travailleurs qui se considéraient comme appartenant à la classe moyenne ont été prolétarisées. Des enseignants, des fonctionnaires, des employés de banque, etc., ont été précipités dans les rangs de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, où ils constituent quelques-unes de ses sections les plus militantes.
Les événements ont invalidé le vieil argument selon lequel tout le monde peut progresser dans l’échelle sociale. En Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans bien d’autres pays développés, c’est exactement le contraire qui s’est produit au cours des 30 dernières années. Les classes moyennes pensaient que la vie consistait en une succession d’étapes dont chacune marquait un progrès sur la précédente. Ce n’est plus le cas.
La sécurité de l’emploi a cessé d’exister, beaucoup de professions du passé ont disparu et l’emploi à vie n’est plus la règle, mais l’exception. Les barreaux de l’échelle sociale ont été brisés ; la plupart des gens ne peuvent plus espérer accéder aux conditions de vie de la classe moyenne. Seule une minorité de la population peut espérer une retraite permettant de vivre confortablement. De moins en moins de gens ont une épargne significative. De plus en plus de personnes vivent au jour le jour, sans savoir ce que leur réserve l’avenir.
Bien des gens ont leur logement pour seule richesse, mais avec la contraction de l’économie, les prix des logements ont chuté dans beaucoup de pays et peuvent encore stagner pendant des années. L’idée d’une « démocratie de propriétaires » s’est révélée n’être qu’un mirage. Loin d’être un avantage pour vivre une retraite confortable, la propriété d’une maison est devenue un lourd fardeau. Les prêts immobiliers doivent être payés, que l’on travaille ou pas. Beaucoup sont piégés par la dévaluation de leur bien immobilier, sans pouvoir payer les énormes dettes contractées pour les acquérir. Il y a une génération croissante de ce que l’on peut décrire comme des esclaves de la dette.
C’est une accablante condamnation du système capitaliste. Cependant, ce processus de prolétarisation a eu pour conséquence de réduire énormément les réserves sociales de la réaction. Une grande partie des « cols blancs » se rapprochent désormais de la classe ouvrière traditionnelle. Dans les récentes mobilisations de masse, des sections de la population qui, par le passé, n’auraient jamais songé à faire grève ou à se syndiquer, étaient en première ligne sur le front de la lutte des classes.
Idéalisme ou matérialisme ?
La méthode de pensée idéaliste se base sur ce que les gens pensent et disent d’eux-mêmes. Mais comme l’expliquait Marx, les idées ne tombent pas du ciel : elles reflètent plus ou moins précisément des situations objectives, des pressions sociales et des contradictions qui échappent au contrôle des hommes et des femmes. L’histoire n’est pas le résultat de la libre volonté ou du désir conscient des « grands hommes », rois, politiciens ou philosophes. La force motrice de l’histoire est le développement des forces productives, lequel n’est pas le produit d’une planification consciente, mais se développe dans le dos des hommes et des femmes.
Marx a été le premier à placer le socialisme sur de solides bases théoriques. Une compréhension scientifique de l’histoire ne doit pas reposer sur les images déformées de la réalité telles qu’elles existent, spectres pâles et fantastiques, dans les esprits des hommes et des femmes, mais sur les rapports sociaux réels. Il faut commencer par clarifier les rapports entre, d’une part, les formes sociales et politiques, et d’autre part le mode de production à une étape donnée de l’histoire. Cette méthode d’analyse, c’est précisément le matérialisme historique.
Certaines personnes seront irritées par cette théorie, qui semble priver l’homme d’un rôle actif dans le processus historique. De la même manière, l’Église et ses apologistes étaient profondément offensés par l’affirmation de Galilée selon laquelle c’était le soleil, et non la terre, qui était au centre de l’univers. Plus tard, Darwin a subi le même type de critiques pour avoir suggéré que les humains n’étaient pas une création spéciale de Dieu, mais le produit de la sélection naturelle.
En fait, le marxisme ne nie pas du tout l’importance du « facteur subjectif » – de l’activité consciente des hommes – dans le développement historique. Comme l’écrivaient Marx et Engels : « l’histoire ne fait rien, elle “ne possède pas de richesse énorme”, elle “ne livre pas de combats”. C’est au contraire l’homme, l’homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats ; ce n’est pas l’“histoire” qui se sert de l’homme comme moyen pour réaliser – comme si elle était une personne à part – ses fins à elle ; elle n’est que l’activité de l’homme qui poursuit ses fins à lui. » (Marx et Engels, La Sainte Famille, chapitre VI). Oui, les hommes et les femmes font l’histoire. Mais ils ne la font pas seulement suivant leur libre volonté et leurs intentions conscientes.
Le marxisme explique que l’individu fait partie d’une société donnée, qu’il est soumis à certaines lois objectives et, au final, est le représentant des intérêts d’une classe particulière. Les idées n’ont ni existence indépendante, ni développement historique propre. « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie », écrit Marx, « mais la vie qui détermine la conscience » (L’idéologie allemande, 1846).
Les idées et actions des individus sont conditionnées par des rapports sociaux dont l’évolution ne dépend pas de la volonté subjective des hommes et des femmes, mais obéit à des lois définies qui, en dernière analyse, reflètent les besoins du développement des forces productives. Les corrélations entre tous les facteurs en jeu constituent une toile complexe qu’il est souvent difficile de bien saisir. L’étude de ces relations est l’objet de la théorie marxiste de l’histoire.
Donnons un exemple. A l’époque de la Révolution anglaise, Oliver Cromwell croyait ardemment qu’il combattait pour le droit de chaque individu de prier Dieu selon sa conscience. Mais la suite de l’histoire a prouvé que cette Révolution était une étape décisive dans l’irrésistible ascension vers le pouvoir de la bourgeoisie anglaise. Le niveau de développement des forces productives en Angleterre, au XVIIe siècle, ne permettait pas d’autre issue.
De même, les dirigeants de la Grande Révolution française de 1789-93 combattaient sous la bannière de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Ils pensaient lutter pour un régime fondé sur les lois éternelles de la Justice et de la Raison. Cependant, quelles que fussent leurs idées et intentions, les Jacobins préparaient le règne de la bourgeoisie en France. Là encore, d’un point de vue scientifique, aucun autre résultat n’était possible à ce stade du développement social.
Du point de vue du mouvement ouvrier, la grande contribution de Marx fut d’expliquer que le socialisme n’est pas juste une bonne idée, mais le résultat nécessaire du développement de la société. Les penseurs socialistes d’avant Marx – les « socialistes utopistes » – ont tenté de découvrir des lois et des formules universelles qui poseraient les bases du triomphe de la raison humaine sur les injustices de la société de classe. Selon eux, il suffisait de découvrir ces idées et les problèmes seraient résolus. C’était une approche idéaliste.
Contrairement aux utopistes, Marx n’a jamais tenté de découvrir les lois de la société en général. Il analysait les lois de l’évolution d’une société particulière, la société capitaliste, en expliquant comment elle surgit, comment elle évolue et comment elle doit nécessairement cesser d’exister, à un moment donné. Il a accompli cette tâche immense dans les trois livres du Capital.
Marx et Darwin
Charles Darwin, qui était un matérialiste instinctif, expliquait l’évolution des espèces comme résultant des effets de l’environnement naturel. Karl Marx expliquait l’histoire de l’humanité par le développement de cet environnement « artificiel » qu’on appelle la société. La différence réside, d’une part, dans le caractère extrêmement complexe de la société humaine, comparé à la relative simplicité de la nature – et, d’autre part, dans le rythme extrêmement rapide des évolutions de la société, comparé au rythme de l’évolution par la sélection naturelle.
Sur la base des rapports sociaux de production – en d’autres termes, des relations entre les classes sociales – surgissent des formes légales et politiques complexes, avec leurs multiples reflets idéologiques, culturels et religieux. Cet édifice complexe de formes et d’idées est parfois appelé « superstructure » sociale. Bien qu’elle repose toujours sur des fondations économiques (« l’infrastructure »), la superstructure s’élève au-dessus de l’infrastructure et interagit avec elle – parfois de façon décisive. Cette relation dialectique entre la base économique et la superstructure est très complexe, et donc pas toujours évidente à saisir. Mais en dernière analyse, la base économique s’avère toujours être la force décisive.
Les rapports de propriété ne sont que l’expression juridique des rapports entre les classes. Dans un premier temps, ces rapports sociaux – avec leur expression légale et politique – favorisent le développement des forces productives. Mais à un certain stade, le développement des forces productives se heurte aux limites des rapports de propriété. Ces derniers deviennent un obstacle au développement de la production. Alors, la société entre dans une période révolutionnaire.
Les idéalistes voient dans la conscience humaine le ressort principal de toute action, la force motrice de l’histoire. Mais toute l’histoire prouve le contraire. En général, la conscience humaine n’est pas progressiste ou révolutionnaire. Elle s’adapte très lentement aux circonstances objectives ; elle est profondément conservatrice. La plupart des gens n’aiment pas le changement, et moins encore le changement révolutionnaire. Cette peur innée du changement est profondément enracinée dans la psyché collective. Elle relève d’un mécanisme de défense qui remonte aux premiers temps de l’espèce humaine.
En règle générale, on peut dire que la société ne décide jamais de faire un pas en avant sans y être poussée par la pression d’une extrême nécessité. Aussi longtemps qu’il est possible de se tirer d’affaire sur la base des vieilles idées, en les adaptant imperceptiblement aux lentes évolutions de la réalité, les hommes et les femmes continuent de suivre les sentiers battus. Comme la force d’inertie en mécanique, la tradition, l’habitude et la routine pèsent très lourdement sur la conscience humaine. Les idées ont tendance à être en retard sur la réalité objective. Il faut l’impact violent de grands événements pour surmonter cette inertie et obliger les gens à remettre en cause la société existante, ses idées et ses valeurs.
Une révolution exprime le fait que les contradictions sociales engendrées par le conflit entre développement économique et rapports de production sont devenues insoutenables. Ce conflit central ne peut être levé que par le renversement de l’ordre établi et son remplacement par de nouveaux rapports sociaux, qui harmonisent la base économique et la superstructure.
Dans une révolution victorieuse, les fondations économiques de la société subissent une transformation radicale. Puis la superstructure légale et politique subit, elle aussi, un profond changement. Dans chaque cas, les rapports de production nouveaux, plus évolués, ont mûri au sein de l’ancienne société, sous une forme embryonnaire, posant le besoin urgent d’une transition vers un nouveau système social.
Le matérialisme historique
Le marxisme analyse les principaux ressorts cachés du développement de la société humaine, depuis les premières sociétés tribales jusqu’à nos jours. On appelle conception matérialiste de l’histoire – ou « matérialisme historique » – la façon dont le marxisme décrit cette route sinueuse. Cette méthode scientifique nous permet de comprendre l’histoire, non comme une série d’incidents sans liens entre eux, mais comme un processus d’ensemble intelligible. C’est une série d’actions et de réactions qui embrassent la politique, l’économie et l’ensemble du spectre du développement social. La tâche du matérialisme historique est de mettre à nu la relation dialectique complexe entre ces phénomènes.
Dans Déclin et chute de l’Empire romain, le grand historien anglais Edward Gibbon écrivait que l’histoire n’est « rien de plus que le registre des crimes, des folies et des infortunes de l’humanité. » Au fond, les plus récentes interprétations « post-modernes » de l’histoire ne disent rien d’autre. Elles considèrent l’histoire comme une série de « récits » sans connexions ni signification ou logique internes. Dès lors, aucun système socio-économique ne peut être dit meilleur ou pire qu’un autre. Et donc il ne peut être question de progrès ou de régression.
De ce point de vue, l’histoire apparaît comme une série inexplicable – et privée de sens – d’événements aléatoires, d’accidents. Elle ne serait gouvernée par aucune loi qui puisse être saisie. Essayer de la comprendre serait un exercice inutile. Une variation sur ce thème est l’idée – très populaire dans les milieux académiques – selon laquelle il n’existerait pas de plus hautes ou de plus basses formes de développement social et culturel. Il n’y aurait pas non plus de progrès, qui serait un concept démodé, hérité du XIXe siècle et alors popularisé par les Victoriens libéraux, les socialistes Fabiens – et Karl Marx.
Cette négation du progrès dans l’histoire est caractéristique de la psychologie de la bourgeoisie dans la phase du déclin du capitalisme. C’est un reflet du fait que, sous le capitalisme, le progrès a effectivement atteint ses limites – et menace de faire marche arrière. Naturellement, la bourgeoisie et ses intellectuels sont peu disposés à accepter ce fait. Mieux encore : ils sont organiquement incapables de le reconnaître. Lénine a dit un jour qu’un homme au bord du gouffre ne raisonne pas. Cependant, ils sont vaguement conscients de la situation réelle – et essayent de trouver une justification à l’impasse de leur système en niant complètement la possibilité du progrès en général.
Cette idée a été si profondément gravée dans les consciences qu’elle a été introduite dans le domaine de l’évolution naturelle. Même un brillant penseur comme Stephen Jay Gould, dont la théorie dialectique des équilibres ponctués a transformé la manière dont l’évolution est perçue, soutient qu’il est faux de parler de progrès du plus bas vers le plus haut, dans l’évolution naturelle. Ainsi, les microbes devraient être placés au même niveau que les êtres humains. En un sens, il est vrai que toutes les choses vivantes sont liées (le génome humain l’a définitivement prouvé). L’humanité n’est pas une création spéciale du Tout-Puissant, mais le produit de l’évolution. Il n’est pas non plus correct de voir l’évolution comme une sorte de grand dessein dont le but était de créer des êtres comme nous (vision « téléologique » – du grec telos, « fin » ou « but »). Cependant, en rejetant une idée incorrecte, il n’est pas nécessaire de tomber dans l’autre extrême, qui mène à d’autres erreurs.
Il n’est pas question de supposer un plan préétabli lié à une intervention divine ou toute autre téléologie. Mais il est clair que les lois de l’évolution inhérentes à la nature déterminent le développement de formes de vie simples vers des formes plus complexes. Les premières formes de vie contiennent déjà en elles l’embryon de tous les développements futurs. Il est possible d’expliquer le développement des yeux, des jambes et d’autres organes sans recourir à un plan préétabli. À un certain stade, le système nerveux et le cerveau se développent. Finalement, avec homo sapiens, nous arrivons à la conscience humaine. La matière devient consciente d’elle-même. Il n’y a pas eu de révolution plus importante depuis le développement de la matière organique (la vie) à partir de la matière inorganique.
Pour satisfaire nos critiques, il faudrait ajouter : de notre point de vue. Si les microbes étaient capables d’avoir un point de vue, eux aussi, il est probable qu’ils nous opposeraient de sérieuses objections. Mais nous sommes des êtres humains et nous voyons nécessairement les choses de notre point de vue d’hommes. Et nous affirmons, en effet, que l’évolution réalise un développement de formes de vie simples à des formes plus complexes – autrement dit, un progrès vers des formes supérieures de vie. Récuser cette affirmation revient à abandonner une approche scientifique au profit d’une approche purement scolastique. En disant cela, on ne veut surtout pas offenser les microbes qui, après tout, sont là depuis plus longtemps que nous et, si le capitalisme n’est pas renversé, pourraient bien avoir le dernier mot.
La force motrice de l’histoire
Dans sa Critique de l’Économie Politique, Marx explique de la façon suivante la relation entre les forces productives et la « superstructure » : « (…) dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles (…) Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. »
Comme Marx et Engels se sont évertués à le souligner, ceux qui participent à l’histoire ne sont pas toujours conscients des motifs qui les poussent à agir. Ils les rationalisent d’une manière ou d’une autre, mais ces motifs existent et ont une base dans le monde réel.
Charles Darwin expliquait que les espèces ne sont pas immuables : elles ont un passé, un présent et un avenir ; elles changent, elles évoluent. De même, Marx et Engels expliquaient qu’un système social donné n’est pas quelque chose de figé pour l’éternité. C’est pourtant l’illusion de chaque époque. Chaque système social croit qu’il représente la seule forme possible d’existence des êtres humains – et que ses institutions, sa religion et sa morale sont l’aboutissement final de l’histoire.
C’est ce que les cannibales, les prêtres égyptiens, Marie-Antoinette et le Tsar Nicolas croyaient tous avec ferveur. Et c’est ce que la bourgeoisie et ses apologistes tentent de démontrer lorsqu’ils nous assurent, sans le moindre fondement, que le système de la soi-disant « libre entreprise » est le seul possible – juste au moment où il commence à sombrer.
De nos jours, l’idée d’« évolution » est largement admise, au moins chez les personnes instruites. Les idées de Darwin, si révolutionnaires de son vivant, sont désormais acceptées comme des évidences. Cependant, l’évolution est généralement comprise comme un processus lent et graduel, sans interruption ni violent bouleversement. En politique, ce « gradualisme » est au cœur du réformisme. Cependant, il repose sur un malentendu.
Aujourd’hui encore, le mécanisme réel de l’évolution reste largement incompris. Ce n’est pas surprenant, car Darwin lui-même ne l’avait pas bien compris. Ces dernières décennies, cependant, les nouvelles avancées en paléontologie – et notamment la théorie des « équilibres ponctués » de Stephen J. Gould – ont permis de démontrer que l’évolution n’est pas un processus graduel. Il y a de longues périodes pendant lesquelles aucun grand changement n’est observé ; mais à un moment donné, le cours de l’évolution est brisé par une explosion, une véritable révolution biologique caractérisée par des extinctions de masse de certaines espèces – et la rapide ascension d’autres espèces.
Bien sûr, l’analogie entre la société et la nature n’est qu’approximative. Mais l’examen le plus superficiel de l’histoire montre que son interprétation gradualiste est sans fondement. La société, comme la nature, connaît de longues périodes de changement lent et graduel, qui cependant sont interrompues par des développements explosifs – les guerres et les révolutions, au cours desquelles le processus accélère énormément. De fait, ce sont ces événements, ces guerres et ces révolutions, qui constituent la principale force motrice du développement historique. Et la cause fondamentale d’une révolution, c’est le fait qu’un système socio-économique donné a atteint ses limites et n’est plus capable de développer les forces productives comme avant.
Une vision dynamique de l’histoire
Ceux qui nient l’existence de lois gouvernant le développement social humain abordent toujours l’histoire d’un point de vue subjectif et moral. Comme Gibbon (mais sans son talent extraordinaire), ils hochent la tête devant le spectacle sans fin d’une violence insensée, de l’inhumanité de l’homme envers l’homme (et la femme) et ainsi de suite. Au lieu d’une approche scientifique de l’histoire, on a le point de vue d’un pasteur. Or ce qu’il nous faut, ce n’est pas un sermon, mais une approche rationnelle. Derrière les faits singuliers, nous devons discerner les tendances générales, les transitions d’un système social à l’autre. Et il nous faut mettre à jour les forces motrices fondamentales qui déterminent ces transitions.
Lorsqu’on applique la méthode du matérialisme dialectique à l’histoire de l’humanité, il apparaît immédiatement qu’elle a ses propres lois et, dès lors, peut être comprise comme un processus. L’ascension et le déclin des différentes formations socio-économiques peuvent être expliqués scientifiquement en termes de capacité – ou non – à développer les moyens de production, et par là même à repousser l’horizon de la culture humaine, accroître la domination de l’homme sur la nature.
La plupart des gens croient que la société dans laquelle ils vivent ne changera jamais et que ses valeurs morales, religieuses et idéologiques sont immuables, tout comme la « nature humaine ». Mais même une étude superficielle de l’histoire montre que c’est faux. L’histoire se caractérise par l’ascension et le déclin de différents systèmes socio-économiques. Tout comme les individus, les sociétés naissent, se développent, atteignent leurs limites et déclinent – après quoi elles sont remplacées par une nouvelle formation sociale.
En dernière analyse, la viabilité d’un système socio-économique donné est déterminée par sa capacité à développer les forces productives, puisque tout dépend de celles-ci. Bien sûr, beaucoup d’autres facteurs entrent dans l’équation complexe de l’histoire : la religion, la politique, la philosophie, la morale, la psychologie des différentes classes et les qualités individuelles des dirigeants. Mais ces choses elles-mêmes ne tombent pas du ciel. Une analyse sérieuse montre qu’elles sont déterminées – d’une manière contradictoire et dialectique – par l’environnement historique, par des tendances et des processus qui sont indépendants de la volonté des hommes et des femmes.
La psychologie d’une société en phase d’ascension, qui développe les moyens de production et repousse l’horizon de la culture, est très différente de la psychologie d’une société qui stagne ou décline. Le contexte historique général détermine tout. Il affecte le climat moral dominant, l’attitude des hommes et des femmes envers les institutions politiques et religieuses existantes. Il affecte même la qualité des dirigeants politiques.
Dans sa jeunesse, le capitalisme était capable de prouesses colossales. Il a développé les forces productives à un rythme et à des niveaux sans précédent, faisant ainsi reculer les frontières de la civilisation humaine. Les gens sentaient que cette société avançait, en dépit des injustices et de l’exploitation qui ont toujours caractérisé ce système. Ce sentiment a donné naissance à un esprit général d’optimisme et de progrès, qui était la marque de fabrique du vieux libéralisme, avec sa ferme conviction qu’aujourd’hui est mieux qu’hier – et que demain serait mieux qu’aujourd’hui.
Ce n’est plus le cas. Le vieil optimisme et la foi aveugle dans le progrès ont été remplacés par un profond sentiment d’insatisfaction vis-à-vis du présent et de pessimisme à l’égard du futur. Ce sentiment de peur et d’insécurité n’est qu’un reflet psychologique du fait que le capitalisme n’est plus capable de jouer un rôle progressiste.
Au XIXe siècle, le libéralisme, principale idéologie de la bourgeoisie, défendait (en théorie) le progrès et la démocratie. Mais l’actuel « néo-libéralisme » n’est qu’un masque couvrant l’affreuse réalité de l’exploitation la plus rapace, le viol de la planète, la destruction de l’environnement sans le moindre égard pour les générations futures. La seule préoccupation des conseils d’administration des grandes multinationales, qui sont les véritables dirigeants des États-Unis et du monde entier, c’est de s’enrichir à travers le pillage, le rachat d’entreprises en faillite, la corruption, la privatisation (le vol) des biens publics et le parasitisme. Telles sont les principales caractéristiques de la bourgeoisie dans la phase de son déclin sénile.
Ascension et déclin des sociétés
« Le passage d’un système à un autre a toujours été déterminé par la croissance des forces productives, c’est-à-dire de la technique et de l’organisation du travail. Jusqu’à un certain point, les changements sociaux ont seulement un caractère quantitatif et n’altèrent pas les fondements de la société, c’est-à-dire les formes dominantes de la propriété. Mais il arrive un moment où les forces productives accrues ne peuvent plus rester enfermées dans les vieilles formes de propriété ; alors survient dans l’ordre social un changement, accompagné de secousses. » (Léon Trotsky, Le marxisme et notre époque, avril 1939)
Un argument courant contre le socialisme est qu’il est impossible de changer la « nature humaine » ; les gens seraient naturellement égoïstes, avares, etc. En réalité, il n’y a pas de nature humaine supra-historique. Ce que l’on pense être la « nature humaine » a subi de nombreuses modifications au cours de l’histoire. Les hommes et les femmes changent constamment la nature à travers leur travail et, ce faisant, se changent eux-mêmes. De même, nos connaissances de l’évolution humaine réfutent l’argument selon lequel les gens seraient naturellement égoïstes et avares.
Nos plus vieux ancêtres, qui n’étaient pas encore réellement humains, étaient petits et étaient faibles, physiquement, comparés aux autres animaux. Ils n’avaient ni griffes ni dents puissantes. Du fait de leur posture verticale, ils ne couraient pas assez vite pour attraper l’antilope qu’ils voulaient manger – ou pour échapper au lion qui voulait les manger. Leur cerveau avait approximativement la même taille que celui d’un chimpanzé. Errant dans la savane d’Afrique de l’Est, ils se trouvaient dans une position très désavantageuse par rapport aux autres espèces – à part dans un domaine fondamental.
Dans son brillant essai sur Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, Engels explique comment la posture verticale a libéré les mains. Alors, la production d’outils en pierre a représenté un saut qualitatif, donnant à nos ancêtres un avantage du point de vue de l’évolution. Mais il y avait d’autres facteurs encore plus importants : le sens de la communauté, la production collective et la vie sociale, qui eux-mêmes furent étroitement connectés au développement du langage.
L’extrême vulnérabilité de l’enfant humain, comparé aux enfants des autres espèces, signifie que nos ancêtres, dont l’existence de chasseurs-cueilleurs les obligeait à se déplacer sans cesse, devaient développer un fort sentiment de solidarité pour protéger leur descendance et, ainsi, assurer la survie de la tribu ou du clan. Il est certain que sans ce sentiment puissant de coopération et de solidarité, notre espèce se serait éteinte avant même d’être née.
Nous le voyons encore aujourd’hui. Si un enfant est en train de se noyer dans une rivière, la plupart des témoins essayeront de le sauver au péril de leur propre vie. Beaucoup de gens se sont noyés en essayant d’en sauver d’autres. Cela ne peut pas s’expliquer en termes de calcul égoïste ou de liens du sang au sein d’un petit groupe tribal. Les gens qui agissent ainsi ne connaissent pas celui qu’ils essayent de sauver et n’attendent aucune récompense. Ce comportement altruiste est tout à fait spontané et vient d’un instinct de solidarité profondément enraciné. L’argument selon lequel les gens sont naturellement égoïstes n’est qu’un reflet de l’immonde et déshumanisante aliénation de la société capitaliste.
Pendant l’immense majorité de l’histoire de notre espèce, les hommes et les femmes vivaient dans des sociétés où la propriété privée, au sens moderne du terme, n’existait pas. Il n’y avait pas d’argent, de patron, d’ouvrier, de banquier, de propriétaire terrien, d’État, de religion organisée, de police et de prison. Même la famille, dans l’acception moderne de ce mot, n’existait pas. Aujourd’hui, beaucoup ont du mal à imaginer un monde sans toutes ces choses ; elles semblent si naturelles qu’on les croirait décrétées par le Tout-Puissant. Et pourtant, nos ancêtres s’en sortaient assez bien sans elles.
La transition de la chasse et la cueillette vers une agriculture et un pastoralisme stables constitue la première grande révolution sociale, que le grand archéologue (et marxiste) australien Gordon Childe a appelée la « Révolution néolithique ». L’agriculture a besoin d’eau. Dès qu’elle va au-delà de la plus basique production pour le minimum vital, elle a besoin de l’irrigation, du forage, de barrages et de distribution d’eau à grande échelle. Autant de tâches sociales.
L’irrigation à grande échelle a besoin d’une vaste organisation. Elle exige le déploiement d’un grand nombre de travailleurs manuels, un haut niveau d’organisation et de discipline. La division du travail – qui existait déjà sous une forme embryonnaire dans la division élémentaire entre les sexes, conséquence des contraintes de la grossesse et de la prise en charge des nouveau-nés – s’est développée à un niveau plus élevé. Le travail d’équipe avait besoin de chefs d’équipes, de surveillants, etc., et d’une armée d’officiels pour superviser le plan.
La coopération à une aussi vaste échelle exige une planification, mais également l’utilisation de la science et de la technique. Cela dépassait les capacités des petits groupes organisés en clan qui formaient le noyau de la vieille société. Le besoin d’organiser et de mobiliser un grand nombre de travailleurs a mené à l’essor d’un État central, doté d’une administration centrale et d’une armée, comme en Égypte et en Mésopotamie.
La mesure du temps et de l’espace était un élément nécessaire à la production – et faisait partie des forces productives elles-mêmes. Hérodote liait les débuts de la géométrie en Égypte au besoin d’évaluer la surface des terres inondées sur une base annuelle. Le mot géométrie lui-même signifie la « mesure de la terre ».
L’étude des cieux (l’astronomie) et les mathématiques ont permis aux prêtres égyptiens d’anticiper les crues du Nil. Ainsi, la science a surgi d’une nécessité économique. Dans sa Métaphysique, Aristote écrivait : « L’homme commence à philosopher lorsque les nécessités de la vie sont assurées » (Métaphysique, I, 2). Cette affirmation est au cœur du matérialisme historique – 2300 ans avant Karl Marx.
Au centre du clivage entre riches et pauvres, dirigeants et dirigés, instruits et ignorants, se trouve la division entre le travail intellectuel et le travail manuel. Le contremaître est en général exempt du travail manuel, qui est dès lors stigmatisé. La Bible parle des « sculpteurs de bois et des puisatiers », des masses qui sont exclues de la culture, laquelle est alors recouverte d’un voile de mystère et de magie. Les secrets de la culture étaient jalousement gardés par la caste des prêtres et des scribes, dont c’était le monopole.
Ici, nous voyons déjà les contours d’une société de classe, de la division de la société en classes, entre exploiteurs et exploités. Dans n’importe quelle société où l’art, la science et le gouvernement sont le monopole d’une minorité, cette minorité usera et abusera de sa position et de ses intérêts. C’est le secret le plus fondamental de la société de classe ; il dure depuis 12 000 ans.
Pendant tout ce temps, il y a eu beaucoup de changements fondamentaux dans les formes de la vie économique et sociale. Mais les rapports fondamentaux entre les dirigeants et les dirigés, les riches et les pauvres, les exploiteurs et les exploités, sont restés les mêmes. Par ailleurs, bien que les formes de gouvernement aient connu de nombreux changements, l’État reste ce qu’il a toujours été : un instrument de coercition et une expression de la domination de classe.
En Europe, l’ascension et le déclin de la société esclavagiste ont été suivis par le féodalisme, qui à son tour a été remplacé par le capitalisme. L’ascension de la bourgeoisie, qui a commencé dans les villes et cités d’Italie et des Pays-Bas, a franchi une étape décisive lors des révolutions bourgeoises en Hollande et en Angleterre, aux XVIe et XVIIe siècles, puis lors de la Révolution française de 1789-93. Tous ces changements ont été accompagnés d’une transformation profonde de la culture, de l’art, de la littérature, de la religion et de la philosophie.
L’État
L’État est une force de répression spéciale qui se tient au-dessus de la société et s’en détache de plus en plus. Cette force a ses origines dans un passé lointain. Les origines des différents États, cependant, varient selon les circonstances. Chez les Germains et les natifs américains, il a surgi de bandes guerrières qui s’assemblaient autour de la personne du chef de guerre. Ce fut aussi le cas chez les Grecs, comme on le voit dans les poèmes épiques d’Homère.
À l’origine, les chefs tribaux jouissaient d’une autorité issue de leur bravoure, de leur sagesse et d’autres qualités personnelles. Aujourd’hui, le pouvoir de la classe dominante n’a plus rien à voir avec les qualités personnelles des dirigeants. Il s’enracine dans des rapports sociaux objectifs, des rapports de production – et dans le pouvoir de l’argent. Les qualités individuelles d’un chef d’État peuvent être bonnes ou mauvaises, mais ce n’est pas la question.
L’État des toutes premières formes de sociétés de classe avait déjà un caractère monstrueux ; il dévorait d’énormes quantités de travail, réprimait les masses et les privait de tout droit. Mais dans le même temps, en développant la division du travail, en organisant la société et en portant la coopération à des niveaux inédits, l’État a permis de mobiliser une énorme quantité de force de travail et, ainsi, d’augmenter considérablement la productivité du travail humain.
Au début, tout dépendait du travail des masses paysannes. L’État avait besoin d’un grand nombre de paysans corvéables et payant des taxes – les deux piliers sur lesquels reposait la société. Ceux qui contrôlaient ce système de production contrôlaient le pouvoir et l’État. Il était alors nécessairement centralisé et bureaucratique. À l’origine, il avait un caractère religieux et se confondait avec le pouvoir de la caste des prêtres. À son sommet se tenait le Dieu-Roi et, derrière lui, une armée d’officiels, de Mandarins, de scribes, de superviseurs, etc. L’écriture elle-même était admirée comme un art mystérieux et connu seulement de quelques-uns.
D’emblée, les fonctions de l’État furent mystifiées. Les relations sociales réelles apparaissaient sous un aspect déformé. C’est toujours le cas. En Grande-Bretagne, cette mystification est délibérément cultivée à travers les cérémonies, le faste et la tradition. Aux États-Unis, elle est cultivée par d’autres moyens : le culte du président, qui personnifie le pouvoir d’État. En substance, cependant, chaque forme d’État représente la domination d’une classe sur le reste de la société. Même dans ses formes les plus démocratiques, l’État défend la dictature d’une seule classe, la classe dominante, celle qui possède et contrôle les moyens de production.
L’État moderne est un monstre bureaucratique qui dévore une part colossale de la richesse produite par la classe ouvrière. Les marxistes sont d’accord avec les anarchistes pour considérer que l’État est un monstrueux instrument d’oppression qui doit être éliminé. La question est : comment ? Par qui ? Et qu’est-ce qui le remplacera ? C’est une question fondamentale de toute révolution. Dans un discours sur l’anarchisme prononcé pendant la guerre civile qui a suivi la Révolution russe, Trotsky résumait très bien la position marxiste sur l’État :
« La bourgeoisie dit : ne touchez pas au pouvoir d’État ; il est le privilège héréditaire, sacré, des classes éduquées. Les anarchistes disent : n’y touchez pas ; c’est une invention infernale, un dispositif diabolique. Ne vous occupez pas de lui. La bourgeoisie dit : n’y touchez pas, il est sacré. Les anarchistes disent : n’y touchez pas, il est immonde. Les deux disent : n’y touchez pas. Mais nous, nous disons : ne vous contentez pas de le toucher, prenez-le dans vos mains et faites-le travailler dans votre intérêt, pour l’abolition de la propriété privée et l’émancipation de la classe ouvrière. »
Le marxisme explique qu’en dernière analyse, l’État consiste en des détachements d’hommes en armes : l’armée, la police, les tribunaux, les prisons. Contre les idées confuses des anarchistes, Marx soutenait que les travailleurs auraient besoin de l’État pour briser la résistance des classes exploiteuses. Mais cet argument de Marx a été déformé à la fois par les bourgeois et par les anarchistes.
Marx parlait de la « dictature du prolétariat », qui est une formule plus scientifiquement précise que : « domination politique du prolétariat ». De nos jours, le mot « dictature » a des connotations qu’il n’avait pas à l’époque de Marx. Après les crimes horribles de Hitler et Staline, il suscite les visions cauchemardesques d’un monstre totalitaire, avec ses camps de concentration et sa police secrète. Mais ces choses n’existaient même pas en imagination du vivant de Marx. Pour lui, le mot dictature venait de la République romaine. Il désignait une situation où, en temps de guerre, les lois normales étaient provisoirement suspendues.
Le dictateur romain (« celui qui dicte ») était un magistrat extraordinaire (magistratus extraordinarius) ayant l’autorité absolue pour accomplir des tâches dépassant l’autorité habituelle d’un magistrat. La fonction fut à l’origine nommée Magister Populi (Maître du peuple), c’est-à-dire maître de l’armée citoyenne. En d’autres termes, c’était un rôle militaire qui impliquait presque toujours de diriger une armée sur le champ de bataille. Une fois que la période exceptionnelle se terminait, le dictateur démissionnait. L’idée d’une dictature totalitaire comme celle de Staline, où l’État opprimait la classe ouvrière dans les intérêts d’une caste de bureaucrates privilégiés, aurait horrifié Marx.
Son modèle était aux antipodes du stalinisme. Marx illustrait son idée de « dictature du prolétariat » avec la Commune de Paris de 1871. Alors, pour la première fois, les masses populaires, avec les travailleurs à leur tête, ont renversé le vieil État et ont commencé la tâche de transformer la société. Sans direction, organisation et plan d’action clairement définis, les masses ont fait preuve d’un courage et d’une créativité extraordinaires. Résumant l’expérience de la Commune de Paris, Marx et Engels expliquaient : « une chose en particulier a été prouvée par la Commune, à savoir que la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d’État toute prête, et la manier pour son propre compte. » (Préface à l’édition allemande de 1872 du Manifeste Communiste). Les travailleurs ont besoin de leur Etat, un Etat ouvrier, qui diffère fondamentalement, dans ses caractéristiques, de l’Etat capitaliste.
La transition vers le socialisme – une forme de société basée sur l’abondance et une authentique démocratie – ne peut être accomplie que par la participation active et consciente de la classe ouvrière dans le fonctionnement de la société, de l’industrie et de l’État. Ce n’est pas quelque chose qui est gentiment légué aux travailleurs par des capitalistes ou des bureaucrates au grand cœur.
Sous Lénine et Trotsky, l’État soviétique était construit dans le but de faciliter l’implication des travailleurs dans les tâches de contrôle et de comptabilité. Il s’agissait d’assurer la réduction progressive des « fonctions spéciales » de l’autorité et du pouvoir de l’État. Des limitations strictes ont été placées sur les salaires, le pouvoir et les privilèges des officiels, dans le but d’empêcher la formation d’une caste privilégiée.
L’État ouvrier établi par la Révolution bolchevique de 1917 n’était ni bureaucratique, ni totalitaire. Au contraire, avant que la bureaucratie stalinienne ne l’arrache au contrôle des masses, c’était l’État le plus démocratique qui ait jamais existé. Les principes de base du pouvoir soviétique n’ont pas été inventés par Marx ou Lénine. Ils reposaient sur l’expérience concrète de la Commune de Paris, et ont été développés plus tard par Lénine.
Lénine était l’ennemi juré de la bureaucratie. Il a toujours souligné que le prolétariat (la classe ouvrière) n’a besoin que d’un État qui soit « constitué de telle manière qu’il commencera immédiatement à dépérir et qu’il ne puisse pas ne pas dépérir ». Un État ouvrier authentique n’a rien en commun avec les monstres bureaucratiques qui existent aujourd’hui, et encore moins avec celui qui existait dans la Russie stalinienne. Les conditions fondamentales d’une démocratie ouvrière ont été exposées dans l’un des livres les plus importants de Lénine, L’État et la Révolution :
- Des élections libres et démocratiques avec droit de révocation.
- Aucun fonctionnaire ne perçoit un salaire supérieur à celui d’un travailleur qualifié.
- Pas d’armée permanente, mais le peuple en armes.
- Graduellement, toutes les tâches de l’administration doivent être réalisées, à tour de rôle, par tout le monde : « quand tout le monde est un bureaucrate, personne n’est un bureaucrate. »
Ce sont les conditions que Lénine a posées, non pour un socialisme ou un communisme aboutis, mais pour la toute première période d’un État ouvrier, la période de transition du capitalisme au socialisme.
Les Soviets des Députés Ouvriers et Soldats étaient des assemblées élues composées non de politiciens et de bureaucrates professionnels, mais de travailleurs, de paysans et de soldats ordinaires. Ils n’étaient pas un pouvoir étranger se tenant au-dessus de la société, mais un pouvoir basé sur l’initiative directe de la population. Ses lois n’étaient pas celles décrétées par un pouvoir d’État capitaliste. C’était un type de pouvoir entièrement différent de celui qui existe dans les républiques parlementaires bourgeoises les plus « modernes » d’Europe et d’Amérique, aujourd’hui. Ce pouvoir était du même type que celui de la Commune de Paris de 1871.
Il est vrai que dans un contexte d’extrême arriération économique et culturelle, de pauvreté et d’illettrisme, la classe ouvrière russe fut incapable de conserver le pouvoir qu’elle avait conquis. La Révolution a subi un processus de dégénérescence bureaucratique qui a mené au Stalinisme. Contrairement aux mensonges des historiens bourgeois, le Stalinisme n’était pas un produit du Bolchevisme, mais son ennemi le plus implacable. Staline occupe approximativement la même place, par rapport à Marx et Lénine, que Napoléon par rapport aux Jacobins ou le pape par rapport aux premiers chrétiens.
La première Union Soviétique – avant Staline – n’était pas du tout un État au sens où nous l’entendons habituellement. C’était l’expression organisée du pouvoir révolutionnaire des travailleurs. Pour reprendre la formule de Marx, c’était un « demi-État », un État destiné à dépérir et se dissoudre dans la société, pour laisser place à une administration collective de la société au profit de tous, sans force ni contrainte. Telle est l’authentique conception marxiste d’un État ouvrier.
L’ascension de la bourgeoisie
Trotsky soulignait que la révolution est la force motrice de l’histoire. Ce n’est pas un hasard si l’ascension de la bourgeoisie en Italie, en Hollande, en Angleterre et plus tard en France, fut accompagnée par une culture, un art et une science extraordinairement florissants. Dans ces pays où la révolution bourgeoise a triomphé aux XVIIe et XVIIIe siècles, le développement des forces productives et de la technologie s’accompagnait d’un développement de la science et de la philosophie, ce qui a définitivement sapé les bases de la domination idéologique de l’Église.
À l’inverse, dans les pays où les forces de la réaction catholique et féodale ont étouffé dans l’œuf l’embryon de la société nouvelle, la conséquence en fut une longue période de dégénérescence, de déclin et de décomposition. A cet égard, l’exemple de l’Espagne est peut-être le plus évident.
À l’époque de l’ascension du capitalisme, lorsqu’il était encore une force progressiste, ses idéologues menèrent une lutte féroce contre les bastions idéologiques du féodalisme, à commencer par l’Église Catholique. Bien avant le renversement du pouvoir des seigneurs féodaux, la bourgeoisie devait affaiblir leurs défenses idéologiques, c’est-à-dire le cadre philosophique et religieux de l’Église – et son bras armé, l’Inquisition. Elle le fit par l’intermédiaire de ses représentants les plus conscients et les plus révolutionnaires.
L’essor du capitalisme a commencé aux Pays-Bas et dans les villes du nord de l’Italie. Graduellement, une nouvelle morale et de nouvelles croyances religieuses se cristallisèrent. Sous le féodalisme, le pouvoir économique reposait sur la propriété de la terre. L’argent jouait un rôle secondaire. Mais l’essor de la manufacture et du commerce a fait de l’Argent une source de pouvoir toujours plus importante. De grandes familles de banquiers, tels les Fuggers, ont surgi et défié le pouvoir des rois.
Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles n’étaient que l’expression la plus visible de conflits de classe plus profonds. Le seul résultat possible de ces luttes était l’accession au pouvoir de la bourgeoisie et l’établissement de nouveaux rapports de production (capitalistes). Mais les dirigeants de ces luttes ne pouvaient pas anticiper ce fait.
La Révolution anglaise de 1640-60 fut un grand bouleversement social. Le vieux régime féodal fut détruit et remplacé par un nouvel ordre social capitaliste. La Guerre civile fut une guerre de classe qui renversa le despotisme de Charles Ier et l’ordre féodal réactionnaire qui se tenait derrière lui. Le Parlement représentait les classes moyennes montantes des villes et des campagnes, qui ont défié et vaincu le vieux régime, coupé la tête du roi et, au passage, dissous la chambre des Lords.
Objectivement, Olivier Cromwell posait les bases de la domination de la bourgeoisie en Angleterre. Mais pour atteindre cet objectif, pour balayer toutes les ordures féodales et monarchiques qui encombraient le chemin, il fut d’abord obligé d’écarter la bourgeoisie lâche, de dissoudre son Parlement et de s’appuyer sur la petite bourgeoisie, les petits fermiers de l’Est-Anglie – la classe à laquelle il appartenait – et les masses plébéiennes et semi-prolétariennes des villes et des campagnes.
Se plaçant lui-même à la tête d’une armée révolutionnaire, Cromwell stimulait la combativité des masses en faisant appel à la Bible, aux Saints et au Royaume de Dieu sur terre. Ses soldats n’allaient pas au combat sous la bannière de la rentabilité, de l’intérêt et du profit ; ils chantaient des hymnes religieux. C’est cet esprit évangélique, qui s’est vite rempli d’un contenu révolutionnaire (et même parfois communiste), qui motiva les masses à combattre avec un enthousiasme et un courage formidables contre les armées réactionnaires.
Cependant, une fois au pouvoir, Cromwell ne pouvait pas aller au-delà des limites objectives fixées par le niveau de développement des forces productives. Il fut obligé de se retourner contre l’aile gauche, d’écraser les Niveleurs et de mener une politique favorisant la bourgeoisie, c’est-à-dire le renforcement des rapports de propriété capitalistes. Finalement, Cromwell a dissous le parlement et régné en dictateur jusqu’à sa mort – lorsque la bourgeoisie anglaise, effrayée par une révolution qui était allée trop loin et pouvait menacer la propriété, a restauré les Stuarts sur le trône.
La Révolution française de 1789-93 s’est développée à un niveau qualitativement plus élevé. Au lieu d’en appeler à la religion, les jacobins en appelaient à la Raison. Ils combattaient sous le drapeau de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, dans le but de mobiliser les masses plébéiennes et semi-prolétariennes contre l’aristocratie féodale et la monarchie.
Bien avant de faire tomber les redoutables murs de la Bastille, la bourgeoisie révolutionnaire avait renversé les murs invisibles, mais non moins formidables, de l’Église et de la religion. Mais lorsque la bourgeoisie française devint la classe dominante et fut confrontée à une nouvelle classe révolutionnaire, le prolétariat (la classe ouvrière), elle oublia rapidement l’enthousiasme rationaliste et athée de sa jeunesse.
Après la chute de Robespierre, les hommes de propriété, victorieux, aspiraient à la stabilité. A la recherche d’une idéologie conservatrice justifiant leurs privilèges, ils ont redécouvert les charmes de la Sainte Église. Grâce à son extraordinaire capacité d’adaptation, celle-ci est parvenue à survivre pendant deux millénaires, malgré tant de bouleversements sociaux. L’Église catholique eut tôt fait d’accueillir son nouveau maître et protecteur bourgeois. Elle sanctifia le grand Capital, tout comme elle avait sanctifié le pouvoir des monarques féodaux – et, avant cela, des propriétaires d’esclaves de l’Empire romain.
Une caricature de marxisme
Dans son livre Qu’est-ce que l’histoire ?, l’historien anglais E.H. Carr soulignait que les faits historiques sont « toujours vus à travers le prisme de l’esprit de l’historien », et qu’il fallait donc « étudier l’historien avant de commencer à étudier les faits ». Il voulait dire que le récit de l’histoire ne peut pas être séparé du point de vue – politique ou autre – de l’écrivain, mais aussi du lecteur et de l’époque dans laquelle ils vivent ou ont vécu.
L’histoire officielle est écrite par les vainqueurs. Autrement dit, la sélection et l’interprétation des événements historiques sont façonnées par l’issue réelle des conflits, car ils affectent l’historien et, en outre, sa perception de ce que le lecteur veut lire. Malgré les prétentions des historiens bourgeois à l’« objectivité », le travail de l’historien reflète toujours un point de vue de classe. Il est impossible de se soustraire à toute espèce d’opinion sur les événements décrits. Prétendre le contraire, c’est chercher à tromper le lecteur.
Lorsque les marxistes analysent la société, ils ne prétendent pas être neutres. Ils épousent ouvertement la cause de la classe ouvrière et du socialisme. Cependant, cela n’exclut pas l’objectivité scientifique. Un chirurgien impliqué dans une opération délicate est aussi engagé à sauver la vie de son patient. Il est loin d’être « neutre » à l’égard du résultat attendu. Mais pour cette raison, il distinguera avec une précaution extrême les différentes couches de l’organisme. De même, les marxistes feront tout leur possible pour développer l’analyse la plus scientifique du processus social, afin d’être capables d’en influencer l’issue. En outre, nous ne voulons pas simplement établir une série de faits, « l’un après l’autre », mais cherchons à dévoiler et expliquer les processus généraux qui sont à l’œuvre.
De ce point de vue, nous constatons que le mouvement et la direction de l’histoire ont été (et demeurent) façonnés par les luttes successives des classes sociales pour façonner la société conformément à leurs propres intérêts – et par les conflits qui en résultaient entre ces différentes classes.
Très souvent, des gens s’efforcent de discréditer le marxisme en présentant de façon caricaturale sa méthode d’analyse historique. Selon cette caricature, Marx et Engels auraient « tout réduit à l’économie ». Marx et Engels ont répondu plusieurs fois à cette absurdité patente, par exemple dans une lettre d’Engels à J. Bloch : « D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant dans l’histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n’avons jamais affirmé davantage. Si, ensuite, quelqu’un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. »
Le matérialisme historique n’a rien à voir avec le fatalisme. Les hommes et les femmes ne sont pas les marionnettes de forces historiques aveugles. Mais ils ne sont pas non plus des agents entièrement libres, capables de façonner leur destinée indépendamment des conditions existantes et imposées par le niveau de développement de l’économie, de la science et de la technique – lequel, en dernière analyse, détermine si un système socio-économique est viable, ou non. Engels écrivait : « Les hommes font leur histoire, quelque tournure qu’elle prenne, en poursuivant chacun leurs fins propres, consciemment voulues, et c’est précisément la résultante de ces nombreuses volontés agissant dans des directions différentes et de leurs répercussions variées sur le monde extérieur qui constitue l’histoire. »
Marx et Engels ont maintes fois critiqué la superficialité avec laquelle certaines personnes utilisaient (mal) la méthode du matérialisme historique. Dans une lettre à Conrad Schmidt datée du 5 août 1890, Engels écrit : « En général, le mot “matérialiste” sert à beaucoup d’écrivains récents, en Allemagne, de simple phrase avec laquelle on étiquette toutes sortes de choses sans les étudier davantage, comme s’il suffisait de coller cette étiquette pour que tout soit dit. Or, notre conception de l’histoire est, avant tout, une directive pour l’étude, et non un levier servant à des constructions à la manière des hégéliens. Il faut réétudier toute l’histoire, il faut soumettre à une investigation détaillée les conditions d’existence des diverses formations sociales avant d’essayer d’en déduire les conceptions politiques, juridiques, esthétiques, philosophiques, religieuses, etc., qui leur correspondent. Sur ce point, on a fait jusqu’ici peu de choses, parce que peu de gens s’y sont attelés sérieusement. Sur ce point, nous avons besoin d’une aide de masse, le domaine est infiniment vaste, et celui qui veut travailler sérieusement peut faire beaucoup et s’y distinguer. Mais, au lieu de cela, les phrases vides sur le matérialisme historique (on peut précisément tout transformer en phrase) ne servent pour un trop grand nombre de jeunes Allemands qu’à faire le plus rapidement possible de leurs propres connaissances historiques relativement maigres – l’histoire économique n’est-elle pas encore dans les langes ? – une construction systématique artificielle et à se croire ensuite des esprits tout à fait puissants. C’est ce moment précis que choisit un Barth pour apparaître et se consacrer à quelque chose qui, dans son milieu au moins, n’est plus qu’une phrase creuse. » (Marx & Engels, Œuvres choisies, volume 49, p.8)
Dans une autre lettre à Conrad Schmidt datée du 27 octobre 1890, Engels écrit : « Ce qui manque à tous ces messieurs, c’est la dialectique. Ils ne voient qu’ici cause, là effet. Ils ne voient pas que c’est là une froide abstraction, que de pareilles oppositions polaires, métaphysiques, n’existent dans le monde réel que pendant les crises ; que le vaste développement tout entier se poursuit dans la forme de l’action réciproque (encore que les forces soient inégales, dont le mouvement économique est le plus puissant, le plus originel, le plus décisif) ; qu’il n’y a là rien d’absolu, que tout est relatif. Pour eux Hegel n’a pas existé. » (Marx et Engels, Œuvres Choisies, volume 49, p.59)
Le marxisme ne nie pas le rôle des idées, mais cherche à examiner ce qui les fait naître. Il ne nie pas non plus le rôle de l’individu, ou même du hasard, mais les replace dans leur juste contexte. Un accident de voiture ou une balle perdue peuvent sans doute changer le cours de l’histoire ; mais ils n’en sont pas la force motrice.
Hegel expliquait que la nécessité se révèle à travers l’accident. La balle de l’assassin qui a tué l’Archiduc Ferdinand, à Sarajevo, était un accident historique qui a servi de catalyseur au déclenchement des hostilités entre les grandes puissances. Mais ces hostilités étaient avant tout la conséquence des insurmontables contradictions économiques, politiques et militaires qui s’étaient accumulées, entre les grandes puissances européennes, avant 1914.
La philosophie marxiste
Ceci nous amène à la question centrale : la philosophie marxiste. Dans les écrits de Marx et Engels, on ne trouve pas de système philosophique comme celui de Hegel, mais toute une série d’idées et de remarques brillantes – qui, si elles étaient développées, seraient un ajout précieux à l’arsenal méthodologique de la science. Malheureusement, un tel travail n’a jamais été sérieusement entrepris.
Une difficulté se présente à quiconque souhaite étudier à fond le matérialisme dialectique. Malgré l’importance de ce sujet, il n’y a pas un seul livre de Marx et Engels qui le traite de manière exhaustive. Cependant, la méthode dialectique est en filigrane dans tous leurs écrits. Le meilleur exemple de l’application de la dialectique à un domaine particulier, en l’occurrence à l’économie politique, c’est Le Capital de Marx.
Longtemps, Marx a eu l’intention d’écrire un livre sur le matérialisme dialectique. Mais cela s’est avéré impossible à cause de son travail sur Le Capital. En plus de cette tâche monumentale, Marx a écrit de nombreux textes politiques. En outre, il s’est constamment engagé dans le mouvement ouvrier, et particulièrement dans la construction de l’Association Internationale des Travailleurs (la Première Internationale). Cela occupait chaque instant de sa vie, et même ce travail était fréquemment interrompu par des accès de maladie provoqués par ses conditions de vie misérables, une mauvaise alimentation et l’épuisement.
Engels envisagea d’écrire le livre sur la philosophie que son ami n’avait pu produire. Il nous a légué un héritage précieux d’écrits sur la philosophie marxiste, tels que Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, l’Anti-Dühring et la Dialectique de la Nature. Mais, malheureusement, Engels ne put, lui non plus, écrire un livre exhaustif sur la philosophie marxiste, pour différentes raisons.
Premièrement, l’émergence d’une tendance opportuniste à l’intérieur du Parti Social-Démocrate en Allemagne l’a forcé à abandonner ses recherches scientifiques pour écrire un ouvrage contre l’opportunisme, qui est devenu l’un des plus importants classiques du marxisme. Ce fut le célèbre Anti-Dühring qui, entre autres choses, contient une contribution de première importance sur la philosophie marxiste.
Plus tard, Engels retourna à ses études préparatoires pour un livre exhaustif sur la philosophie. Mais avec la mort de Marx, le 14 mars 1883, il fut de nouveau obligé de suspendre son travail pour se consacrer en priorité à la difficile tâche de mettre en ordre et de compléter les manuscrits des livres deux et trois du Capital, qui étaient inachevés.
Marx et Hegel
La philosophie dialectique a atteint son sommet dans la philosophie de l’idéaliste allemand Georg Hegel. Sa principale contribution fut de redécouvrir la dialectique, qui avait été inventée par les Grecs. Hegel l’a portée à de nouvelles hauteurs. Mais il l’a fait sur la base de l’idéalisme. Ce fut, selon les mots d’Engels, l’avortement le plus colossal de l’histoire. En lisant Hegel, on a la sensation qu’une grande idée lutte pour échapper à la camisole de force de la mystification idéaliste. On y trouve des idées extraordinairement profondes et des éclairs d’un grand génie, mais enfouis sous un tas d’absurdités idéalistes.
À maintes reprises, ce grand penseur fut très proche d’une position matérialiste. Mais il reculait toujours à la dernière minute. En conséquence, la philosophie hégélienne est insatisfaisante, contradictoire et incomplète. C’est à Marx et Engels qu’est revenue la tâche de porter la philosophie hégélienne à ses conclusions logiques – et, ce faisant, de la remplacer par quelque chose de qualitativement supérieur.
Hegel a mené la philosophie traditionnelle aussi loin que possible. Pour aller plus loin, elle devait sortir de ses propres limites, se niant elle-même au passage. La philosophie devait descendre du royaume nébuleux de la spéculation vers le monde réel des choses matérielles, des hommes et des femmes vivants, de l’histoire et des luttes réelles – bref, de tout ce dont elle avait été si longtemps séparée.
Le problème avec Feuerbach et d’autres hégéliens de gauche, comme Moses Hess, c’est qu’ils ont simplement dit « non » à Hegel, rejetant sa philosophie en bloc. Certes, le mouvement de Hess vers le matérialisme était audacieux. Il était courageux, en particulier dans le contexte réactionnaire de l’époque, en Europe, et face à l’État répressif prussien. Cela a donné de l’inspiration aux jeunes Marx et Engels. Mais au final, ce fut un échec.
On peut nier un grain de blé en l’écrasant sous son pied. Mais le concept dialectique de négation n’est pas une destruction complète ; il s’agit de nier tout en préservant, simultanément, ce qui mérite de l’être. Un grain de blé peut être nié en lui permettant de germer.
Hegel faisait remarquer qu’un mot dans la bouche d’un adolescent n’a pas le même poids que sur les lèvres d’un vieil homme, qui a accumulé une grande expérience. Il en va de même avec la philosophie. En retournant à son point de départ (en l’occurrence, à la dialectique), la philosophie ne répète pas simplement une étape depuis longtemps dépassée. Elle ne redevient pas puérile en retournant à sa prime enfance ; elle revient aux vieilles idées des Grecs ioniens, mais enrichie par 2000 ans d’histoire, de développement de la science et de la culture.
Ce n’est pas le mouvement mécanique d’une roue gigantesque, la simple répétition des mêmes étapes, comme ce processus sans fin de renaissance que l’on trouve dans certaines religions orientales. Il ne s’agit pas de cela. C’est la négation de la négation, le retour à une phase de développement antérieure, mais à un niveau qualitativement plus élevé. C’est la même chose – et ce n’est pas la même chose.
Bien qu’il soit parvenu à des conclusions profondes et importantes, s’approchant parfois du matérialisme (par exemple dans sa philosophie de l’Histoire), Hegel restait prisonnier de son idéalisme. Il n’est jamais parvenu à appliquer correctement sa méthode dialectique au monde réel de la société et de la nature, car pour lui le seul développement réel était celui du monde des idées.
La révolution philosophique de Marx
De toutes les théories de Marx, nulle n’a été plus attaquée et caricaturée que le matérialisme dialectique. Et ce n’est pas un hasard, c’est la base et le fondement du marxisme. Il s’agit, en gros, de la méthode du socialisme scientifique. Le marxisme est beaucoup plus qu’un programme politique et une théorie économique. C’est une philosophie, dont le champ couvre non seulement la politique et la lutte des classes, mais aussi toute l’histoire de l’humanité, l’économie, la société, la pensée et la nature.
Aujourd’hui, l’idéologie de la bourgeoisie est en pleine désintégration, non seulement dans les domaines de l’économie et de la politique, mais aussi en philosophie. Dans la période de son ascension, la bourgeoisie était capable de produire de grands penseurs tels que Hegel et Kant. Dans la période de son déclin sénile, elle ne produit rien de valable. Il est impossible de lire la philosophie académique officielle sans éprouver autant d’ennui que d’irritation.
La lutte contre le pouvoir de la classe dominante ne peut pas se limiter aux usines, à la rue, au Parlement et aux collectivités locales. Nous devons aussi mener la bataille sur le terrain idéologique, où l’influence de la bourgeoisie n’est pas moins pernicieuse et nuisible, bien qu’elle se cache derrière les apparences de l’impartialité et de l’objectivité. Le marxisme a le devoir de fournir une alternative globale à ces vieilles idées discréditées.
Le jeune Marx était très influencé par la philosophie hégélienne qui dominait les universités allemandes, à cette époque. Toute la doctrine de Hegel était basée sur l’idée d’un changement et d’un développement constants à travers des contradictions. De ce point de vue, elle représentait une véritable révolution en philosophie. C’est ce côté dynamique, révolutionnaire, qui a inspiré le jeune Marx et fut le point de départ de toutes ses idées.
Marx et Engels ont nié Hegel et transformé son système d’idées en son contraire. Mais ils l’ont fait en préservant tout ce qui était valable dans sa philosophie. Ils se sont basés sur le « noyau rationnel » des idées de Hegel ; ils ont porté ces idées à un niveau plus élevé, ont développé tout ce qui, en elles, était implicite.
Chez Hegel, la lutte réelle des forces historiques est exprimée sous la forme spéculative d’une lutte des idées. Mais comme l’expliquait Marx, les idées en tant que telles n’ont pas d’histoire et pas d’existence indépendantes. Dès lors, la réalité apparaît chez Hegel sous une forme mystique, aliénée. Chez Feuerbach, les choses ne sont pas beaucoup mieux, car l’Homme y apparaît aussi d’une manière unilatérale, idéaliste et irréelle. Les hommes et les femmes réels, historiques, ne sont appréhendés qu’avec l’avènement de la philosophie marxiste.
Avec Marx, la philosophie revient enfin à ses racines historiques. Elle est à la fois dialectique et matérialiste. La théorie et la pratique se réconcilient. La philosophie sort des bibliothèques poussiéreuses, étouffantes ; elle jouit du soleil et de l’air pur. Elle fait partie intégrante de la vie. À la place du débat obscur d’idées sans substance, nous avons les contradictions réelles de la société et du monde matériel. Au lieu d’un Absolu lointain et incompréhensible, nous avons les hommes et les femmes réels, vivant dans la société réelle, faisant l’histoire réelle et combattant dans des luttes réelles.
La dialectique apparaît dans l’œuvre de Hegel sous un aspect fantasmatique et mystique. Elle y est « la tête en bas », pour ainsi dire. Elle n’exprime pas les processus réels ayant cours dans la nature et dans la société, mais seulement un pâle reflet de ces processus dans les esprits des hommes, et en particulier ceux des philosophes. C’est pour cela qu’Engels, évoquant la philosophie hégélienne, parlait d’un « colossal avortement ».
Marx a su débarrasser la logique hégélienne de son mysticisme et en extraire le noyau dialectique. C’était une conquête philosophique majeure. Cette refondation matérialiste de la méthode dialectique marquait un authentique développement de la pensée.
Tandis que la philosophie de Hegel interprétait les choses du seul point de vue de l’esprit et de la pensée (donc d’un point de vue idéaliste), Marx montrait que le développement des idées, dans l’esprit des hommes, n’est qu’un reflet des développements à l’œuvre dans la nature et la société. Comme l’écrivait Marx : « La dialectique de Hegel est la forme basique de toute dialectique, mais seulement après avoir été débarrassée de sa forme mystique, et c’est précisément ce qui distingue ma méthode » (Lettre à Kugelmann, 6 mars 1868, MECW, Volume 42, p.543)
Qu’est-ce que la dialectique ?
Dans son brillant article sur L’ABC de la dialectique, Trotsky la définit ainsi : « La dialectique n’est ni une fiction ni une mystique, mais la science des formes de notre pensée, quand cette pensée ne se limite pas aux soucis de la vie quotidienne, mais tente d’appréhender des processus plus durables et plus complexes. La dialectique est à la logique formelle ce que, disons, les mathématiques supérieures sont aux mathématiques élémentaires. »
La combinaison de la méthode dialectique et du matérialisme a créé un outil analytique extrêmement puissant. Mais qu’est-ce que la dialectique ? Il est impossible, ici, d’exposer toutes les lois de la dialectique développées par Hegel et perfectionnées par Marx. J’ai tenté de le faire ailleurs, dans La Raison en Révolte : philosophie marxiste et sciences modernes, publié par Wellred Books. En quelques lignes, je peux seulement en dessiner les contours.
Dans son Anti-Dühring, Engels caractérise la dialectique comme suit : « La dialectique est simplement la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée ». Dans la Dialectique de la Nature, Engels esquisse les grandes lignes des principales lois de la dialectique : a) La loi de la transformation de la quantité en qualité. b) La loi de l’unité et de la lutte des contraires – et de la transformation de l’un en l’autre, quand ils sont poussés à l’extrême. c) La loi du développement à travers des contradictions – autrement dit, la négation de la négation.
Malgré son caractère inachevé et fragmentaire, la Dialectique de la Nature est un livre très important (comme l’Anti-Dühring) pour comprendre le marxisme. Bien sûr, Engels s’appuyait sur les connaissances et les découvertes scientifiques de son époque. En conséquence, certains aspects de ce livre ont un intérêt essentiellement historique. Inévitablement, certains faits et détails ont été dépassés par la marche de la science. Mais ce qui est étonnant, c’est le nombre d’idées avancées par Engels – souvent à contre-courant des théories scientifiques de son temps – qui ont été brillamment corroborées par la science moderne.
D’un bout à l’autre du livre, Engels met l’accent sur l’idée que la matière et le mouvement (nous parlons aujourd’hui d’énergie) sont indissociables. Le mouvement est le mode d’existence de la matière. Cette conception dynamique de la matière et de l’univers contient une vérité profonde qui était déjà comprise, ou plutôt devinée, par les premiers philosophes grecs, par exemple Héraclite. Pour ce dernier, « tout est et n’est pas, car tout est en mouvement ». Tout change constamment, vient au monde et disparaît.
Pour le sens commun, la masse d’un objet ne change jamais. Par exemple, une toupie, lorsqu’elle tourne, a le même poids que la même toupie à l’arrêt. Longtemps, la masse fut donc considérée comme constante, quelle que soit la vitesse. Mais plus tard, on a découvert que c’était faux. En fait, la masse augmente avec la vitesse, mais une telle augmentation n’est appréciable que dans les cas où la vitesse approche celle de la lumière. Pour les taches pratiques de la vie quotidienne, nous pouvons accepter que la masse d’un objet est constante quelle que soit sa vitesse de déplacement. Cependant, pour les très grandes vitesses, cette affirmation est fausse – et plus grande est la vitesse, plus fausse est l’affirmation.
En commentant cette loi, le Professeur Feynman écrit : « D’un point de vue philosophique (...), toute notre image du monde doit être modifiée, même si la masse ne change qu’un peu. Du point de vue de la philosophie, ou des idées, qui se tiennent derrière les lois, c’est un fait remarquable : même un petit effet exige parfois un profond changement dans nos idées... » (Richard P. Feynman, Le cours de physique de Feynman, ed. Addison Wesley 1963.)
Cet exemple souligne la différence fondamentale entre la mécanique élémentaire et la physique moderne. De même, il y a une grande différence entre les mathématiques élémentaires, utilisées pour les simples calculs quotidiens, et les mathématiques supérieures (le calcul intégral et différentiel), qu’Engels aborde dans l’Anti-Dühring et la Dialectique de la Nature.
La même différence existe entre la logique formelle et la dialectique. Pour la vie de tous les jours, les lois de la logique formelle sont plus que suffisantes. Cependant, pour les processus plus complexes, ces lois sont souvent inopérantes. Leur vérité limitée devient fausse.
Quantité et qualité
Du point de vue du matérialisme dialectique, l’univers matériel n’a ni commencement ni fin. Il consiste en une masse de matière (ou d’énergie) dans un état de mouvement constant. C’est l’idée fondamentale de la philosophie marxiste – et elle est totalement corroborée par les découvertes de la science moderne de ces 100 dernières années.
Prenez n’importe quel exemple de la vie quotidienne, n’importe quel phénomène apparemment stable. En réalité, il est dans un état de mouvement constant, bien que ce changement soit invisible au premier abord. Par exemple, un verre d’eau : « à nos yeux, nos yeux grossiers, rien ne change, mais si nous pouvions le voir agrandi un milliard de fois, nous verrions que de ce point de vue il est toujours changeant : des molécules quittent la surface, des molécules y reviennent. » (Richard P. Feynman, Le cours de physique de Feynman, ed. Addison Wesley 1963.)
Ces mots ne sont pas ceux d’Engels, mais ceux d’un scientifique renommé, le Professeur Richard P. Feynman, qui enseignait la physique théorique à l’Institut de Technologie de Californie. Ce même auteur reprend le célèbre exemple que donne Engels pour illustrer la loi de la transformation de la quantité en qualité.
L’eau est composée d’atomes d’hydrogène et d’oxygène dans un état de mouvement constant. Si l’eau ne se disloque pas en ses différents composants, c’est en raison de l’attraction mutuelle de ses molécules. Cependant, si elle est chauffée à 100 °C à pression atmosphérique normale, elle atteint un point critique où la force d’attraction entre les molécules est insuffisante ; celles-ci se séparent, soudainement.
Cet exemple peut sembler trivial, mais il a des conséquences extrêmement importantes pour la science et l’industrie. C’est un élément d’une branche très importante de la physique moderne : l’étude des « transitions de phase ». La matière peut exister dans quatre phases (ou états) : solide, liquide, gaz et plasma, plus quelques autres phases extrêmes, comme les fluides critiques et les gaz dégénérés.
Généralement, lorsqu’un solide est chauffé (ou lorsque la pression diminue), il se change en liquide, puis finalement en gaz. Par exemple, la glace (de l’eau gelée) se change en liquide lorsqu’elle est chauffée. Quand l’eau bout, elle s’évapore et se transforme en vapeur. Mais si la vapeur est chauffée à très haute température, une transition de phase supplémentaire apparaît. À 11 726,85 °C, la vapeur se transforme en plasma.
C’est ce que le marxisme appelle la transformation de la quantité en qualité : un grand nombre de petits changements quantitatifs finissent par produire un saut qualitatif – une « transition de phase ». On peut donner des exemples à volonté : si l’on rafraîchit une substance telle que le plomb ou le niobium, il y a une réduction graduelle de sa résistance électrique, et ce jusqu’à une température critique (en général quelques degrés au-dessus de -273 °C). À ce point précis, toute résistance disparaît soudainement. Il y a une sorte de « saut quantique », une transition entre une petite résistance et l’absence totale de résistance.
On peut trouver un nombre illimité d’exemples semblables dans toutes les sciences naturelles. Le scientifique américain Mark Buchanan a écrit un livre très intéressant intitulé Ubiquity. Dans ce livre, il donne une longue série d’exemples : crises cardiaques, feux de forêt, avalanches, croissance et chute des populations animales, crises boursières, guerres – et même les changements dans les différentes modes et écoles artistiques (j’ajouterais les révolutions à cette liste).
Toutes ces choses semblent n’avoir aucun rapport entre elles, mais elles sont soumises à la même loi, qui peut être exprimée par une équation mathématique connue sous le nom de loi de puissance. Cela correspond, dans la terminologie marxiste, à la loi de la transformation de la quantité en qualité. Et ce que montre le livre de Buchanan, c’est que cette loi est omniprésente, qu’elle est à l’œuvre à tous les niveaux de l’univers. C’est une loi universelle de la nature, comme le soulignait Engels.
Dialectique versus empirisme
« Donnez-nous des faits ! » Cette exigence impérieuse semble être le summum du réalisme pragmatique. Qu’y a-t-il de plus solide que les faits ? Seulement voilà : ce genre de « réalisme » (ou d’empirisme) a de sérieuses limites. Des faits établis à un moment donné peuvent ne plus l’être du tout à un autre moment. Tout est dans un état de changement permanent ; tôt ou tard, toute chose se change en son contraire. Ce qui paraissait solide comme le roc s’évapore dans l’air.
La méthode dialectique nous permet de pénétrer au-delà des apparences et de voir les processus à l’œuvre sous la surface. La dialectique est la science des interconnexions universelles. Elle est une conception dynamique et exhaustive des phénomènes et des processus. Elle analyse les choses dans leurs relations, et non séparément ; dans leur mouvement, et non statiquement ; dans leur vie, et non dans leur mort.
La dialectique permet de se libérer de l’adoration servile des faits établis, qui est la caractéristique principale de la pensée empirique (et superficielle). En politique, l’empirisme est typique du réformisme, qui cherche à masquer son conservatisme, sa myopie et sa lâcheté derrière le langage philosophique du pragmatisme, du « réalisme » – et ainsi de suite.
La dialectique nous permet d’aller au-delà de l’évident, de l’immédiat, c’est-à-dire du monde des apparences – et de découvrir les processus qui sont à l’œuvre sous la surface. Nous insistons sur le fait que derrière les apparences de calme et d’absence de mouvement, il y a un processus de changement moléculaire. Cela vaut non seulement en physique, mais aussi dans la société et dans la psychologie des masses.
Avant 2008, la plupart des gens pensaient que le boom économique allait durer éternellement. C’était – ou cela semblait être – un fait incontestable. Ceux qui en doutaient étaient considérés comme des excentriques égarés. Mais désormais, cette « vérité incontestable » est en ruine. Les faits se sont transformés en leur contraire. Ce qui semblait une vérité indiscutable s’avère n’être qu’un mensonge. Pour citer Hegel : « la raison devient déraison ».
Grâce à cette méthode dialectique il y a plus d’un siècle, Friedrich Engels fut capable de voir plus loin que la plupart des scientifiques de son époque. Il a anticipé nombre de découvertes de la science moderne. Engels n’était pas un scientifique professionnel, mais il avait une connaissance assez large des sciences naturelles de son époque. En s’appuyant sur une profonde compréhension de la méthode dialectique, il a fait de très importantes contributions à l’interprétation philosophique des sciences – bien qu’elles échappent toujours à l’écrasante majorité des scientifiques contemporains.
Bien sûr, la philosophie ne peut pas dicter les lois des sciences naturelles. Ces lois peuvent être développées uniquement sur la base d’une analyse sérieuse et rigoureuse de la nature. Le progrès de la science est caractérisé par une série d’approximations. À travers l’expérience et l’observation, nous nous approchons toujours plus de la vérité, sans être jamais capables de connaître toute la vérité. C’est un processus sans fin de pénétration toujours plus profonde des secrets de la matière et de l’univers. La vérité des théories scientifiques peut être établie uniquement à travers la pratique, l’observation et l’expérience – et non par les commandements des philosophes.
La plupart des questions que les philosophes ont débattues, par le passé, ont été résolues par la science. Néanmoins, ce serait une grave erreur de supposer que la philosophie n’a pas de rôle à jouer. Deux aspects de la philosophie demeurent valides aujourd’hui, car ils n’ont pas été absorbés par les différentes branches de la science : la logique formelle et la dialectique.
Engels insistait sur le fait que « la dialectique, débarrassée du mysticisme, devient une nécessité absolue » pour la science. La dialectique, bien sûr, n’a pas de propriété magique permettant de résoudre les problèmes de la physique moderne. Néanmoins, une philosophie exhaustive et cohérente serait d’une aide inestimable pour guider l’investigation scientifique dans des directions plus prometteuses et l’empêcher de tomber dans toutes sortes d’hypothèses arbitraires et mystiques qui ne mènent nulle part. Bien des problèmes auxquels se heurte la science moderne viennent précisément du fait qu’il manque à celle-ci des solides fondations philosophiques.
La dialectique et la science
Beaucoup de scientifiques traitent la philosophie avec mépris. Concernant la philosophie moderne, ce mépris est bien mérité. Depuis un siècle et demi, le champ de la philosophie ressemble à un désert aride parsemé de quelques traces de vie. Les grandes philosophies du passé, avec leurs éclairs de génie, semblent un lointain souvenir. On cherche en vain, dans la philosophie moderne, une source d’illumination.
Mais à y regarder de plus près, le mépris des scientifiques pour la philosophie en général n’est pas fondé. Si on étudie sérieusement l’état de la science moderne, ou plus précisément les bases théoriques de ses recherches et hypothèses, on constate que la science ne s’est jamais libérée de la philosophie. Chassée sans cérémonie par la porte, la philosophie revient en catimini par la fenêtre.
Les scientifiques qui revendiquent fièrement leur indifférence à l’égard de la philosophie font en réalité toutes sortes d’hypothèses ayant un caractère philosophique. Et en fait, cette espèce de philosophie inconsciente et dépourvue d’esprit critique n’est pas supérieure à l’ancienne ; elle lui est très inférieure. En outre, elle est la source de beaucoup d’erreurs.
Les avancées remarquables de la science moderne semblent avoir rendu la philosophie obsolète. Dans un monde où nous pouvons pénétrer les plus profonds mystères du cosmos et suivre les mouvements complexes des particules subatomiques, les vieilles questions qui ont absorbé l’attention des philosophes ont été résolues. En conséquence, le rôle de la philosophie en a été réduit. Cependant, au risque de nous répéter, il y a deux domaines où la philosophie garde son importance : la logique formelle et la dialectique.
La publication, en 1962, du livre remarquable de T.S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, fut une avancée majeure dans l’application de la méthode dialectique à l’histoire des sciences. Ce livre démontre l’inéluctabilité des révolutions scientifiques et révèle le mécanisme approximatif de leur avènement. « Tout ce qui existe mérite de périr » : cette affirmation est valable non seulement pour les organismes vivants, mais aussi pour les théories scientifiques, y compris celles que nous tenons aujourd’hui pour absolument valides.
À vrai dire, Engels est allé beaucoup plus loin que ses contemporains (y compris la plupart des scientifiques) dans son approche des sciences de la nature. Il n’a pas seulement expliqué que le mouvement (l’énergie) est inséparable de la matière ; il a aussi expliqué que la différence entre les sciences consistait seulement dans l’étude de différentes formes d’énergie. Enfin, il a souligné la transition dialectique d’une forme d’énergie à une autre (les « transitions de phase », selon la terminologie actuelle).
Toute l’évolution de la science au XXe siècle a rejeté le vieux cloisonnement des différentes sciences. La transition dialectique d’une science à une autre est désormais reconnue. De leur vivant, Marx et Engels ont provoqué la grande indignation de leurs opposants lorsqu’ils ont affirmé que la différence entre la matière organique et la matière inorganique est toute relative. Ils ont expliqué que la matière organique – les premières organisations vivantes – surgissait de la matière inorganique à un moment donné, ce qui représentait un saut qualitatif dans l’évolution. Ils soulignaient que les animaux, y compris l’homme et son esprit, ses idées, ses croyances, étaient simplement de la matière organisée d’une certaine manière.
La différence entre l’organique et l’inorganique, que Kant considérait comme une barrière insurmontable, a été éliminée, comme Feynman le souligne : « Tout est constitué d’atomes. C’est l’hypothèse centrale. Par exemple, la plus importante des hypothèses de la biologie est que tout ce que font les animaux, les atomes le font. En d’autres termes, il n’y a pas d’action d’une chose vivante qui ne puisse être comprise à partir du fait que cette chose est constituée d’atomes agissant conformément aux lois de la physique. » (Richard P. Feynman, Le cours de physique de Feynman.)
D’un point de vue scientifique, les hommes et les femmes sont des agrégats d’atomes organisés d’une certaine manière. Mais nous ne sommes pas seulement des agrégats d’atomes. Le corps humain est un organisme extraordinairement complexe, en particulier le cerveau, dont nous commençons seulement à comprendre la structure et le fonctionnement. C’est quelque chose de beaucoup plus beau et merveilleux que tous les vieux contes de fées de la religion.
Pendant que Marx réalisait une révolution dans le domaine de l’économie politique, Darwin faisait de même dans le domaine de la biologie. Les travaux de Darwin ont suscité une tempête d’indignation et d’incompréhension, mais ont été immédiatement reconnus par Marx et Engels comme une pièce maîtresse de la dialectique – bien que Darwin lui-même ignorait la dialectique. L’explication de cet apparent paradoxe est que les lois de la dialectique ne sont pas une invention arbitraire ; elles sont le reflet de processus effectivement à l’œuvre dans la nature et la société.
Les découvertes de la génétique ont révélé le mécanisme exact qui détermine la transformation d’une espèce en une autre. Le génome humain a donné une nouvelle dimension au travail de Darwin, en montrant que les êtres humains partagent des gènes non seulement avec la modeste drosophile, mais même avec la forme de vie la plus basique, la bactérie. Dans les toutes prochaines années, les scientifiques parviendront à créer la vie en laboratoire, à produire un organisme vivant à partir de matière inorganique. Le dernier brin d’herbe sera coupé sous les pieds du Divin Créateur, rendu complètement inutile.
Longtemps, les scientifiques ont débattu pour savoir si la création de nouvelles espèces était le résultat d’une longue période d’accumulation de changements lents – ou le résultat d’un changement soudain et violent. D’un point de vue dialectique, il n’y a pas de contradiction entre ces deux hypothèses. Une longue période de changements moléculaires (changements quantitatifs) atteint un point critique où ils produisent soudainement ce qu’on appelle aujourd’hui un quantum leap (un « bond en avant »).
Marx et Engels estimaient que la théorie de l’évolution des espèces était une preuve claire du fait que la nature travaille d’une manière dialectique, c’est-à-dire à travers un développement et des contradictions. Il y a trente ans, ce point de vue a été puissamment stimulé par une institution aussi prestigieuse que le British Museum, où un vif débat a éclaté. L’un des arguments contre l’idée d’un saut qualitatif dans la chaîne de l’évolution, c’était qu’une telle idée représentait une infiltration marxiste au sein du British Museum !
Cependant, la biologie moderne a été obligée, malgré elle, de corriger la vieille idée d’une évolution graduelle, linéaire, ininterrompue, sans changements abrupts – et d’admettre l’existence de sauts qualitatifs, caractérisés par l’extinction de masse de certaines espèces et l’émergence de nouvelles. Le 17 avril 1982, dans un article publié à l’occasion du centenaire de la mort de Darwin, The Economist écrivait : « Il sera de plus en plus clair que d’assez petites mutations affectant ce qui se passe à une étape clé du développement peuvent causer des changements évolutionnaires majeurs (par exemple, un petit changement dans le mode opératoire de certains gènes peut mener à une augmentation significative de la taille du cerveau). Des indices s’accumulent montrant que de nombreux gènes subissent une mutation lente, mais constante. Ainsi, petit à petit, les scientifiques résolvent les controverses actuelles pour savoir si les espèces changent lentement et continuellement sur de grandes périodes, ou restent inchangées pendant longtemps puis connaissent une évolution rapide. Les deux types de changements sont probablement à l’œuvre. »
La vieille version de la théorie évolutionniste (le gradualisme phylogénétique) affirmait que les espèces ne changent que graduellement, à travers des mutations génétiques individuelles qui survivent à la sélection naturelle. Cependant, une nouvelle théorie a été mise en avant par Stephen Jay Gould et Niles Eldridge : la « théorie des équilibres ponctués ». D’après cette théorie, les changements génétiques peuvent passer par des bonds soudains (des ruptures qualitatives). Accessoirement, Stephen Jay Gould a souligné que si les scientifiques avaient prêté attention à ce qu’Engels avait écrit sur les origines de l’humanité, ils se seraient épargné un siècle d’égarements.
La faillite de nations entières
La première phase de la crise qui a éclaté en 2008 était caractérisée par le défaut de paiements de grosses banques. Le système bancaire des États-Unis et du reste du monde a été uniquement sauvé par l’injection de milliards de dollars et d’euros à partir des caisses des États. Dès lors, la question se pose : que reste-t-il de la vieille idée selon laquelle l’État « ne doit pas interférer dans les rouages de l’économie » ?
L’injection massive d’argent public n’a rien résolu. La crise n’a pas été résolue. Elle a simplement été transférée sur les États. À la place d’un déficit massif des banques, nous avons un trou noir dans les finances publiques : c’est tout. Qui paiera ? Les banquiers nantis qui, après avoir provoqué la ruine de l’ordre financier mondial, ont calmement empoché l’argent public – tout en s’attribuant de faramineux « bonus » ?
Bien sûr que non ! Les déficits dont se plaignent avec amertume les économistes et les politiciens doivent être payés par les sections les plus pauvres et les plus fragiles de la société. Soudainement, il n’y a plus d’argent pour les vieux, les malades et les chômeurs, alors qu’il y en a toujours plein pour les banquiers. Ceci implique un régime d’austérité permanent. Mais cela crée simplement de nouvelles contradictions. En minant la demande, on réduit davantage le marché, et donc on aggrave la crise de surproduction.
Quoi que disent les politiciens sur la nécessité de résorber les déficits, les dettes qui ont été contractées ne pourront pas être remboursées. La Grèce en fournit un exemple clair. L’avenir sera fait de crises plus profondes, d’une chute continue des niveaux de vie, d’ajustements douloureux et d’une croissance de la pauvreté. C’est la recette idéale pour de nouveaux bouleversements et une intensification de la lutte des classes. Il s’agit d’une crise systémique et mondiale du système capitaliste.
Quelques sophistes demandent : si le socialisme est « inévitable », pourquoi devrait-on lutter pour qu’il advienne ? En fait, il est possible d’être un déterministe convaincu tout en étant activement engagé dans une activité révolutionnaire. Au XVIIe siècle, les calvinistes étaient absolument déterministes. Ils croyaient avec ferveur à la prédestination. Ils pensaient que le destin et le salut de chaque homme et chaque femme étaient déterminés avant leur naissance. Néanmoins, ce déterminisme inébranlable ne les a pas empêchés de jouer un rôle révolutionnaire majeur dans la lutte contre le féodalisme décadent et sa principale expression idéologique, l’Église catholique romaine. Précisément parce qu’ils étaient persuadés de la justesse et du triomphe inévitables de leur cause, ils ont courageusement combattu pour hâter sa victoire.
La vieille société pourrit sur pied pendant qu’une nouvelle société lutte pour venir au monde. Mais ceux qui s’enrichissent sur le capitalisme n’accepteront jamais l’inéluctabilité de sa fin. La classe dominante aimerait mieux entraîner toute la société dans le gouffre plutôt que renoncer à son pouvoir et ses privilèges. La prolongation de l’agonie du capitalisme constitue une menace mortelle pour la culture humaine et la civilisation. Notre tâche est d’aider à la naissance de la nouvelle société, de faire en sorte qu’elle advienne le plus rapidement et le moins douloureusement possible, à moindres frais pour l’humanité.
Contrairement aux calomnies de nos ennemis, les marxistes ne préconisent pas la violence. Mais nous sommes réalistes et savons que l’histoire de ces dix mille dernières années prouve qu’aucune classe ou caste dirigeante n’a jamais abandonné sa richesse, son pouvoir et ses privilèges sans combattre, ce qui implique en général une lutte où tous les coups sont permis. Et cela reste vrai aujourd’hui.
C’est le déclin du capitalisme qui menace de déchaîner la violence la plus terrible. Pour mettre fin au chaos et à la guerre, pour assurer une transition vers le socialisme la plus pacifique et ordonnée possible, la condition préalable est que la classe ouvrière soit mobilisée pour la lutte et prête à combattre jusqu’au bout.
« Tous les chemins mènent à la ruine »
Il y a peu, on nous présentait l’image rassurante d’un système capitaliste garantissant à tous un avenir prospère. Mais aujourd’hui, nous faisons face à un monde dans lequel des millions souffrent de la pauvreté et de la faim, pendant que les super-riches deviennent chaque jour plus riches. Les gens vivent dans la peur constante de l’avenir, qui sera façonné non par des décisions rationnelles, mais par les soubresauts chaotiques du marché.
Les crises financières, le chômage de masse et les bouleversements politiques et sociaux constants remettent beaucoup de choses en question. Ce qui apparaissait comme solide et permanent disparaît brutalement. Les gens commencent à remettre en cause des choses qu’ils avaient toujours tenues pour acquises. Cette situation d’instabilité permanente est le terreau psychologique des révolutions, qui deviennent la seule option réaliste.
Tout le monde sait que le système capitaliste est en crise. Mais quelle est la solution ? Si le capitalisme est un système anarchique et chaotique qui entre fatalement en crise, alors on doit conclure que pour en finir avec les crises, il faut en finir avec le capitalisme lui-même. Si vous dites « A », vous devez aussi dire « B », « C » et « D ». Mais c’est précisément ce que refusent de faire les économistes bourgeois.
N’y a-t-il aucun mécanisme qui, en théorie, permet aux bourgeois de sortir d’une crise de surproduction ? Bien sûr qu’il y en a ! Une méthode consiste à baisser les taux d’intérêt pour augmenter les marges de profit et stimuler l’investissement. Mais les taux d’intérêt sont déjà proches de zéro. Réduisez-les davantage et vous aurez des taux d’intérêt négatifs : les banques paieront les gens pour qu’ils leur empruntent de l’argent ! C’est complètement fou – et pourtant c’est en discussion. Cela montre qu’ils commencent à désespérer.
L’autre méthode consiste à accroître les dépenses publiques. C’est ce que préconisent les keynésiens et les réformistes de gauche. Remarquons, déjà, que cette idée souligne la faillite de l’économie de marché. Le secteur privé est tellement faible, décrépit, en faillite au sens littéral du terme, qu’il doit s’appuyer sur l’État comme un cul-de-jatte sur ses béquilles. Cependant, même cette « solution » n’en est plus une.
C’est un fait indéniable que les banques et les gros monopoles dépendent désormais des États pour leur survie. Dès qu’ils sont en difficulté, les mêmes qui insistaient pour que l’État ne joue aucun rôle dans l’économie se précipitent vers le gouvernement en tendant les mains, exigeant d’énormes sommes d’argent. Et les gouvernements leur ont immédiatement donné des chèques en blanc. Des milliers de milliards de dollars d’argent public ont été distribués aux banques : autour de 14 000 milliards de dollars, au total. Mais la crise continue de s’approfondir.
Ces quatre dernières années, les dettes massives des banques ont été transformées en dettes massives des États. Voilà tout ce qui a été accompli. Pour sauver les banques, tout le monde est appelé à faire des sacrifices. Par contre, aucun sacrifice n’est demandé aux banquiers et aux capitalistes. Ils s’octroient eux-mêmes de généreux bonus avec l’argent du contribuable. C’est Robin des bois à l’envers.
Du fait de ces immenses dettes publiques, l’argument des keynésiens sur l’augmentation des dépenses publiques s’écroule sous son propre poids. Comment l’État pourrait-il dépenser l’argent qu’il n’a pas ? La seule voie qui lui reste, c’est l’impression de monnaie ou, pour utiliser l’euphémisme d’usage, « l’assouplissement quantitatif ». Mais l’injection de grandes quantités de capital fictif dans l’économie est sujette à la loi des rendements décroissants – que connaissent les toxicomanes : ils doivent s’injecter sans cesse de plus grandes quantités de drogue pour obtenir le même effet. Au passage, cela empoisonne leur organisme et mine leur santé.
Cette mesure désespérée conduira tôt ou tard à une augmentation de l’inflation – et prépare une récession encore plus profonde que la précédente. Le fond du problème, c’est que le système capitaliste est allé très au-delà de ses limites. Pour retarder l’avènement d’une récession, ces dernières décennies, les gouvernements ont épuisé les mécanismes dont ils ont besoin pour sortir de la crise actuelle. C’est pour cela que la crise est si profonde et si difficile à résoudre. Comme l’expliquait Marx, ce que font les capitalistes pour résoudre la crise consiste « à préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. » (Manifeste du parti communiste)
Il y a longtemps, l’Église avait coutume de dire : « Tous les chemins mènent à Rome ». De nos jours, la bourgeoisie a une nouvelle devise : « Tous les chemins mènent à la ruine ». Il est impensable qu’une crise qui jette le monde entier dans le chaos, qui condamne des millions de gens au chômage, à la pauvreté et au désespoir, qui vole l’avenir des jeunes et détruit la santé publique, le logement, l’éducation et la culture, ne finisse pas par produire une crise sociale et politique. Partout, la crise du capitalisme prépare les conditions de révolutions.
Ce n’est d’ailleurs plus une hypothèse théorique. C’est un fait. Prenons juste les douze derniers mois (entre juin 2012 et juin 2013) : que voyons-nous ? Des mouvements révolutionnaires ont éclaté dans un pays après l’autre : Tunisie, Égypte, Grèce, Espagne. Même aux États-Unis, nous avons le mouvement Occupy et, avant cela, il y a eu les manifestations de masse dans le Wisconsin.
Ces événements spectaculaires sont une expression claire du fait que la crise du capitalisme a des répercussions massives à l’échelle mondiale – et qu’un nombre croissant de gens commencent à tirer des conclusions révolutionnaires. Aussi longtemps qu’une minuscule minorité contrôlera la terre, les banques et les grandes entreprises, elle prendra les décisions fondamentales qui affectent nos vies et nos destinées.
Le fossé intolérable qui s’est creusé entre les riches et les pauvres met la cohésion sociale à rude épreuve. Les bases du vieux rêve social-démocrate de paix entre les classes se sont effondrées. C’est ce qu’a bien résumé le mouvement Occupy Wall Street : « La chose que nous avons tous en commun, c’est que nous sommes les 99 % qui ne tolérerons plus l’avarice et la corruption des 1 %. »
Certes, le mouvement de protestation actuel est confus, dans ses objectifs. Il lui manque un programme cohérent et une direction audacieuse. Mais il reflète une humeur générale de colère qui se renforce et qui, tôt ou tard, doit trouver une issue. Ces mouvements sont clairement anticapitalistes. À terme, dans un pays ou un autre, la question du renversement révolutionnaire du capitalisme sera posée.
Une menace pour la culture ?
Marx expliquait que le capitalisme a présidé au développement des forces productives le plus spectaculaire de l’histoire. Cependant, même à son époque la plus révolutionnaire, les idées de la bourgeoisie étaient en retard par rapport aux progrès dans la production, de la technologie et de la science.
Le contraste entre le rapide développement de la technologie et de la science, d’une part, et, d’autre part, le retard dans le développement de l’idéologie humaine – ce contraste est flagrant dans le pays le plus riche du monde : les États-Unis. La science y a débouché sur des réalisations technologiques spectaculaires. Or le progrès constant de la technologie est la condition préalable à l’émancipation de l’homme, à l’abolition de la pauvreté, de l’illettrisme et de l’ignorance. C’est la condition de la domination de l’homme sur la nature à travers la planification consciente de l’économie. La voie est ouverte à de nouvelles conquêtes, non seulement sur terre, mais aussi dans l’espace. Et pourtant, dans la première puissance mondiale, dans ce pays à la pointe de la technologie, les superstitions les plus primitives règnent en maîtres. Neuf Américains sur dix croient en l’existence d’un être suprême – et sept sur dix croient qu’il y a une vie après la mort.
Le jour de Noël 1968, lorsque le premier homme qui a volé autour de la Lune s’adressa au peuple américain depuis son vaisseau spatial, il a choisi de citer le premier livre de la Genèse. Alors qu’il fonçait à toute allure à travers l’espace, dans un vaisseau spatial bourré des gadgets les plus modernes, il prononça ces mots : « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ».
Darwin est mort il y a plus de 130 ans. Néanmoins, beaucoup d’Américains pensent que chaque mot de la Bible est littéralement juste – et souhaitent que les écoles enseignent le récit de la Genèse sur les origines de l’humanité, en lieu et place de la théorie de l’évolution basée sur la sélection naturelle. Dans une tentative de rendre le créationnisme plus respectable, ses partisans l’ont renommé « dessein intelligent ». Une question surgit immédiatement : qui a conçu le concepteur intelligent de ce dessein ? À cette question très raisonnable, ils n’ont aucune réponse. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi leur « concepteur intelligent » a fait un travail aussi bâclé, lorsqu’il a créé le monde.
Pourquoi avoir conçu un monde avec le cancer, la peste bubonique, le sida, les menstruations et les migraines ? Pourquoi avoir conçu les chauves-souris vampires, les sangsues et les banquiers d’affaires ? Pourquoi nos gènes sont-ils majoritairement constitués d’inutile camelote ? Notre « concepteur intelligent » s’avère ne l’être pas beaucoup. Pour citer Alphonse le Sage, Roi de Castille (1221-1284) : « Si j’avais été présent lors de la Création, j’aurais donné quelques indices utiles pour un meilleur ordre de l’univers ». En effet, même un enfant de onze ans aurait sans doute accompli un meilleur travail.
Il est vrai que l’autorité de l’Église décline dans tous les pays occidentaux. Le nombre de pratiquants décroît. Dans des pays comme l’Espagne et l’Irlande, l’Église a du mal à recruter de nouveaux prêtres. La fréquentation des messes a connu un net recul, en particulier chez les jeunes. Cependant, le déclin de l’Église s’est accompagné d’une prolifération de sectes religieuses plus bizarres les unes que les autres – et d’une floraison de mysticismes et de superstitions en tous genres. L’astrologie – ce vestige de la barbarie médiévale – redevient à la mode. Le cinéma, la télévision et les maisons d’édition produisent quantité d’œuvres saturées du mysticisme le plus éhonté.
Ces phénomènes sont les symptômes de la putréfaction d’un système social qui se survit, qui a cessé d’être une force progressiste et qui est définitivement entré en conflit avec les besoins de développement des forces productives. En ce sens, la lutte de la classe ouvrière pour euthanasier la société bourgeoise à l’agonie est aussi une lutte pour protéger et sauvegarder les accomplissements de la science et de la culture, qui sont menacés par une barbarie croissante.
L’alternative à laquelle fait face l’humanité est claire : soit la transformation socialiste de la société, l’élimination du pouvoir économique et politique de la bourgeoisie et l’inauguration d’une nouvelle ère dans le développement de la civilisation humaine ; soit la destruction de cette civilisation – et même de toute vie. Les écologistes et les Verts se plaignent constamment de la dégradation de l’environnement – et nous avertissent de la menace que cela constitue pour l’humanité. Ils ont raison. Mais ils font penser à un docteur inexpérimenté qui repère des symptômes, mais s’avère incapable de diagnostiquer la maladie et de suggérer le bon traitement.
La dégénérescence du système se manifeste à tous les niveaux : non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans les domaines de la morale, de la culture, de l’art, de la musique et de la philosophie. La survie du capitalisme se solde par une destruction massive de forces productives, mais elle sape aussi la culture, alimente la démoralisation et la lumpenisation (« déclassement ») de couches entières de la société, avec des conséquences désastreuses. À un certain stade, l’existence du capitalisme entrera en conflit avec le maintien des droits démocratiques et syndicaux de la classe ouvrière.
Le développement du crime et de la violence, la pornographie, l’égoïsme bourgeois, l’indifférence à la souffrance des autres, le sadisme, la désintégration de la famille, l’effondrement de la morale traditionnelle, la toxicomanie, l’alcoolisme – toutes ces choses qui provoquent l’indignation des réactionnaires ne sont, au fond, que des symptômes de la dégénérescence du capitalisme. Des phénomènes semblables avaient accompagné le déclin de la société esclavagiste, sous l’Empire romain.
Le système capitaliste place le profit au-dessus de toute autre considération, quitte à empoisonner l’air, l’eau et la nourriture. Les scandales récents sur la falsification massive de viande produite en Europe ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Si nous permettons aux grosses banques et monopoles de régner cinq décennies de plus, par exemple, il est tout à fait possible que la destruction de la planète atteigne un stade où les dégâts irréversibles menaceraient l’existence même de l’humanité. La lutte pour changer de société est donc une question de vie ou de mort.
La nécessité d’une économie planifiée
Ces deux dernières décennies, nous avons été constamment nourris d’une propagande proclamant que l’idée d’une économie socialiste planifiée était morte – et que le « marché », laissé à lui-même, résoudrait le problème du chômage, tout en créant un monde de paix et de prospérité.
Suite au krach de 2008, la vérité commence à émerger : l’ordre établi n’est pas capable de satisfaire les besoins humains les plus élémentaires de la grande majorité de la population (et pas seulement dans le tiers-monde) : un emploi, un salaire décent, un logement, des services de santé et une éducation de qualité, des retraites convenables, un environnement sain, de l’air et de l’eau propres.
Un tel système ne peut qu’être condamné par tous les gens qui réfléchissent et ne sont pas aveuglés par le déferlement constant d’arguments fallacieux, dont l’unique objectif est de défendre les intérêts personnels de ceux qui profitent du système actuel et ne peuvent pas voir – ou ne veulent pas voir – qu’il n’est pas éternel.
Le point central du Manifeste du parti communiste – et l’essence de son message révolutionnaire – est précisément que le capitalisme n’est pas éternel. C’est ce que les apologistes du système actuel trouvent le plus difficile à avaler. Naturellement ! Au cours de l’histoire, chaque système socio-économique engendre la même illusion qu’il représente le tout dernier mot du progrès social. Pourtant, le simple bon sens permet d’en douter. Si tout change dans la nature, pourquoi en irait-il autrement des sociétés ?
Le système capitaliste a épuisé son rôle progressiste. Toute personne intelligente comprend que le libre développement des forces productives exige l’unification des économies de tous les pays sur la base d’un plan commun. Cela permettrait l’exploitation harmonieuse des ressources de notre planète, au bénéfice de tous.
C’est tellement évident que c’est reconnu par des scientifiques et des experts qui n’ont rien à voir avec le socialisme, mais qui s’indignent des conditions de vie cauchemardesques des deux tiers de l’humanité – et s’inquiètent de la destruction de l’environnement. Malheureusement, leurs recommandations tombent dans des oreilles de sourds, car elles entrent en contradiction avec les intérêts privés des grandes multinationales qui dominent l’économie mondiale et dont les calculs ne sont pas basés sur le bien-être de l’humanité ou l’avenir de la planète, mais uniquement sur l’avarice et la recherche du profit.
Même s’ils ne peuvent pas l’admettre, certains bourgeois comprennent la supériorité économique de la planification sur l’anarchie capitaliste. En 1940, lorsque les armées d’Hitler ont écrasé la France, les capitalistes de Grande-Bretagne avaient le dos au mur. Qu’ont-ils fait ? Est-ce qu’ils ont dit : « Laissons les forces du marché décider » ? Non ! Ils ont centralisé l’économie, nationalisé des industries essentielles et introduit un large contrôle gouvernemental, y compris sur l’organisation du travail. Pourquoi ont-ils opté pour la centralisation et la planification ? Parce qu’elle donne de meilleurs résultats.
Bien sûr, un véritable plan de production est impossible sous le capitalisme. Néanmoins, les éléments de planification introduits par la coalition de Churchill, pendant la guerre, furent essentiels pour vaincre Hitler. L’Union Soviétique en offre un exemple encore plus frappant. La Deuxième Guerre mondiale, en Europe, se ramenait au final à un gigantesque conflit entre l’Allemagne de Hitler (qui disposait des ressources d’une grande partie de l’Europe) et l’Union Soviétique.
C’est l’Union Soviétique qui a vaincu les armées de Hitler. Les apologistes du capitalisme ne peuvent pas reconnaître la raison de cette extraordinaire victoire. Mais elle est indéniable. L’économie planifiée et nationalisée a donné à l’URSS un énorme avantage. Malgré la politique criminelle de Staline, qui a mené l’URSS au bord du gouffre au début de la guerre, l’Union Soviétique fut capable de se ressaisir rapidement et de reconstruire ses capacités industrielles et militaires.
Les Russes furent capables de démanteler leurs industries de l’Ouest (1500 usines et un million de travailleurs), de les mettre sur des trains et de les envoyer à l’est de l’Oural, hors de portée des Allemands. En l’espace de quelques mois, l’Union Soviétique fut capable de produire davantage de tanks, d’artillerie et d’avions que les Allemands. Cela démontre de manière irréfutable l’énorme supériorité d’une économie planifiée et nationalisée, même sous le régime bureaucratique de Staline.
L’URSS a perdu 27 millions d’individus dans la Seconde Guerre mondiale, soit la moitié du nombre total de victimes. Ses industries et son agriculture ont subi une terrible dévastation. Et pourtant, en l’espace de dix ans, tout a été reconstruit – et sans bénéficier des quantités massives d’argent déversées en Europe occidentale par les Américains via le Plan Marshall. C’est l’URSS – et non l’Allemagne ou le Japon – qui représente le véritable miracle économique de l’après-guerre.
Bien sûr, le socialisme authentique doit être basé sur la démocratie : pas la frauduleuse démocratie formelle qui existe en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où n’importe qui peut dire ce qu’il veut du moment que les grandes banques et les monopoles décident de tout ; mais une démocratie reposant sur le contrôle et l’administration de la société par les travailleurs eux-mêmes.
Il n’y a rien d’utopique dans l’idée de planification. Elle est basée sur ce qui existe déjà. Prenons juste un exemple. La façon dont un grand supermarché comme Tesco peut calculer précisément la quantité de sucre, de pain et de lait nécessaire pour un quartier de Londres comptant des dizaines de milliers d’habitants est une source inépuisable d’étonnement pour l’auteur de ces lignes. Ils ont recours à une planification scientifique qui n’échoue jamais. Si la planification peut fonctionner pour un grand supermarché, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas à l’échelle de toute la société ?
Socialisme et internationalisme
Quiconque lit le Manifeste du parti communiste constatera que Marx et Engels y avaient anticipé la situation actuelle. Ils y expliquaient que le capitalisme se développerait nécessairement comme un système mondial. Cette analyse a été brillamment confirmée par les événements. Aujourd’hui, personne ne peut nier la domination écrasante du marché mondial. C’est d’ailleurs le phénomène le plus décisif de notre époque.
Pourtant, quand le Manifeste fut écrit, il n’y avait pratiquement aucune donnée empirique pour soutenir cette hypothèse. La seule économie capitaliste véritablement développée était l’Angleterre. Les industries naissantes de France et d’Allemagne (cette dernière n’existant même pas comme entité unifiée) restaient protégées par de lourdes barrières douanières – un fait qui est « oublié », aujourd’hui, par les gouvernements et les économistes occidentaux qui donnent des leçons magistrales au reste du monde sur la nécessité d’« ouvrir les économies ».
Ces dernières décennies, les économistes ont beaucoup vanté la « mondialisation ». Ils s’imaginaient que c’était la panacée permettant d’abolir complètement le cycle croissance-récession. Ces rêves ont été brisés par l’effondrement de 2008. Et cela a de profondes implications pour le reste du monde : cela montre le revers de la « mondialisation ». À mesure que le système capitaliste développe l’économie mondiale, il prépare les conditions d’une récession globale dévastatrice. Une crise qui éclate dans une partie de l’économie mondiale s’étend rapidement à toutes les autres. Loin d’abolir le cycle croissance-récession, la mondialisation lui a donné un caractère plus convulsif et universel que jamais.
Le problème fondamental est le système lui-même. Marx écrivait : « Le véritable obstacle à la production capitaliste est le capital lui-même » (Le Capital, vol. 3, partie III). Les économistes qui soutenaient que Marx avait tort et qu’il n’y aurait plus de crises du capitalisme (grâce au « nouveau paradigme économique ») se sont trompés. La « reprise » actuelle a tous les aspects du cycle économique décrit il y a longtemps par Marx. Le processus de concentration du capital a atteint des proportions stupéfiantes. Il y a une gabegie de fusions-acquisitions et une monopolisation toujours plus importante. Mais cela ne mène plus au développement des forces productives. Au contraire, les usines ferment comme s’il s’agissait de boîtes d’allumettes et des milliers de gens sont précipités dans le chômage.
Les théories économiques du monétarisme – la Bible du néo-libéralisme – furent résumées par John Kenneth Galbraith de la manière suivante : « les pauvres ont trop d’argent, les riches pas assez. » Des profits inédits s’accompagnent d’inégalités inédites. The Economist soulignait que « la seule tendance véritablement continue de ces 25 dernières années a été une plus grande concentration des plus hauts revenus. »
Une toute petite minorité possède des richesses obscènes, pendant que la part des travailleurs dans le revenu national est constamment réduite et que les plus pauvres sombrent dans une misère toujours plus profonde. L’ouragan Katrina, en 2005, a révélé au monde entier l’existence d’une sous-classe de citoyens américains vivant dans les conditions du tiers-monde.
Aux États-Unis, les travailleurs produisent 30 % de plus qu’il y a dix ans, mais les salaires ont à peine augmenté. Le tissu social se délite de plus en plus. Les tensions dans la société augmentent énormément, même dans les pays les plus riches du monde. Cela prépare de puissantes explosions de la lutte des classes.
Ce n’est pas seulement vrai aux États-Unis. Dans le monde entier, la croissance s’accompagne d’un chômage élevé. Les réformes et les concessions passées sont remises en cause. Par exemple, pour redevenir compétitive sur les marchés mondiaux, l’Italie devrait licencier 500 000 travailleurs et infliger une baisse des salaires de 30 % aux autres (selon The Economist).
Pendant un certain temps, le capitalisme est parvenu à surmonter ses contradictions en développant le commerce mondial (la mondialisation). Pour la première fois de l’histoire, le monde entier fut intégré au marché mondial. Les capitalistes ont trouvé des marchés et de nouvelles sources d’investissements en Chine et dans d’autres pays. Mais tout cela a atteint ses limites. Les capitalistes américains et européens ne sont plus aussi enthousiastes à l’égard de la mondialisation et du libre-échange, car des montagnes de produits chinois bon marché s’empilent désormais devant leurs portes. Au Sénat américain, les partisans du protectionnisme deviennent de plus en plus insistants. Le Cycle de Doha sur le commerce mondial a été suspendu ; les contradictions sont si grandes qu’aucun accord n’est possible.
La fragile croissance économique en cours s’essouffle déjà. La croissance de la consommation aux États-Unis est basée sur des taux d’intérêt relativement faibles et sur une vaste extension du crédit et de la dette. Ces facteurs se transformeront en leur contraire. Une nouvelle crise se prépare à l’échelle mondiale. La mondialisation se manifeste comme une crise mondiale du capitalisme.
N’y a-t-il pas d’alternative ?
Les économistes bourgeois sont tellement bornés qu’ils s’accrochent au système capitaliste même lorsqu’ils sont forcés d’admettre qu’il est en phase terminale et condamné à s’effondrer. S’imaginer que l’espèce humaine est incapable de découvrir une alternative viable à ce système pourri, corrompu, dégénéré, est franchement une insulte à l’humanité.
Est-il vrai qu’il n’y a pas d’alternative au capitalisme ? Non, ce n’est pas vrai. L’alternative est un système reposant sur la production pour satisfaire les besoins du grand nombre, et non pour le profit de quelques-uns ; un système qui remplace le chaos et l’anarchie du marché par une planification harmonieuse, qui remplace la domination d’une minorité de parasites richissimes par la domination de la majorité, celle qui produit toutes les richesses de la société. Le nom de cette alternative est le socialisme.
On peut ergoter sur les mots, mais le nom de ce système est le socialisme – qui n’est pas la caricature bureaucratique et totalitaire qui existait dans la Russie stalinienne. Le socialisme est une démocratie authentique basée sur la propriété, le contrôle et la gestion des forces productives par la classe ouvrière. Cette idée est-elle si difficile à comprendre ? Est-il vraiment utopique de suggérer que l’espèce humaine peut prendre son destin en main et faire fonctionner la société sur la base d’un plan de production démocratique ?
La nécessité d’une économie socialiste planifiée n’est pas une invention de Marx ou de quelque autre penseur. Elle découle d’une nécessité objective. La possibilité d’un monde socialiste découle des conditions actuelles du capitalisme lui-même. Tout ce qu’il faut, c’est que la classe ouvrière, qui constitue l’écrasante majorité du corps social, prenne en main le fonctionnement de la société, exproprie les banques, les grandes entreprises – et mobilise le vaste potentiel de production inutilisé pour résoudre les problèmes de la société.
Marx écrivait : « Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir. » (Karl Marx, Préface à la Contribution à la critique de l’économie politique). Les conditions objectives de la création d’une forme d’humanité nouvelle et plus élevée ont déjà été créées par le développement du capitalisme. Au cours des 200 dernières années, le développement de l’industrie, de l’agriculture, de la science et de la technologie s’est accompli à une vitesse et avec une intensité sans précédent. Marx l’expliquait ainsi : « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l’ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. » (Manifeste du parti communiste)
Ces lignes de Marx sont d’une évidente actualité. Les solutions aux problèmes auxquels nous faisons face existent déjà. Au cours des deux derniers siècles, le capitalisme a développé une puissance productive colossale. Mais il est incapable d’utiliser à fond ce potentiel. La crise actuelle n’est qu’une manifestation du fait que l’industrie, la science et la technologie se sont développées à un tel point qu’elles se heurtent, désormais, aux limites étroites de la propriété privée et de l’État-nation.
Le développement des forces productives, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, a été sans précédent dans l’histoire : l’énergie nucléaire, la microélectronique, les télécommunications, les ordinateurs, les robots industriels, etc., ont entraîné un accroissement spectaculaire de la productivité du travail, inimaginable du vivant de Marx. Cela nous donne une idée très claire de ce qui serait possible sous le socialisme, sur la base d’une économie socialiste planifiée à l’échelle mondiale. La crise actuelle est simplement l’expression de la révolte des forces productives contre les limites étouffantes du système capitaliste. Une fois l’industrie, l’agriculture, la science et la technologie libérées de ces limites, les forces productives seront capables de satisfaire tous les besoins humains, sans aucune difficulté. Pour la première fois dans l’histoire, l’humanité sera libre de réaliser son plein potentiel. Une réduction générale du temps de travail fournira la base matérielle d’une authentique révolution culturelle. La culture, l’art, la musique, la littérature et la science s’élèveront de sommets en sommets toujours plus hauts.
La seule voie
Il y a vingt ans, Francis Fukuyama parlait de la « fin de l’histoire ». Mais l’histoire n’est pas terminée. En fait, la véritable histoire de notre espèce ne commencera que lorsque nous aurons mis fin à l’esclavage de la société de classe et commencé à prendre le contrôle de nos vies. C’est ce qu’est réellement le socialisme : le passage de l’humanité « du règne de la nécessité au règne de la liberté » (Engels).
En cette deuxième décennie du XXIe siècle, l’espèce humaine est à la croisée des chemins. D’un côté, les accomplissements de la science et de la technologie nous ont fourni les moyens de résoudre les problèmes auxquels l’humanité a été confrontée tout au long de son histoire. Nous pouvons éradiquer les maladies, l’illettrisme, la misère – et faire fleurir les déserts.
Mais d’un autre côté, la réalité semble se moquer de ces rêves. Les découvertes de la science sont utilisées pour produire des armes de destruction massive toujours plus monstrueuses. Partout, il y a la pauvreté, la faim, l’illettrisme et la maladie. La souffrance humaine est omniprésente. Des richesses obscènes côtoient la misère. Nous pouvons envoyer un homme sur la lune, mais chaque année huit millions de personnes meurent parce qu’elles n’ont pas assez d’argent pour vivre. 100 millions d’enfants naissent, vivent et meurent dans les rues, sans jamais avoir eu de toit au-dessus de leur tête.
L’aspect le plus frappant de la situation actuelle est le chaos et l’agitation qui ont saisi la planète entière. Il y a de l’instabilité à tous les niveaux : économique, social, politique, diplomatique et militaire.
Le monde semble être devenu fou. La plupart des gens se détournent avec dégoût de cette barbarie. Mais cette réaction est inutile et contre-productive. Le marxisme nous enseigne que l’histoire n’est pas dénuée de sens. La situation actuelle n’est pas l’expression de la folie ou de la cruauté des hommes et des femmes. Le grand philosophe Spinoza écrivait : « il ne faut pas rire ou pleurer, mais comprendre ! » C’est un bon conseil, car si nous ne sommes pas capables de comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous ne serons jamais capables de le changer.
Quand Marx et Engels ont écrit le Manifeste du parti communiste, ils étaient deux jeunes hommes de 29 et 27 ans. Ils écrivaient dans une période de réaction massive. La classe ouvrière semblait apathique. Le Manifeste lui-même a été écrit à Bruxelles, où ses auteurs avaient été obligés de fuir, comme réfugiés politiques. Et pourtant, lorsque le Manifeste fut édité pour la première fois, en février 1848, la révolution avait éclaté dans les rues de Paris et, les mois suivants, se répandait comme une traînée de poudre à travers l’Europe.
Après la chute de l’Union Soviétique, les défenseurs du vieil ordre jubilaient. Ils parlaient de la fin du socialisme et même de la fin de l’histoire. Ils promettaient une nouvelle ère de paix, de prospérité et de démocratie grâce aux miracles de l’économie de marché. À peine quinze ans plus tard, ces rêves ne sont plus qu’un tas de décombres fumants. Il ne reste plus rien de ces illusions.
Quelle est la signification de tout ceci ? Nous sommes les témoins de la douloureuse agonie d’un système social qui ne mérite pas de vivre, mais qui refuse de mourir. C’est l’explication réelle des guerres, du terrorisme, de la violence et du chaos qui caractérisent notre époque. Mais nous sommes aussi les témoins de l’accouchement douloureux d’une nouvelle société – d’une société juste, d’un monde taillé pour les hommes et les femmes qui y vivent. Dans un pays après l’autre, une nouvelle force se dresse : la force révolutionnaire des travailleurs, des paysans et de la jeunesse. À l’ONU, le Président du Venezuela Hugo Chavez avertissait que « le monde se réveille. Et les peuples se lèvent ».
Ces mots expriment une vérité profonde. Des millions de gens commencent à réagir. Les manifestations massives contre la guerre en Irak, en 2002 et 2003, avaient poussé des millions de personnes dans les rues. Cela indiquait le début d’un réveil. Mais le mouvement manquait d’un programme cohérent pour changer la société. C’était sa grande faiblesse.
Les cyniques et les sceptiques ont eu leur heure. Il est temps de les écarter de notre chemin et de faire avancer la lutte. La nouvelle génération veut combattre pour son émancipation. Elle cherche une bannière, une idée et un programme pouvant l’inspirer et la mener à la victoire. Il ne peut s’agir que de la lutte pour le socialisme à une échelle mondiale. Karl Marx avait raison : l’espèce humaine doit choisir entre socialisme et barbarie.