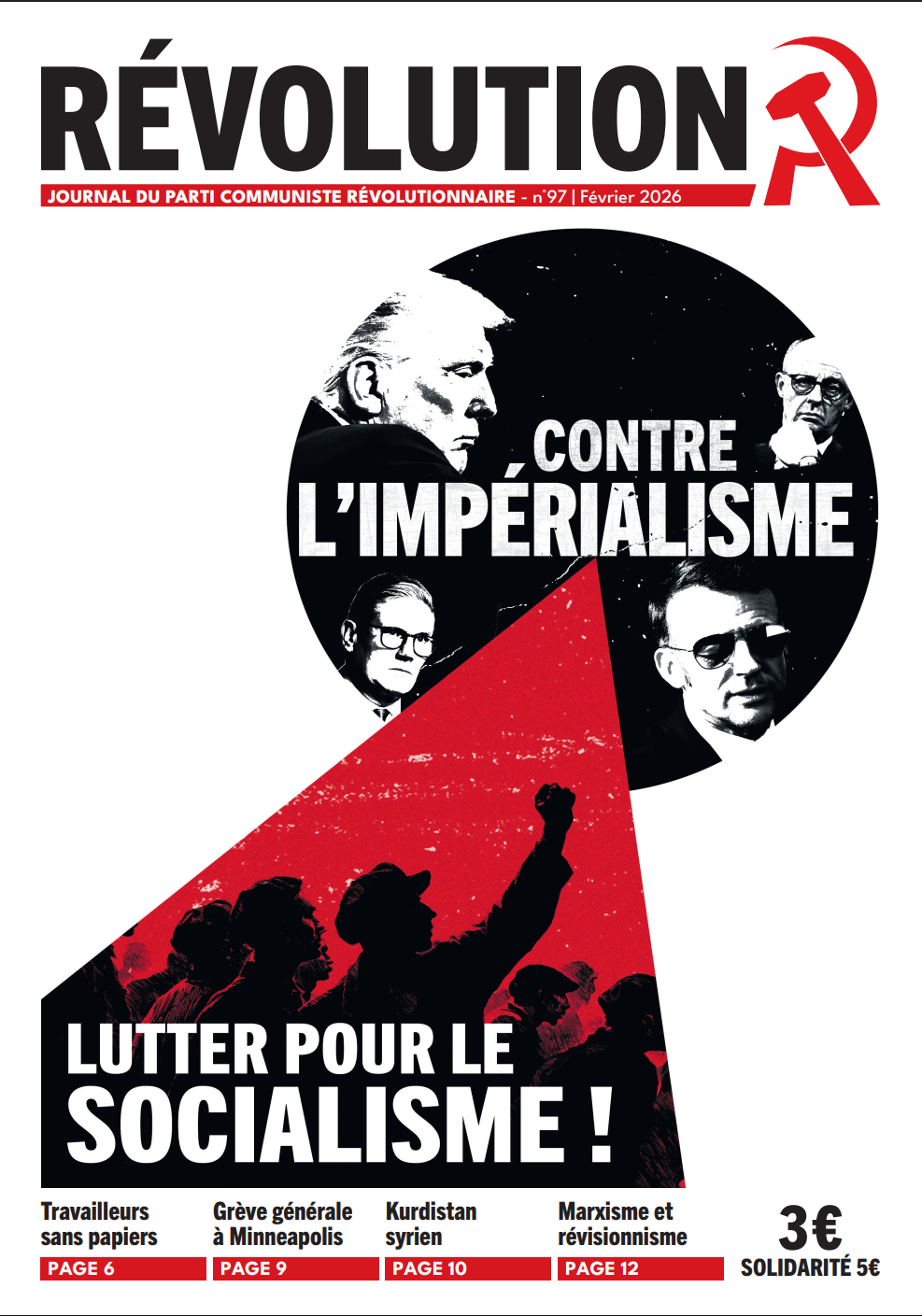Chaque année, pendant trois semaines, l’attention du monde sportif se tourne vers Roland-Garros. Les exploits des joueurs sont acclamés, tandis que diverses personnalités en profitent pour entretenir leur image publique. Mais dans l’ombre du spectacle, plus de 10 000 travailleurs embauchés via diverses agences d’intérim font tourner la machine : agents d’entretien, agents de sécurité, employés de restauration… et environ 1200 hôtes et hôtesses d’accueil. J’étais l’une d’elles.
Une journée épuisante
Les hôtes et hôtesses d’accueil étaient répartis sur l’ensemble du site. Peu importait notre poste, une exigence s’imposait à tous : rester debout toute la journée. J’avais la « chance » d’avoir un parasol à proximité. Beaucoup n’en avaient pas et passaient leurs journées – qui duraient parfois de 9 h à 21 h – debout en plein soleil. Car les matchs n’ont pas d’heure de fin fixe. C’est un atout du point de vue du spectacle, mais un calvaire pour nous.
Notre chef d’équipe nous a confié que les malaises étaient fréquents. Comment pourrait-il en être autrement lorsque notre travail consiste à rester debout, sans bouger, jusqu’à 40 degrés en plein soleil ? La seule solution que notre agence a apportée fut de nous donner une gourde… Fournir un parasol à tous les hôtes et hôtesses ? Non. Diminuer le temps de travail ? Non… une gourde !
Pour nos deux pauses quotidiennes, il était interdit de s’asseoir sur les bancs du site. Mon agence s’était vue attribuer une salle de repos… mais elle se trouvait à plus de dix minutes de marche de certains emplacements. Résultat : plusieurs collègues restaient debout à côté de leur poste. Ce qui, convenons-en, n’a rien d’une pause. Rester debout en plein soleil, qu’on soit « en pause » ou en service… expliquez-moi la différence !
Et pour certains, envoyés par d’autres agences, c’était pire : ils n’avaient pas de salle de repos du tout. Ils devaient quitter le site pour espérer trouver un endroit où s’asseoir. Vers la fin du tournoi, des sièges ont commencé à apparaître mystérieusement près de nos emplacements. D’après un collègue, c’était une précaution au cas où l’inspection du travail passe : il s’agissait de faire semblant de respecter nos droits. Mais, dans tous les cas, nous n’avions pas le droit de les utiliser.
Faire « bonne figure »
L’exigence de rester debout ne répondait à aucun besoin réel. Nous aurions très bien pu nous asseoir. D’ailleurs, nous avons tous été frappés par l’inutilité de notre tâche. L’aide qu’on rendait aux visiteurs était minime. En cas de réel besoin, la consigne était seulement de les diriger vers le service client. C’était encore plus évident pour ceux qui étaient placés à côté des bornes automatiques de scan des billets, qui fonctionnaient sans la moindre intervention humaine. Ou pour ceux dont la seule tâche consistait à ouvrir et fermer des portails.
Même aux accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR), comme celui auquel j’étais assignée, les visiteurs se débrouillaient souvent seuls ou étaient déjà accompagnés. Et, en cas de réel problème, ce n’était pas la « formation » que j’avais reçue qui allait faire la différence : elle consistait uniquement à se faire pousser assis sur un fauteuil roulant, ou à porter un bandeau sur les yeux pour « vivre l’expérience du handicap ».
Nous étions là surtout pour la décoration : dire bonjour, sourire, incarner une image polie et présentable à destination du public – généralement aisé – de Roland-Garros. D’où le rouge à lèvres obligatoire, ou les cheveux longs obligatoirement plaqués et attachés. Pour pouvoir enlever notre veste, il fallait que nous votions et que nous appliquions tous la décision majoritaire. Cela n’avait rien à voir avec une quelconque démocratisation de nos conditions de travail, sinon nous aurions tous voté pour avoir le droit de nous asseoir ! Non, il s’agissait uniquement de s’assurer que notre apparence soit totalement uniforme, sans doute pour satisfaire les goûts esthétiques de la riche clientèle.
Division et exploitation
Tous mes collègues avaient entre 18 et 25 ans, la majorité travaillait là pour aider à financer leurs études – comme moi. Quand on se croisait entre travailleurs, on échangeait toujours au moins quelques mots sur la difficulté du travail et pour se souhaiter bon courage.
Mais le processus d’embauche réparti à travers de nombreuses agences, avec chacune ses propres employés, espaces et chefs d’équipe, était très utile pour les organisateurs : cela nous maintenait divisés en petits groupes isolés, incapables de vraiment discuter collectivement de nos conditions de travail et d’exprimer notre colère. Autre avantage pour les organisateurs : chaque agence se trouvait dans l’obligation de « bien faire », sous peine de perdre son contrat l’année suivante. Cette pression s’exerçait sur nos chefs d’équipe et se répercutait ensuite sur nous.
Pour nous faire garder le sourire malgré nos conditions de travail, on nous a fait une promesse durant la formation : un billet pour Roland-Garros 2026 serait offert au travailleur le plus investi. Mais même cette modeste carotte ne s’est finalement pas concrétisée.