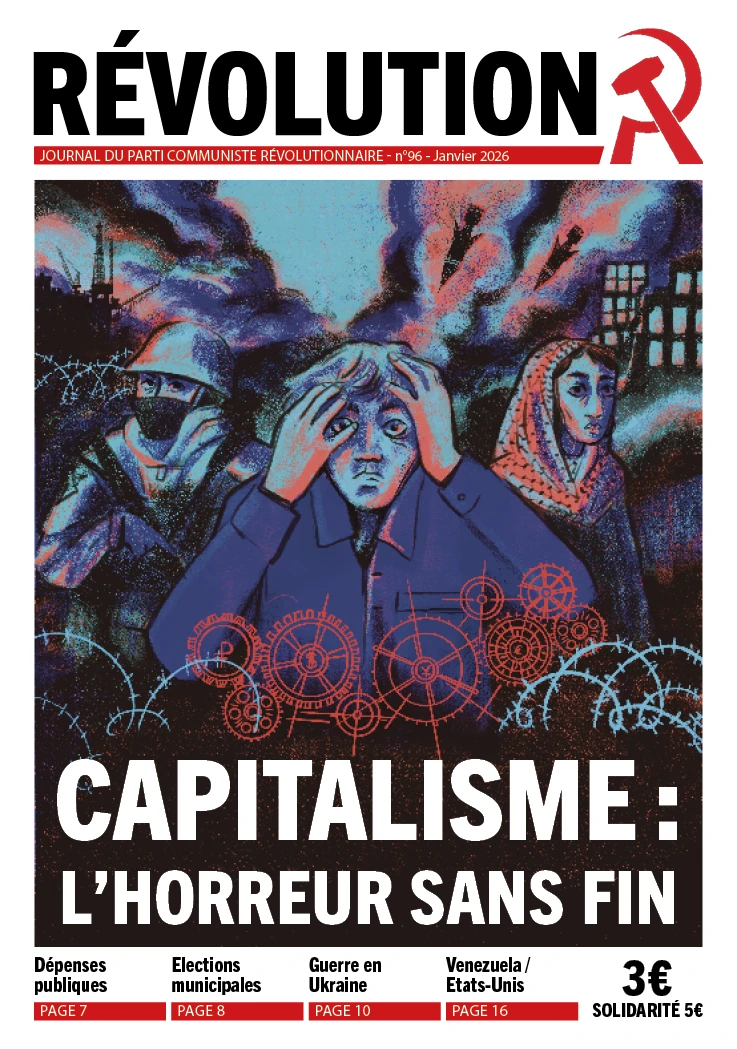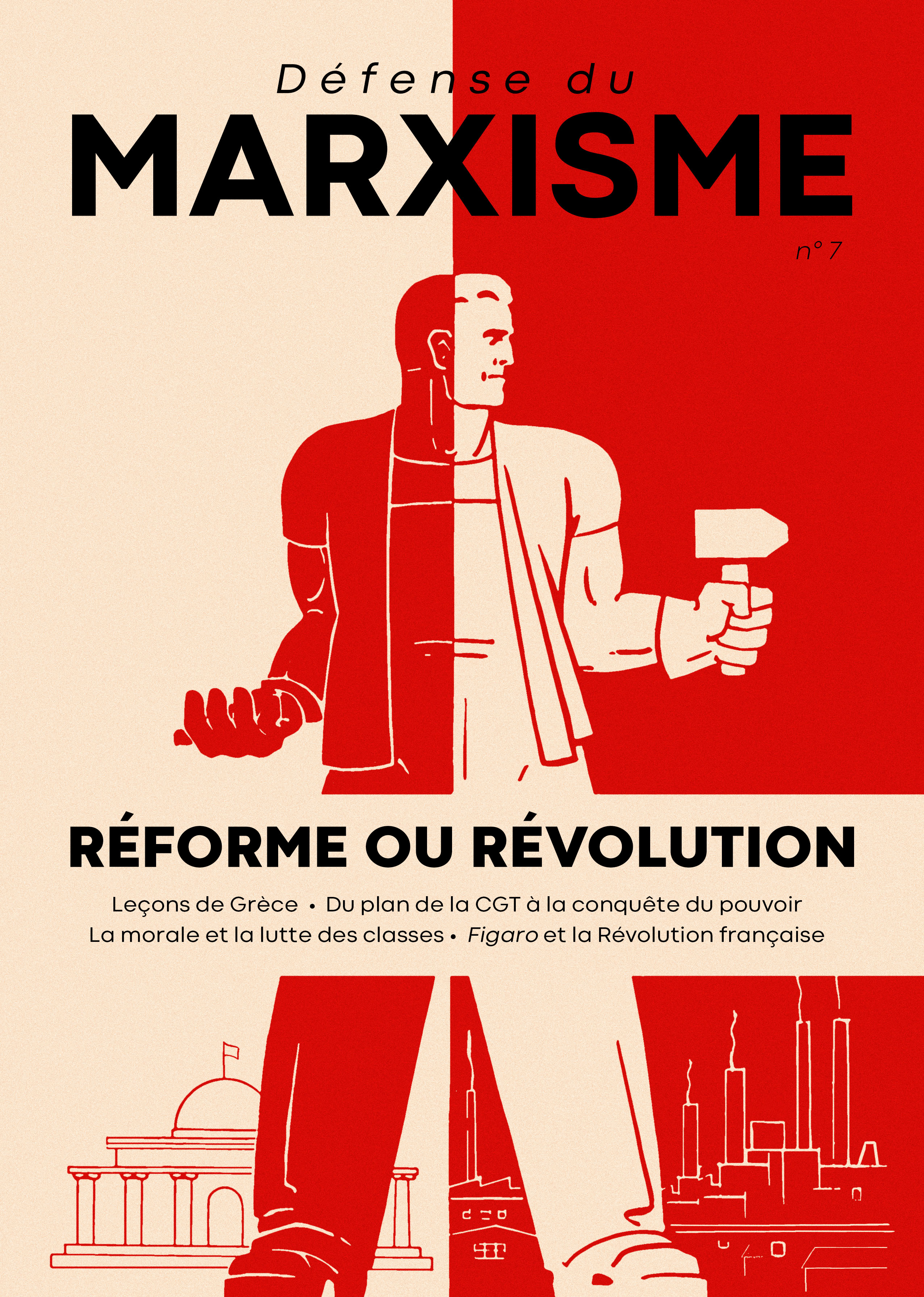Cet article a été écrit le 29 septembre. Depuis, le président Rajoelina a renvoyé le gouvernement, dans l’espoir que cela calme le mouvement. Il n’en a rien été. Le 30, le syndicat des travailleurs de l’eau et de l’électricité a annoncé son soutien au mouvement et appelé ses membres à se mettre en grève. C’est la voie à suivre. La classe ouvrière doit passer à l’action.
Ce qui avait commencé comme une journée de mobilisation pacifique de la jeunesse malgache, le 25 septembre dernier, s’est conclu par une répression brutale, des affrontements avec la police et pas moins de 22 morts. Le gouvernement a déclaré un couvre-feu dans plusieurs grandes villes, sans pour autant freiner l’ampleur des protestations.
Le mouvement « Leo délestages » (Marre des délestages) a été lancé sur les réseaux sociaux par des jeunes organisés autour du collectif « Gen Z Madagascar » pour protester contre les coupures quotidiennes d’électricité et d’eau. Ce collectif a tout de suite adopté le drapeau pirate du manga One Piece, devenu le symbole de la révolte internationale de la jeunesse.
Comme en Indonésie, au Népal, aux Philippines et au Timor-Oriental, le mouvement rejette tous les politiciens et les institutions et dénonce les inégalités énormes qui séparent les élites de la majorité de la population (79 % des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque Mondiale). C’est une génération entière qui est privée de toute perspective d’avenir.
La plupart des manifestants sont des étudiants des grandes villes, notamment de la capitale Antananarivo. On peut lire sur leurs banderoles des slogans comme « Nous sommes pauvres, en colère et malheureux », « Madagascar est à nous » ou bien encore « Jeunesse, lève-toi ! ».
Répression brutale
Les organisateurs insistent depuis le début du mouvement sur le caractère pacifique de la mobilisation. Mais le gouvernement y a répondu par une répression brutale : les manifestations ont été interdites dès mi-septembre et tous les rassemblements spontanés ont été violemment réprimés. Des vidéos circulent montrant un policier armé d’un fusil d’assaut AK-47 tirant à balles réelles, en pleine rue.
Pour faire face à cette répression meurtrière, les manifestants ont attaqué des policiers et mis en place des barricades.
Bien qu’il soit difficile d’établir un bilan humain exact, à l’heure où nous écrivons, l’ONU dénombre 22 morts, dont un étudiant de la ville portuaire d’Antsiranana, au nord du pays. Des étudiants expliquent : « Nous n’avons pas d’armes et sommes restés dans le campus le jeudi 25 septembre, mais ils sont venus ici pour nous attaquer. Notre camarade n’avait rien dans les mains. Il était dans la rue, pourtant on lui a tiré dessus. Cet acte est condamnable. Pour le respect de notre ami, nous n’allons pas céder. La lutte continue jusqu’à ce que la justice soit faite. » (Midi Madagasikara, 27 septembre)
Durant la nuit du 25 septembre, plusieurs bâtiments ont été incendiés, dont les maisons de trois parlementaires proches du gouvernement.
Depuis, la protestation s’est propagée de la capitale Antananarivo vers toutes les grandes villes, dont Antsiranana, Majunga, Tuléar, Tamatave et Antsirabé. Le pouvoir y a répondu par un couvre-feu.
Vendredi soir, le président Rajoelina, un homme d’affaires au pouvoir depuis 16 ans, était plongé dans une profonde panique. Cherchant à reprendre le contrôle de la situation par un mélange de répression et de concessions, il a dénoncé le mouvement comme une « tentative de coup d'Etat » tout en limogeant le ministre de l’Energie. Mais cela n’a pas réussi à freiner le mouvement.
Le dimanche 28 septembre au soir, le mouvement publiait même une déclaration exigeant des excuses publiques immédiates et des explications de la part du gouvernement pour la répression brutale du 25 septembre mais aussi la démission du gouvernement du Premier ministre Ntsay Christian dans les 72 heures et celle du préfet de la capitale Antananarivo dans les 24 heures, ainsi que la garantie de la liberté de manifester et la libération de toutes les personnes arrêtées pendant les manifestations. Cette déclaration exigeait également que toute discussion avec le mouvement se déroule dans un espace ouvert et non au parlement ou dans le palais présidentiel.
Cette déclaration montre la détermination des jeunes à poursuivre la mobilisation malgré la répression et constitue un défi lancé au gouvernement. Cependant, dans son dernier point, cette déclaration montre aussi clairement le caractère confus du mouvement, lorsqu'elle appelle « TOUTES LES FORCES ACTIVES du territoire de la République de Madagascar, les associations, la société civile, le secteur privé, les influenceurs, les chefs religieux, les syndicats, les fonctionnaires, les POLITICIENS, les élus, les fonctionnaires nommés et tous les citoyens à se joindre à nous pour toutes ces revendications légitimes. »
Comment peut-on faire appel à la fois aux syndicats de travailleurs et au « secteur privé » (c’est-à-dire aux patrons) ? Les premiers souffrent de la pauvreté et du manque d'accès aux services de base, tandis que les seconds exploitent les travailleurs et tirent profit de leur pauvreté. Leurs intérêts ne sont pas les mêmes, et ils ne peuvent donc pas être réunis.
De leur côté, les dirigeants du Conseil des Eglises chrétiennes de Madagascar ont fait un appel le 26 septembre pour appeler au dialogue et condamner la violence… des manifestants ! Ils n’ont même pas mentionné la répression déchaînée par l’appareil d’Etat. Les sommets de l'Église montrent de quel côté de la barricade ils se trouvent.
De leur coté, les syndicats des services de santé ont menacé d’une grève générale sous 48 heures si leurs revendications n’étaient pas entendues. Madagascar a de fortes traditions syndicales, notamment parmi les enseignants, les soignants, les dockers, et les travailleurs de l'électricité.
Pour renverser Rajoelina, la jeunesse malgache doit s’organiser. Il faut créer des comités de base dans tous les quartiers, et chercher à mobiliser les travailleurs, les paysans et les masses pauvres qui sympathisent avec le mouvement. Ces comités permettraient d’organiser l’auto-défense du mouvement contre la répression de la police.
Ce lundi 29 septembre, à l’appel des syndicats étudiants, une grève étudiante nationale a été lancée. Les étudiants ont appelé à porter du noir, en signe de deuil pour les martyrs du mouvement. Dès 9 heures du matin, des milliers de personnes se sont réunies sur les campus des grandes villes en chantant l’hymne national. La police les a ensuite brutalement attaquées.
L’héritage de l’impérialisme
Ce sont les coupures d'électricité, durant parfois plus de 12 heures, qui sont à l'origine de ces manifestations. Les problèmes qui touchent Jirama (la compagnie publique des réseaux d’électricité et d’eau) sont aggravés par la corruption. Cependant, ce problème n'est qu'un symptôme de la crise générale du capitalisme à Madagascar, un pays dominé par l'impérialisme étranger et soumis depuis des décennies au carcan des prêts du FMI et de la Banque mondiale.
Les racines de la pauvreté de Madagascar peuvent être retracées jusqu’à la colonisation française, durant laquelle la population de l'île fut soumise au travail forcé et à une répression brutale. En 1947, le soulèvement des Malgaches contre le joug colonial fut réprimé dans le sang, par le gouvernement français (dirigé par des socialistes et auquel participait le PCF). Des dizaines de milliers de Malgaches furent massacrés par l’armée française, des villages entiers furent réduits en cendres et d’innombrables Malgaches furent déportés, torturés ou violés. Ces méthodes sanglantes servirent de modèle pour celles que les Français utilisèrent ensuite en Algérie.
En 1960, l’île acquit son indépendance, mais elle resta sous le contrôle de l'impérialisme français, qui représentait la moitié de son commerce extérieur et la totalité de son capital bancaire et financier.
Il existait de fortes traditions communistes et socialistes dans la classe ouvrière et le mouvement nationaliste. Pendant une brève période à la fin des années 1970, l’île fut dirigée par un régime qui tenta de se libérer de la domination française, nationalisa des secteurs clés de l’économie et se tourna vers l’URSS. Mais cet épisode fut bref. Dès le début des années 1980, le même régime se tourna vers le FMI. Celui-ci imposa un programme d’ajustement structurel et de privatisation, qui s’accompagna d’une corruption massive.
La population de Madagascar est pauvre, alors que l'île est riche de ressources naturelles et de terres arables. Le pays représente 80 % de la production mondiale de vanille. Il est le quatrième producteur mondial de cobalt et possède de riches réserves de nickel, de titane et d'autres métaux. Mais son économie est dominée par le marché mondial et les grandes multinationales. La France représente encore la majeure partie de ses exportations, suivie de près par les Etats-Unis. Ces dernières années, les capitaux chinois sont aussi devenus de plus en plus présents et la Chine est devenue la première source d’importations à Madagascar.
La pauvreté et les infrastructures déliquescentes, dont souffre l’immense majorité de la population malgache, ont des sources plus profondes que la corruption, qui n’est que la face visible du capitalisme pourrissant de Madagascar, dominé par les puissances impérialistes.
La lutte contre la corruption, pour l’accès à l’eau et à l’électricité, pour la santé et l’éducation est intimement liée à la lutte contre la dette étrangère et, donc, à la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme.
La jeunesse malgache a montré son courage et sa détermination. Mais sa lutte ne peut être menée à terme que dans le cadre d’une lutte contre le système capitaliste. Sinon, elle se réduira à un nouveau cycle de mobilisation ne menant qu’à un changement de gouvernement, dans le cadre du même système.
Vive le soulèvement malgache ! A bas le capitalisme ! A bas l’impérialisme ! Jeunesse, soulève-toi !