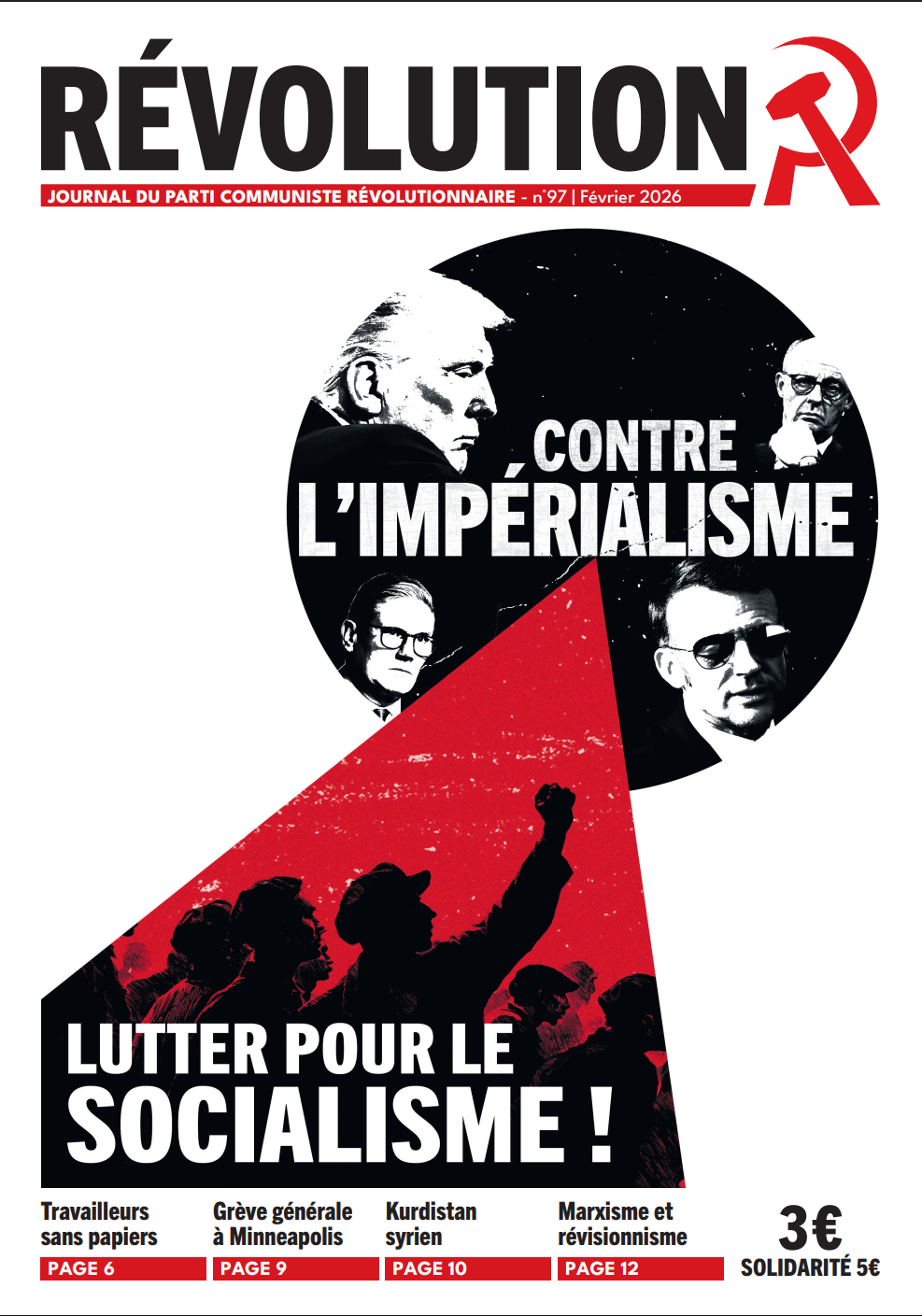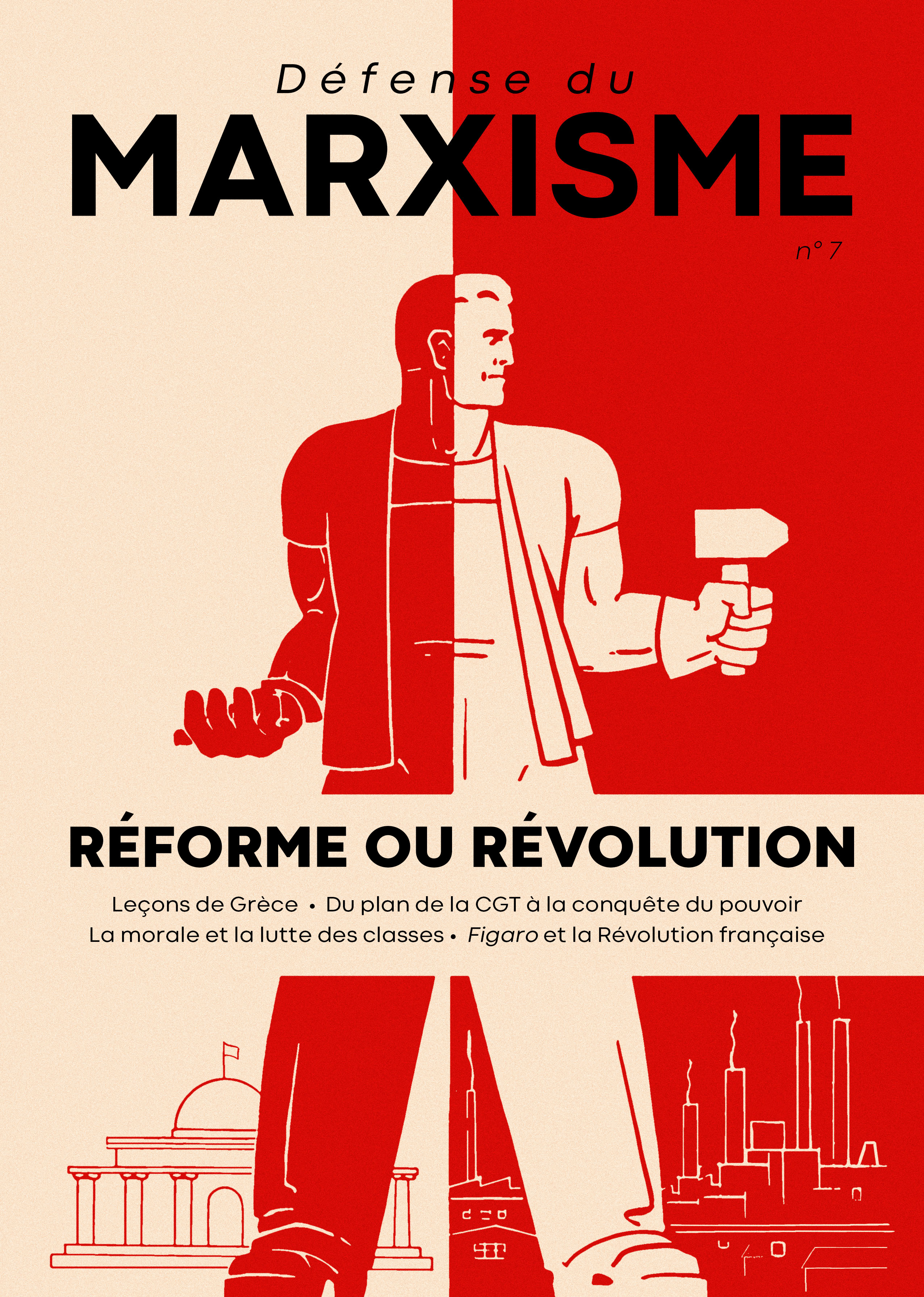Le 12 octobre dernier, le président malgache Andry Rajoelina a été forcé de démissionner et de s’exiler à Dubaï au terme de deux semaines d’agitation révolutionnaire. Après Gotabaya Rajapaksa au Sri Lanka en 2022, Sheikh Hasina au Bangladesh en 2024 et Khadga Prasad Sharma Oli au Népal cette année, c’est un nouveau dirigeant corrompu et à la solde des impérialistes qui est tombé sous la pression des masses.
Le mouvement a démarré le 25 septembre avec une mobilisation de la jeunesse contre les coupures quotidiennes d’électricité, mais aussi contre la corruption des élites et l’ampleur des inégalités, sur une île dont 79 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Brutalement réprimée par le pouvoir, qui a tué au moins 25 manifestants, la protestation pacifique des étudiants s’est transformée en un soulèvement national contre Rajoelina et son régime sanglant. Les résidences de plusieurs parlementaires proches du gouvernement ont été incendiées, et la protestation s’est propagée de la capitale Antananarivo à toutes les grandes villes du pays.
L’extension du mouvement
Le 30 septembre, les jeunes sont parvenus à déborder la police lors d’une manifestation à Antananarivo. Les affrontements avec les forces de l’ordre se sont intensifiés. Face à la répression, les étudiants ont appelé à la grève générale, et le mouvement ouvrier est entré en scène. Les jeunes médecins, les fonctionnaires et les travailleurs de la compagnie d’eau et d’électricité JIRAMA se sont joints à la mobilisation révolutionnaire en avançant leurs propres revendications. Les gardiens de prison les ont également rejoints, en annonçant qu’ils refuseraient désormais de garder les manifestants arrêtés.
La pression du mouvement des masses a fini par provoquer une fracture dans les rangs de l’armée. Dès le 2 octobre, des mutineries ont éclaté dans les casernes du CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques). Le 10, des soldats de la ville d’Antsiranana ont escorté des manifestants pour les protéger de la police. Le lendemain, les officiers du CAPSAT ont annoncé leur refus de participer à la répression et appelé à l’insurrection : « Nos enfants souffrent, nous ne sommes pas là pour les tuer et les battre. Nous vivons la même souffrance. Nous devons les soutenir. Ne nous laissons pas manipuler par l’argent ou le pouvoir. »
Liés à la classe ouvrière par leurs origines familiales et leurs conditions d’existence, les soldats du rang ne pouvaient plus accepter de tirer sur leurs frères, leurs sœurs et leurs enfants. Lorsqu’une révolution se développe jusqu’à un certain point, elle finit toujours par fracturer l’appareil d’Etat selon une ligne de classe. Quant aux officiers supérieurs, certains ont compris que l’effondrement du régime était inéluctable et ont décidé de préserver l’institution militaire en se rangeant – temporairement – du côté des masses.
La lutte pour le pouvoir
Se plaçant à la tête des masses, le CAPSAT a rapidement pris le contrôle de l’appareil d’Etat, forçant Rajoelina à s’enfuir à bord d’un avion militaire français. Depuis Dubaï où il s’est réfugié, le président déchu a dénoncé une « prise illégale du pouvoir ». Emmanuel Macron lui a apporté son soutien, affichant sa « grande préoccupation » pour « l’ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle [et] la stabilité » de l’ancienne colonie française. L’ordre bourgeois a en effet été ébranlé par la mobilisation des masses malgaches, qui ont commencé à s’organiser en comités de coordination et en patrouilles de vigilance – des organes embryonnaires d’un pouvoir révolutionnaire des travailleurs.
Mais les dirigeants de l’armée ont repris la main. Le 17 octobre, après la destitution de Rajoelina par l’Assemblée nationale, le colonel Michaël Randrianirina du CAPSAT a été investi président par la Haute cour constitutionnelle, en présence des ambassadeurs français, américain, chinois et russe. Il a rassuré la classe dirigeante en nommant Premier ministre l’homme d’affaires Herintsalama Rajaonarivelo, ancien président de la Banque nationale de l’industrie. Comme au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal, les capitalistes espèrent maintenant sortir de la crise révolutionnaire en s’appuyant sur un gouvernement provisoire et des figures « indépendantes », moins discréditées que les autres politiciens bourgeois.
Ils semblent avoir réussi à démobiliser les masses à ce stade, mais ce répit ne peut être que provisoire, car aucune des revendications du mouvement ne sera satisfaite par un simple changement de président. La misère, la déliquescence des infrastructures et la corruption sont les symptômes du capitalisme et de la domination impérialiste. Si les travailleurs de Madagascar sont pauvres, malgré la richesse des terres et des sous-sols de leur île, c’est parce que les multinationales françaises, américaines et chinoises pillent le pays avec la complicité de la bourgeoisie malgache.
Poussées par ces conditions intolérables, les masses malgaches reprendront inévitablement le chemin de la révolution. Mais si elles veulent l’emporter, il leur faudra une direction révolutionnaire dotée d’un programme clair, pour renverser le capitalisme, chasser les puissances impérialistes, et mettre les ressources de l’île sous le contrôle d’un gouvernement démocratique des travailleurs.