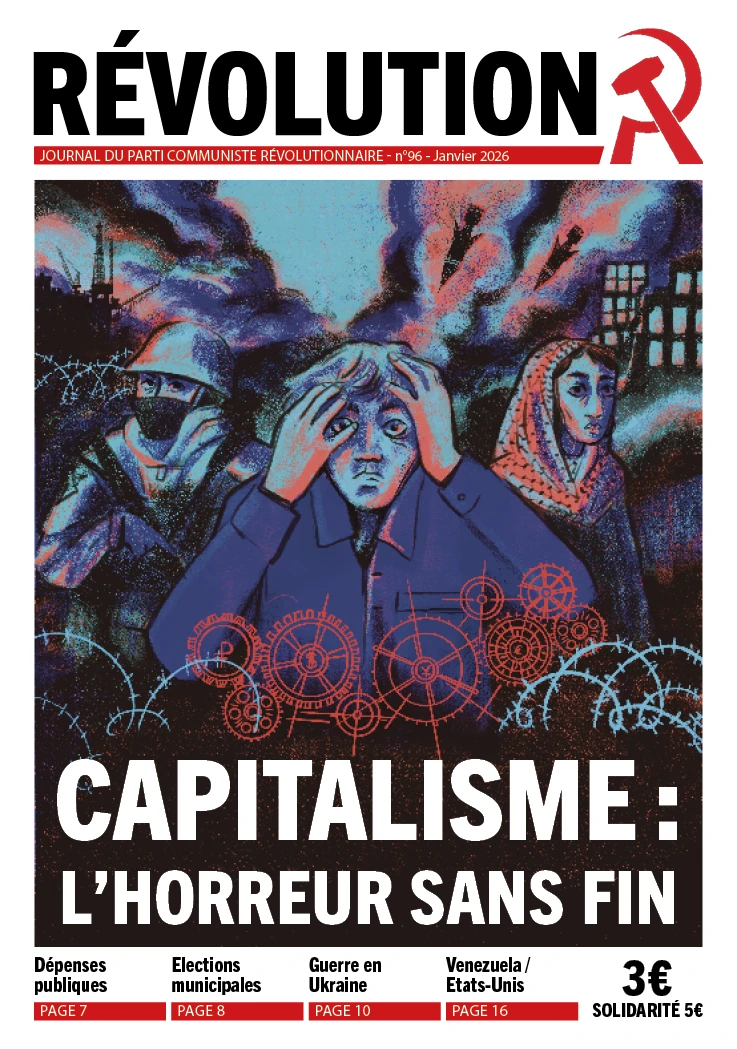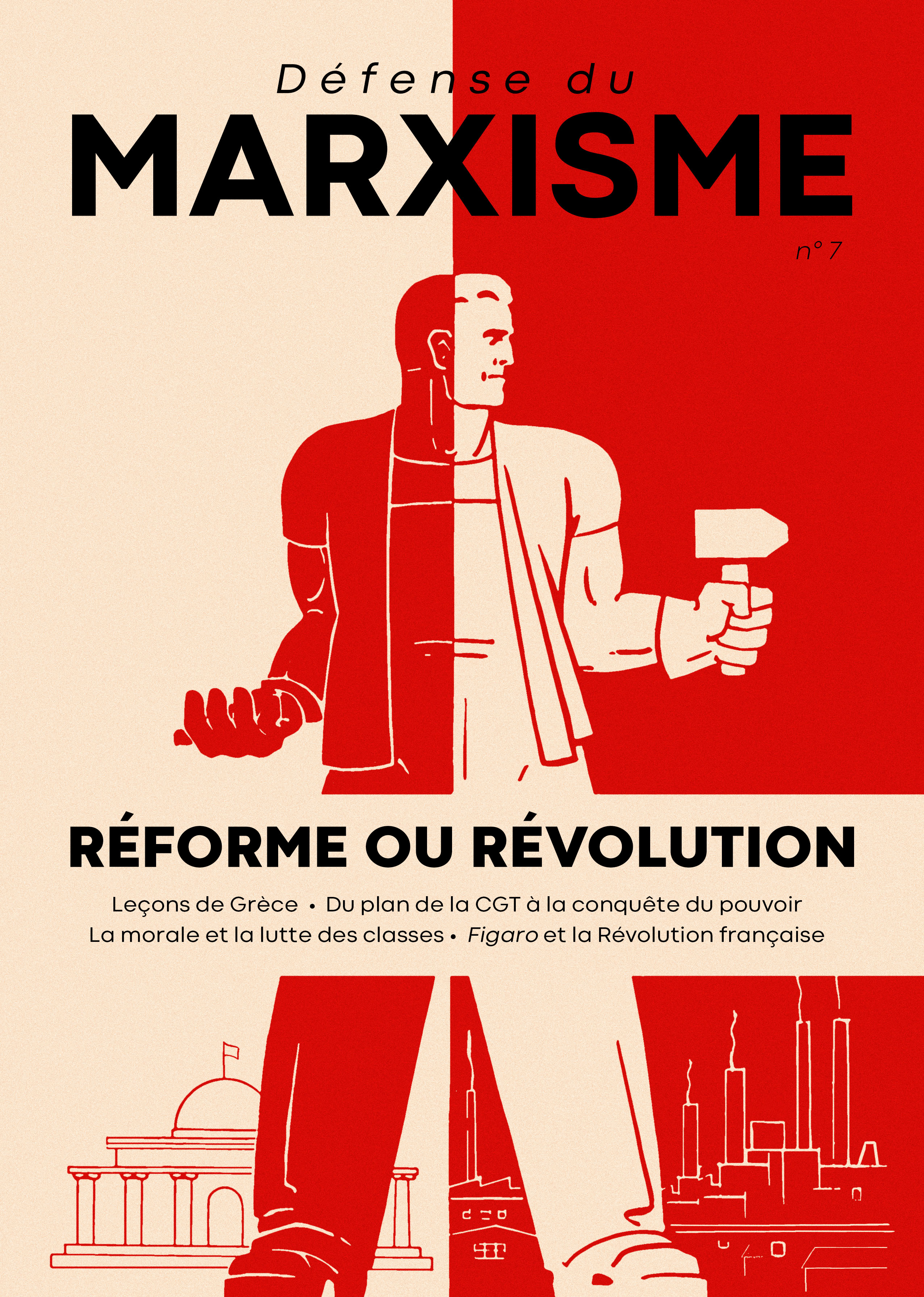Bertolt Brecht (1898-1956) est l’un des dramaturges et metteurs en scène les plus célèbres du XXe siècle. Communiste révolutionnaire dès l’âge de vingt ans, il a été profondément marqué par les grands événements de son époque, notamment en Allemagne. Il fut à la fois attaqué par la bourgeoisie et récupéré par les dirigeants staliniens de l’Allemagne de l’Est (RDA), qui voulaient en faire « leur » artiste.
De nos jours, il est souvent cité à gauche, mais ses œuvres restent peu connues du grand public. Nombre des thèmes qu’il a abordés sont pourtant d’une grande actualité. Par ailleurs, ses innovations formelles et la place qu’il accordait au spectateur ont marqué l’histoire du théâtre.
Les guerres, l’exil et la RDA
Brecht écrit son premier texte à l’âge de 16 ans, en 1914. La guerre et ses horreurs vont forger sa conscience politique ; c’est au cours de ces années noires qu’il commence à étudier le marxisme.
Après la défaite de la révolution allemande de 1918-23, les dirigeants staliniens du Parti Communiste Allemand se révèlent incapables de briser l’ascension du nazisme et d’empêcher l’arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. Les œuvres de Brecht sont interdites par le régime nazi, ses livres brûlés. Contraint à l’exil, il part d’abord en Scandinavie, puis aux Etats-Unis en 1941.
Le 30 octobre 1947, en plein maccarthysme, il est interrogé par le « Comité des activités anti-américaines » sur ses liens avec le Parti Communiste Américain. Il se défend, mais on lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu. Le lendemain, il repart pour l’Europe et, en 1948, retourne à Berlin-Est, où il fonde le Berliner Ensemble, l’une des compagnies théâtrales les plus célèbres d’Europe.
Ses rapports avec les dirigeants de la RDA sont complexes. D’un côté, le régime cherche à utiliser son succès comme une forme de propagande, en particulier à l’étranger ; de l’autre, son théâtre n’est pas pleinement conforme aux dogmes de l’« esthétique » stalinienne (le « réalisme socialiste »). Par ailleurs, la verve de Brecht n’épargne pas toujours les dirigeants staliniens eux-mêmes. Après l’insurrection ouvrière de juin 1953 à Berlin-Est, il publie un poème, La Solution, qui est plein d’ironie envers la propagande du régime.
Le théâtre « épique »
Brecht s’est efforcé de rompre avec le théâtre de son temps. L’une de ses premières et plus célèbres pièces, L’Opéra des quat’sous (1928), est une parodie cinglante du théâtre bourgeois le plus médiocre.
Sur le fond comme sur la forme, Brecht voulait réaliser une « révolution copernicienne ». Il opposait son théâtre « épique » au théâtre dramatique traditionnel. Alors que ce dernier favorise l’identification du spectateur aux personnages et son adhésion passive, non critique, à ce qui se passe sur la scène, le théâtre « épique » pose des questions, cherche à provoquer l’étonnement, l’imagination et la critique.
Ce type de théâtre repose sur l’effet de « distanciation », qui consiste à rompre l’identification du spectateur aux personnages – et à souligner que ce qui semble évident ou naturel ne l’est pas. Comment y parvenir ? Au-delà du travail sur le jeu d’acteur, et notamment sa gestuelle, Brecht introduit certaines innovations : des interruptions narratives par des commentaires textuels ou musicaux, un chœur extérieur qui contrebalance les propos des personnages, les lumières qui restent allumées en salle ou encore les acteurs qui brisent le « quatrième mur » en s’adressant directement au public.
Sur le fond, Brecht rejette les drames psychologiques et familiaux centrés sur les individus, au profit d’un théâtre ouvert aux questions qui traversent la société. La résistible ascension d’Arturo Ui (1941) est une parodie de la montée au pouvoir de Hitler. Dans Mère Courage et ses enfants, Brecht nous guide à travers l’Europe dévastée par les guerres. La Vie de Galilée (1939) exalte la lutte de la science contre l’obscurantisme et les pressions de la censure politique. Moins connue, La Décision (1930) nous plonge dans la révolution chinoise de 1924-27.
Les pièces et les poèmes de Brecht sont toujours une source d’inspiration pour ceux qui souhaitent entendre une voix s’élever contre le système actuel. Ce qu’il y a de plus vivant dans le théâtre brechtien, c’est qu’il fonctionne comme un miroir déformé, qui change les proportions pour nous permettre de mieux voir les contradictions. Sans renoncer au ton du jeu, aux émotions ou au sens de l’humour, Brecht stimule la curiosité et l’esprit critique du spectateur, lui offrant ainsi de nouveaux outils à utiliser au-delà du théâtre, dans l’arène de l’histoire.
La Solution
Après l’insurrection du 17 juin
Le secrétaire de l’Union des écrivains
Fit distribuer des tracts dans la Stalinallee.
Le peuple, y lisait-on, a par sa faute
Perdu la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner. Ne serait-il pas
Plus simple alors pour le gouvernement
De dissoudre le peuple
Et d’en élire un autre ?