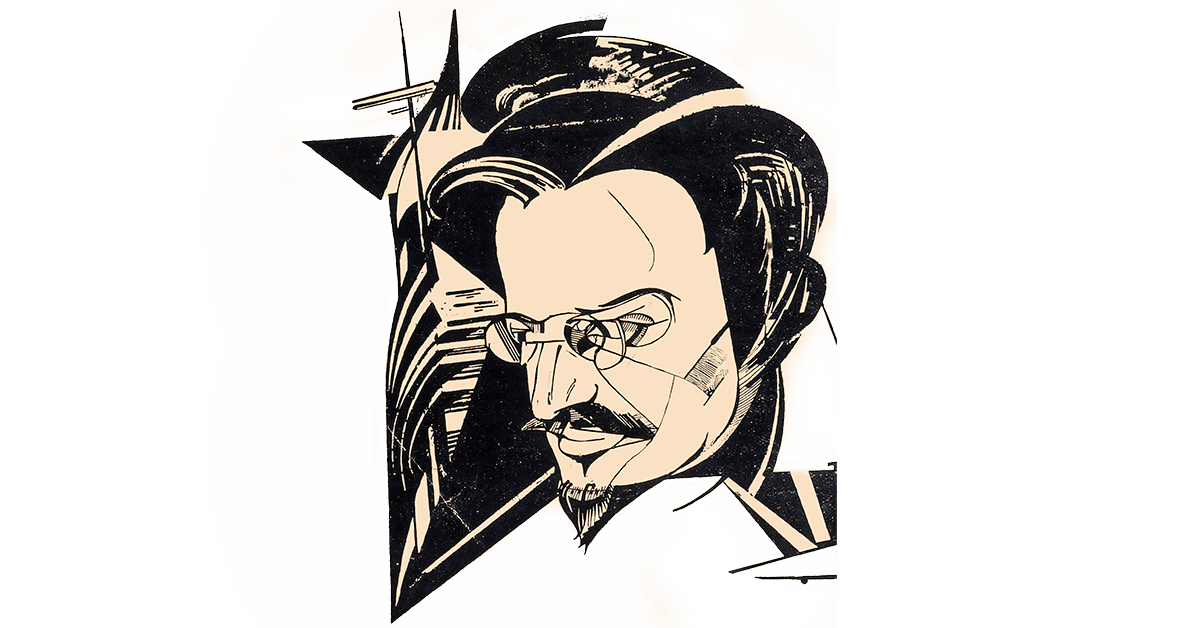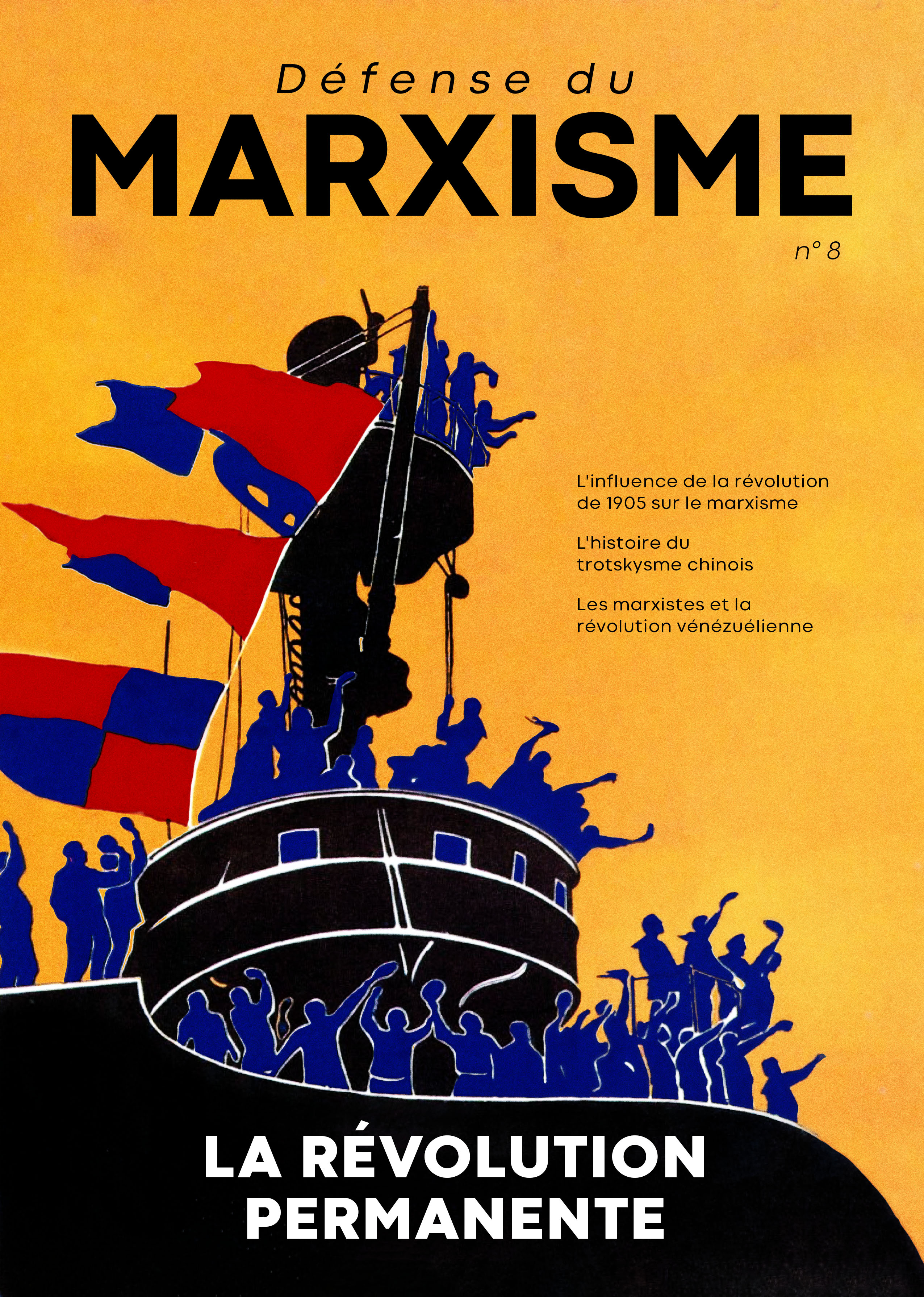Le 3 février 1926, Léon Trotsky fit un discours intitulé « À propos de la culture » au club « Place rouge » de Moscou. Par la suite, il le compila avec d’autres discours pour en faire l’article suivant, qui fut publié pour la première fois en 1926 dans le journal Krasnaya Nov. Nous publions ici une version française basée sur la traduction anglaise réalisée par Brian Pearce dans la Labour Review, en 1962.
Dans cet article profond et fascinant, Trotsky explique la relation entre le développement technologique et celui de la culture humaine. Il aborde ensuite le rôle de la culture dans la construction du socialisme. Enfin, il explique la voie à suivre pour l’Union soviétique, qui à l’époque tentait de jeter les bases du socialisme dans des conditions d’isolement et d’arriération extrêmes.
1. La technique et la culture
En premier lieu, rappelons que la culture renvoyait autrefois au champ cultivé, labouré, par opposition à la forêt vierge, à la terre vierge. La culture était opposée à la nature ; ce qui était acquis grâce aux efforts de l’homme était opposé aux fruits naturellement prodigués par la terre. Cette opposition demeure valable aujourd’hui, fondamentalement.
La culture représente tout ce qui a été créé, construit, assimilé, réalisé par l’homme au cours de son histoire – à la différence de ce que la nature lui a offert, y compris l’histoire naturelle de l’homme comme espèce animale. La science qui étudie l’homme comme le produit de l’évolution animale s’appelle l’anthropologie. Mais au moment même où l’homme se sépara du règne animal – lorsqu’il commença à utiliser des instruments primitifs (la pierre, le bâton) et arma les organes de son corps – commença aussi la création et l’accumulation de la culture, c’est-à-dire tous les aspects de la connaissance et du savoir-faire dans la lutte pour maîtriser la nature.
Quand nous parlons de la culture accumulée par les générations passées, nous pensons d’abord à ses réalisations matérielles sous forme d’outils, de machines, de bâtiments, de monuments, etc. Est-ce cela la culture ? C’est sans aucun doute la culture, ou du moins ses incarnations matérielles. C’est la culture matérielle, qui crée – sur les bases offertes par la nature – la structure fondamentale de notre vie, de notre quotidien, de notre créativité. Mais la partie la plus précieuse de la culture est ses legs dans la conscience de l’homme ; ce sont nos méthodes, habitudes, capacités et savoir-faire acquis, lesquels additionnés à toute la culture matérielle déjà existante, et prenant appui sur elle, la perfectionnent. En conséquence, nous, camarades, considérons cela comme solidement établi : la culture se développe à partir de la lutte de l’homme pour son existence, pour l’amélioration de ses conditions de vie, pour l’augmentation de sa puissance. Mais c’est aussi sur ces bases que se développent les classes sociales. Au cours du processus d’adaptation à la nature, dans la lutte contre ses forces hostiles, la société humaine se modifie en une organisation de classes complexe. C’est la structure de classe de la société qui détermine de façon décisive le contenu et la forme de l’histoire humaine, c’est-à-dire de ses rapports matériels et de leurs reflets idéologiques. En définitive, cela signifie que la culture historique possède un caractère de classe.
Les sociétés esclavagiste, féodale et bourgeoise ont chacune engendré leur culture propre. À chaque étape il y a une culture différente ; il y a aussi une multitude de formes transitoires. La société historique est l’organisation de l’exploitation de l’homme par l’homme. La culture sert l’organisation de classe de la société ; la société fondée sur l’exploitation engendre la culture de l’exploitation. Pour autant, sommes-nous opposés à toute la culture du passé ?
Nous en arrivons ici à une contradiction profonde. Tout ce qui a été acquis, créé, construit par les efforts de l’homme – et a permis d’augmenter sa puissance – relève de la culture. Mais puisque nous avons affaire à l’homme social, et non à l’homme individuel ; puisque la culture est essentiellement un phénomène socio-historique ; puisque la société historique a été et demeure la société de classes – la culture se révèle être le principal instrument de l’oppression de classe. Marx a dit : « Les idées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les idées dominantes ». Cela se rapporte à la culture en général. Et pourtant nous disons à la classe ouvrière : assimile toute la culture du passé, faute de quoi tu ne pourras pas construire le socialisme. Comment doit-on comprendre cela ?
Beaucoup de gens ont trébuché sur cette contradiction, et s’ils trébuchent c’est parce qu’ils approchent la notion de société divisée en classes de façon superficielle, à demi idéaliste, en oubliant que, fondamentalement, il s’agit de l’organisation de la production. Chaque société divisée en classes s’est développée à partir des moyens acquis dans la lutte contre la nature, et ces moyens ont évolué en fonction du développement de la technique. Qu’est-ce qui est le plus fondamental : l’organisation de classe de la société ou les forces productives ? Sans aucun doute, les forces productives. En effet, les classes sociales se forment et se reforment précisément à un certain niveau de développement des forces productives. Dans celles-ci s’exprime matériellement l’habileté économique de l’homme, sa capacité historique à garantir sa propre existence. Sur cette base dynamique croissent les classes, dont les rapports déterminent le caractère de la culture.
Ainsi, lorsqu’on aborde le problème de la technique, on doit se demander : est-elle seulement un instrument de l’oppression de classe ? Il suffit de poser la question pour répondre immédiatement : non, car la technique est une conquête fondamentale de l’humanité ; elle a certes servi, jusqu’alors, d’instrument d’exploitation, mais elle est aussi la condition fondamentale de la libération des exploités. La machine étrangle l’esclave salarié, mais il ne peut se libérer que grâce à la machine. Tel est le cœur de la question.
Si nous n’oublions pas que la force motrice du procès historique est la croissance des forces productives, qui libère l’homme de sa soumission aux forces de la nature, nous comprendrons qu’il est nécessaire au prolétariat d’assimiler la totalité des connaissances et des savoir-faire élaborés par l’humanité au cours de son histoire, afin de s’élever lui-même tout en reconstruisant la vie sociale sur la base des principes de la solidarité.
Une des notes posées devant moi demande : « Est-ce la culture qui fait progresser la technique ou la technique qui fait progresser la culture ? ». La formulation de cette question est incorrecte. La technique ne peut pas être opposée à la culture, car elle est son principal ressort. Sans technique il n’y a pas de culture. La croissance de la technique entraîne celle de la culture. Mais la science et la culture générale qui sont apparues sur les bases de la technique apportent, en retour, une aide puissante à la croissance de la technique. Il y a ici une interaction dialectique.
Camarades, si vous voulez un exemple simple mais expressif de la contradiction contenue dans la technique elle-même, vous n’en trouverez pas de meilleur que dans le transport ferroviaire. Si vous jetez un coup d’œil sur les trains de voyageurs européens, vous verrez qu’il y a différentes « classes » de voitures. Ces classes nous rappellent celles de la société capitaliste. La première classe est pour l’élite privilégiée, la deuxième pour la moyenne bourgeoisie, la troisième pour la petite bourgeoisie et la quatrième pour le prolétariat, qui non sans raison a récemment été appelé le quart-état. En eux-mêmes, les chemins de fer constituent une colossale conquête technique et culturelle de l’humanité. En un siècle, ils ont beaucoup transformé l’aspect de la Terre. Mais la structure de classe de la société exerce aussi une influence sur la structure des moyens de transport. Or nos chemins de fer soviétiques sont encore loin de l’égalité. Et pas seulement parce qu’ils utilisent des voitures héritées du passé, mais aussi parce que la N.E.P. ne réalise pas l’égalité : elle ne fait qu’en préparer le chemin.
Avant les chemins de fer, la civilisation était concentrée aux abords des mers et des grands fleuves. Les chemins de fer ont ouvert des continents entiers à la culture capitaliste. Le manque de voies ferrées et de bonnes routes est l’une des principales raisons – si ce n’est la principale – du retard et de l’abandon du village russe. Sous ce rapport, la plupart de nos villages se trouvent dans des conditions précapitalistes. Nous devons maîtriser notre grand allié, qui est aussi notre plus grand adversaire : l’espace. L’économie socialiste est l’économie planifiée. Le plan présuppose avant tout la communication. Les moyens de communication les plus importants sont les routes et les voies ferrées. Chaque nouvelle voie ferrée est une voie vers la culture, mais dans nos conditions aussi une voie vers le socialisme. Avec l’amélioration des voies de communication et du bien-être du pays, l’aspect social de nos trains changera : la division en « classes » disparaîtra ; tout le monde bénéficiera de voitures confortables… du moins si, à ce stade, les gens voyagent encore en train et ne lui préfèrent pas les aéroplanes, qui seront accessibles à tout un chacun.
Prenons un autre exemple : les instruments du militarisme, les moyens de destruction. Dans ce domaine la nature de classe de la société s’exprime de façon particulièrement vive et répugnante. Mais il n’est pas de nouveau moyen de destruction – fut-ce une substance explosive ou toxique – qui ne soit en lui-même une précieuse découverte technologique. Les substances explosives et toxiques sont utilisées non seulement pour détruire, mais aussi pour créer. Elles ouvrent de nouvelles possibilités dans le domaine des découvertes et des inventions.
Le prolétariat ne peut prendre le pouvoir que s’il brise le vieil appareil de l’État de classe. Nous sommes allés plus loin que quiconque dans cette voie. Cependant, lors de la construction du nouvel appareil d’État, nous avons découvert qu’il nous faudrait utiliser jusqu’à un certain point – assez considérable – des éléments provenant de l’ancien État. La réorganisation socialiste de la machine d’État est indissolublement liée au travail politique, économique et culturel en général.
Il ne faut pas détruire la technique. Le prolétariat a pris possession des usines, équipées par la bourgeoisie, dans l’état où la révolution les a trouvées. Le vieil équipement nous sert encore à ce jour. Ce fait nous montre très concrètement et très directement que nous ne devons pas renoncer à l’« héritage ». Comment pourrait-il en être autrement ? La révolution a été faite, avant tout, pour prendre possession de l’« héritage ». Cependant la vieille technique, dans la forme où nous l’avons prise, est tout à fait inadaptée au socialisme. Elle constitue une cristallisation de l’anarchie de l’économie capitaliste. La compétition entre les différentes entreprises, la course au profit, le développement inégal des différentes branches, le retard de certaines régions, le morcellement de l’agriculture, le pillage de la main-d’œuvre – tout cela trouve son expression technique dans le fer et dans le cuivre. S’il est possible de détruire l’instrument de l’oppression de classe par un soulèvement révolutionnaire, on ne peut que graduellement reconstruire l’outil industriel de l’anarchie capitaliste. L’achèvement de la période de prise en main du vieil équipement nous conduit seulement au seuil de cette tâche grandiose. Nous devrons la résoudre coûte que coûte.
2. L’héritage de la culture spirituelle
La culture spirituelle est tout aussi contradictoire que la culture matérielle. Par ailleurs, des arsenaux et des magasins de la culture matérielle, nous ne mettons en circulation ni l’arc et les flèches, ni les instruments de pierre, ni les outils de l’âge de bronze, mais les meilleurs outils disponibles et la technique la plus récente. Nous devons approcher la culture spirituelle de la même façon.
Dans la culture de la vieille société, l’élément fondamental était la religion. Elle possédait une importance primordiale en tant que forme du savoir et de l’unité humaine ; mais sous cette forme s’exprimait avant tout la faiblesse de tout homme face à la nature et son impuissance au sein même de la société. Nous rejetons complètement la religion et tous ses avatars.
Il en va autrement de la philosophie. De la philosophie créée par la société de classes nous devons assimiler deux de ses éléments inestimables : le matérialisme et la dialectique. C’est de la combinaison organique du matérialisme et de la dialectique qu’est née la méthode de Marx, que son système a vu le jour. Cette méthode est à la base du léninisme.
Ensuite, si nous passons à la science au sens strict du terme, nous voyons bien que nous sommes face à un immense réservoir de connaissances et de savoir-faire accumulés par l’humanité tout au long de son histoire. Certes, on peut souligner à juste titre que la science, dont l’objectif est la connaissance de la réalité, est marquée par de nombreuses distorsions de classe tendancieuses. Si les trains reflètent la situation privilégiée de certains et le dénuement des autres, c’est encore plus vrai de la science, dont la matière est beaucoup plus souple que le métal et le bois avec lesquels sont construites les voitures de première et de quatrième classes. Mais nous devons garder à l’esprit que la créativité scientifique est stimulée, fondamentalement, par le besoin de connaître la nature, afin d’assimiler ses forces. Bien que les intérêts de classe aient introduit et introduisent encore des tendances erronées dans les sciences naturelles, cette falsification ne va pas au-delà du seuil où elle commence à empêcher directement les progrès de la technologie. Si vous examinez les sciences naturelles de bas en haut, en allant de l’accumulation des faits élémentaires jusqu’aux plus hautes et plus complexes généralisations, vous verrez que plus la recherche scientifique est empirique, plus elle est proche de la matière et des faits, plus elle produit des résultats indubitables. Inversement, plus les sciences naturelles s’engagent dans des généralisations, plus elles se rapprochent des questions philosophiques, plus elles tombent sous l’influence des intérêts de classe.
La situation est encore plus mauvaise dans le domaine des sciences sociales et soi-disant « humaines ». Certes, même ici, c’est le désir de connaître le monde réel qui est à la base de la recherche. C’est ce désir, par exemple, qui a produit la brillante école des économistes classiques bourgeois. Mais l’intérêt de classe affecte beaucoup plus directement et impérativement les sciences sociales que les sciences naturelles ; il a assez vite abouti à une interruption du développement de la pensée économique bourgeoise. Ceci dit, dans ce domaine nous, communistes, sommes bien mieux armés que quiconque. Réveillés par la lutte de classe du prolétariat, les théoriciens socialistes se sont appuyés sur la science bourgeoise et, en même temps, l’ont critiquée pour aboutir, dans la doctrine de Marx et Engels, à la puissante méthode du matérialisme historique et à son application inégalée dans Le Capital. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous soyons assurés contre l’influence des idées bourgeoises dans les domaines de l’économie et de la sociologie en général. Non, les plus vulgaires tendances des socialistes scolastiques et des petits-bourgeois populistes surgissent à chaque pas à partir des vieux « trésors » de la connaissance ; ces tendances trouvent un milieu propice dans les relations informelles et contradictoires de l’époque de transition. Mais dans ce domaine nous avons les critères irremplaçables du marxisme, validés et enrichis par les travaux de Lénine. Et moins nous nous enfermerons dans l’expérience du jour, plus nous embrasserons le développement mondial dans son ensemble (en distinguant nettement ses tendances fondamentales de ses changements conjoncturels), plus décisive sera notre victoire sur les économistes et les sociologues vulgaires.
En matière de droit, de morale et d’idéologie en général, la situation de la science bourgeoise est encore plus lamentable, si c’est possible, qu’en matière d’économie. Pour trouver dans ces domaines une perle de connaissance authentique, il faut fouiller des douzaines de tas de fumier professoral.
La dialectique et le matérialisme constituent les principaux éléments de la connaissance marxiste du monde. Mais cela ne signifie pas du tout qu’on puisse les appliquer à n’importe quel domaine de la connaissance à la façon d’un passe-partout. On ne peut pas imposer la dialectique aux faits ; il faut la dériver des faits, de leur nature et de leur développement. Seul un travail minutieux sur une immense quantité de matériaux a donné à Marx la possibilité de fonder un système dialectique de l’économie sur le concept de valeur comme travail cristallisé. Les travaux de Marx en histoire, y compris ses articles de presse, ont été réalisés suivant la même méthode. L’application de la dialectique matérialiste à de nouveaux domaines de la connaissance suppose une assimilation interne des matériaux en question. Le nettoyage de la science bourgeoise présuppose l’assimilation de la science bourgeoise – et non sa critique sauvage ou de creuses condamnations. L’approche critique doit aller de pair, ici, avec une étude et une assimilation patientes. Nous avons la méthode, mais il y a suffisamment de travail pour de nombreuses générations.
La critique marxiste de la science doit être non seulement vigilante, mais également prudente, sinon elle pourrait dégénérer en un véritable sycophantisme, en une famousovtchina[1]. Prenons par exemple la psychologie. L’étude des réflexes de Pavlov se situe entièrement sur la voie du matérialisme dialectique. Elle renverse définitivement le mur qui existait entre la physiologie et la psychologie. Le plus simple réflexe est physiologique, mais le système des réflexes donnera la « conscience ». L’accumulation de la quantité physiologique donne une nouvelle qualité, la qualité « psychologique ». La méthode de l’école de Pavlov est expérimentale et minutieuse. La généralisation se conquiert pas à pas depuis la salive du chien jusqu’à la poésie (sa mécanique psychique, non sa teneur sociale). Mais bien sûr, les voies vers la poésie restent à découvrir.
C’est d’une manière différente que l’école du psychanalyste viennois Freud aborde la question. Elle part de la considération suivante : les forces motrices des processus psychiques les plus complexes et les plus délicats s’avèrent être des nécessités physiologiques. Dans ce sens général, cette école est matérialiste, si l’on écarte la question de savoir si elle ne donne pas une place trop importante au facteur sexuel au détriment des autres facteurs (mais c’est déjà là un débat qui s’inscrit dans le cadre du matérialisme). Pourtant, le psychanalyste n’aborde pas expérimentalement le problème de la conscience, depuis les phénomènes primaires jusqu’aux phénomènes les plus élevés, depuis le simple réflexe jusqu’au réflexe le plus complexe ; il s’efforce de franchir d’un seul bond tous les échelons intermédiaires, de haut en bas, du mythe religieux, de la poésie lyrique ou du rêve, jusqu’aux bases physiologiques de l’âme.
Les idéalistes enseignent que l’âme est autonome, que la « pensée » est un puits sans fond. Pavlov et Freud, par contre, considèrent que le fond de la « pensée » est constitué par la physiologie. Mais tandis que Pavlov, comme un scaphandrier, descend jusqu’au fond et explore minutieusement le puits, de bas en haut, Freud se tient au-dessus du puits et, d’un regard perçant, s’évertue, à travers la masse toujours fluctuante de l’eau trouble, de discerner ou de deviner la configuration du fond. La méthode de Pavlov, c’est l’expérimentation. La méthode de Freud est la conjecture, parfois fantastique. La tentative de déclarer la psychanalyse « incompatible » avec le marxisme et de tourner le dos sans cérémonie au freudisme est trop simpliste, ou plutôt trop « simplette ». En aucun cas nous ne sommes tenus d’adopter le freudisme. C’est une hypothèse de travail qui peut donner – et qui incontestablement donne – des hypothèses et des conclusions qui s’inscrivent dans la ligne d’une psychologie matérialiste. La voie expérimentale amène, en son temps, la preuve. Mais nous n’avons ni motif ni droit d’élever un interdit à une autre voie – quand bien même elle serait moins sûre – qui s’efforce d’anticiper des conclusions auxquelles la voie expérimentale ne mène que bien plus lentement.[2]
À l’aide de ces exemples, j’avais l’intention de montrer, au moins partiellement, tant la diversité de l’héritage scientifique que la complexité des voies par lesquelles le prolétariat peut passer pour en prendre possession. S’il est vrai que dans l’édification économique les problèmes ne peuvent être résolus par décret et qu’il nous faut « apprendre à commercer », de même dans les sciences de purs et simples ordres ne pourront rien produire d’autre que le préjudice et le déshonneur. Dans ce domaine, il faut « apprendre à apprendre ».
L’art est l’une des formes d’orientation de l’homme dans le monde. En ce sens, l’héritage de l’art ne se distingue pas de l’héritage de la science et de la technique ; il n’est d’ailleurs pas moins contradictoire. Cependant, alors que la science connaît le monde à travers un système de lois, l’art est une forme de connaissance qui repose sur un groupement d’images. C’est aussi un moyen d’inspirer certains sentiments et états d’âme. L’art des siècles passés a fait l’homme plus complexe et plus souple, a élevé sa mentalité à un plus haut degré, l’a enrichi sous tous les aspects. Cet enrichissement est une conquête inestimable de la culture. L’assimilation de l’art du passé est donc la condition préalable non seulement à la création du nouvel art, mais encore à la construction de la nouvelle société, car pour le communisme il est nécessaire que les gens aient un esprit hautement développé. L’art du passé peut-il nous enrichir d’une connaissance artistique du monde ? Oui, il le peut, précisément parce qu’il est capable de nourrir nos sentiments et de les élever. Si nous renoncions arbitrairement à l’art du passé, nous nous appauvririons spirituellement.
Chez nous on observe de nos jours, ici et là, une tendance à défendre l’idée que l’art a pour seul but d’inspirer certains états d’âme, et non de connaître la réalité. D’où cette conclusion : nous risquons d’être contaminés par les sentiments suscités par l’art noble ou l’art bourgeois. Ce raisonnement est fondamentalement erroné. La signification de l’art comme moyen de connaissance – y compris pour les masses populaires, et particulièrement pour elles – n’est pas moindre que sa signification « sensuelle ». Non seulement le chant épique, mais aussi la fable, la chanson, le proverbe et les couplets folkloriques fournissent une connaissance figurative, éclairent le passé, généralisent l’expérience, élargissent l’horizon, et seulement de cette manière sont capables « d’orienter ». C’est vrai généralement de toute littérature – non seulement la poésie épique, mais encore la poésie lyrique. Cela vaut également pour la peinture et la sculpture. La seule exception, en un sens, c’est la musique, dont l’action est puissante, mais unilatérale. Certes, la musique s’appuie sur une connaissance originale de la nature, de ses sons et de ses rythmes. Mais ici la connaissance est si profondément enfouie, l’inspiration de la nature est tellement réfractée par les nerfs de l’homme, que la musique agit comme une « révélation » indépendante. Il y a eu bien des tentatives de réduire toutes les formes d’art à la musique, comme art de la « suggestion » par excellence, et elles ont toujours signifié une dépréciation du rôle de l’intelligence au profit de la sensualité informe. En ce sens, ces tentatives étaient et demeurent réactionnaires. Le pire de tout, bien sûr, ce sont ces œuvres d’« art » qui n’offrent ni la connaissance figurative, ni la « suggestion » artistique, mais formulent quand même d’exorbitantes prétentions. Hélas, il s’en imprime beaucoup chez nous, non dans les cahiers d’étudiants participant à des ateliers d’écriture, mais à plusieurs milliers d’exemplaires.
La culture est un phénomène social. C’est pourquoi la langue, en tant qu’organe des relations réciproques entre les gens, est son instrument le plus important. La culture de la langue est la plus importante condition de la croissance de tous les domaines de la culture, en particulier les sciences et les arts. Lorsque la technique n’est pas satisfaite par de vieux appareils de mesure, elle en crée de nouveaux : les micromètres, les voltmètres, etc., grâce auxquels elle atteint une exactitude toujours plus grande. Il en va de même dans le domaine de la langue, du savoir-faire dans le choix des termes appropriés, de leur combinaison adéquate, systématique : un travail minutieux permet d’obtenir le plus haut degré d’exactitude, de clarté, de relief. La base de ce travail doit être la lutte contre l’analphabétisme, l’illettrisme, le manque d’instruction. L’étape suivante est la maîtrise de la littérature classique russe.
Oui, la culture était le principal instrument de l’oppression de classe. Mais elle peut devenir aussi – et elle seule peut devenir – l’instrument de la libération socialiste.
3. Nos contradictions culturelles
A. La ville et le village
La particularité de notre situation consiste en ce que nous – à la jonction de l’Occident capitaliste et de l’Orient colonial et paysan – avons été les premiers à accomplir une révolution socialiste. Le régime de la dictature prolétarienne s’est établi pour la première fois dans un pays marqué par un immense héritage de retard et de barbarie, de sorte que chez nous des siècles d’histoire séparent quelques nomades de Sibérie d’un prolétaire de Moscou ou de Leningrad.
Nos formes sociales sont transitoires vers le socialisme, et donc beaucoup plus élevées que les formes capitalistes. En ce sens, nous sommes en droit de considérer notre pays comme le plus avancé au monde. Mais la technique, qui est à la base de la culture matérielle et de toute autre culture, est chez nous extraordinairement arriérée par rapport à celle des pays capitalistes avancés. C’est la principale contradiction de notre réalité présente. La tâche historique qui en découle est l’élévation de notre technique au niveau de notre formation sociale. Si nous n’y parvenons pas, notre ordre social sombrera inévitablement au niveau de notre retard technique. Oui, afin de comprendre toute la signification du progrès technique, il faut que nous nous disions franchement : si nous ne parvenons pas à compléter notre édifice soviétique en construction avec la technique industrielle appropriée, nous ne pourrons pas accomplir la transition vers le socialisme et nous reviendrons en arrière, vers le capitalisme – et plus précisément, vers un capitalisme à moitié servile, à moitié colonial. La lutte pour la technique est pour nous la lutte pour le socialisme, à laquelle l’avenir de toute notre culture est indissolublement lié.
Voici un exemple très récent et très significatif de nos contradictions culturelles. Il y a quelques jours, dans les journaux, un article rapportait que notre bibliothèque publique de Leningrad atteint désormais la première place au monde en quantité de volumes : elle compte à présent 4,25 millions de livres ! Notre première réaction est un sentiment naturel de fierté soviétique : notre bibliothèque est la plus riche du monde ! À quoi devons-nous ce résultat ? Au fait que les bibliothèques privées ont été expropriées. Par la nationalisation de la propriété privée, nous avons créé l’institution culturelle la plus riche, accessible à tous. À partir de ce fait simple, on découvre incontestablement les grands avantages de la construction soviétique. Mais en même temps notre retard culturel s’exprime dans le fait que chez nous le pourcentage d’illettrés est plus important que dans n’importe quel autre pays européen. Notre bibliothèque est la première au monde, mais seule une minorité de notre population lit des livres. Il en va ainsi dans pratiquement tous les domaines. D’un côté, nous avons les projets extraordinaires et gigantesques de notre industrie nationalisée : le barrage sur le Dniepr, le canal Volga-Don, etc. Mais d’un autre côté, nos paysans font toujours leur farine avec des fléaux et des rouleaux. Notre législation matrimoniale est pénétrée de l’esprit socialiste ; mais dans la vie familiale, la violence physique occupe toujours une place considérable. De pareilles contradictions découlent de toute la structure de notre culture, qui est au point de rencontre de l’Occident et de l’Orient.
À la base de notre retard, il y a la monstrueuse prédominance du village sur la ville, de l’agriculture sur l’industrie. À cela s’ajoute le fait qu’au village prédominent les moyens de production les plus arriérés. Quand nous parlons du servage, nous pensons surtout aux rapports sociaux, à l’asservissement du paysan au propriétaire terrien et au fonctionnaire tsariste. Mais camarades, le servage repose sur une base plus profonde : l’asservissement de l’homme à la terre, la dépendance complète du paysan à l’égard des éléments de la nature. Avez-vous lu Gleb Ouspensky ? Je crains que la plus jeune génération ne le lise pas. Il faudrait rééditer au moins ses meilleurs ouvrages, dont certains sont excellents. Ouspensky était un narodnik. Son programme politique était entièrement utopiste. Mais Ouspensky a dépeint le village, et c’est non seulement un excellent artiste, mais aussi un remarquable réaliste. Il est parvenu à comprendre la vie quotidienne du paysan et sa mentalité comme des phénomènes dérivés, développés à partir de la base économique et entièrement déterminés par elle. Il est parvenu à comprendre la base économique du village comme une soumission du travail paysan à la terre et, en général, aux forces de la nature. Il faut absolument lire ne serait-ce que La Puissance de la Terre. Chez Ouspensky, l’intuition artistique remplace la méthode marxiste et, à bien des égards, rivalise avec elle. C’est d’ailleurs pourquoi l’artiste Ouspensky se trouvait constamment en conflit mortel avec le narodnik Ouspensky. Aujourd’hui encore nous devons apprendre auprès de l’artiste ; nous pouvons y comprendre les puissants vestiges du servage dans la vie quotidienne des paysans, et en particulier leur vie familiale. Assez souvent, ces vestiges ressurgissent dans la vie quotidienne urbaine. À cet égard, il suffit d’écouter certaines notes de l’actuelle discussion sur la législation matrimoniale.
Dans toutes les parties du monde, le capitalisme a élevé à un degré extrême la contradiction entre l’industrie et l’agriculture, entre la ville et le village. Chez nous, du fait du retard de notre développement historique, cette contradiction a pris un caractère tout à fait monstrueux. Lorsque notre industrie s’efforçait d’imiter les modèles de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique, notre village demeurait au XVIIIe siècle, et même à des temps plus reculés. Même en Amérique, le capitalisme est évidemment incapable d’élever l’économie agricole au niveau de l’industrie. Cette tâche relève entièrement du socialisme. Dans nos conditions, avec la prédominance énorme du village sur la ville, l’industrialisation de l’agriculture est la partie la plus importante de la construction socialiste.
Par industrialisation de l’agriculture, nous entendons deux processus dont la combinaison seule peut, en dernière analyse, effacer définitivement la frontière entre la ville et le village. Arrêtons-nous un peu sur cette question cruciale.
L’industrialisation de l’agriculture implique d’abord de séparer de l’économie domestique rurale toute une série de branches de traitement préliminaire des matières premières industrielles et alimentaires. De manière générale, toute l’industrie est sortie du village à partir des métiers de l’industrie primitive, artisanale, via le détachement de certaines branches du système fermé de l’économie domestique à travers la spécialisation, la création d’un système d’apprentissage, le développement de la technique et, finalement, le recours aux machines. Notre industrialisation soviétique devra, dans une large mesure, suivre cette voie, c’est-à-dire la voie de la socialisation de toute une série de productions reliant l’agriculture, au sens strict du terme, à l’industrie. L’exemple des États-Unis montre que s’ouvrent devant nous des possibilités illimitées.
Mais tout cela n’épuise pas la question. L’élimination des contradictions entre l’agriculture et l’industrie suppose l’industrialisation des fermes agricoles, de l’élevage, de l’horticulture, etc. Cela signifie que ces secteurs de l’activité productive doivent être fondés sur une technologie scientifique : l’utilisation à bon escient et à grande échelle des machines, l’usage des tracteurs et de l’électricité, la fertilisation, une bonne rotation des cultures, un contrôle expérimental et centralisé des méthodes et des résultats, une bonne organisation de toute la production, et notamment une utilisation plus rationnelle de la main-d’œuvre, etc. Bien sûr, même une agriculture hautement organisée différera des industries mécaniques. En fait, même dans l’industrie, il y a de profondes différences entre ses diverses branches. Si nous nous permettons de différencier l’agriculture de l’industrie en général, c’est parce que notre agriculture est aujourd’hui réalisée sur des unités éparpillées, par des méthodes primitives, dans une dépendance servile aux conditions naturelles et aux conditions de vie très arriérées du paysan. Il ne suffit pas de socialiser, c’est-à-dire de transférer vers les usines des branches données de l’agriculture telles que la production de beurre, de fromage, de mélasse, etc. Il faut socialiser l’agriculture elle-même, c’est-à-dire la sortir de son actuel morcellement et, au lieu de gratter pitoyablement la terre, installer des « usines » scientifiquement organisées de blé et de seigle, des « usines » de vaches et de moutons, etc. Que cela soit possible, c’est ce que montre déjà l’expérience capitaliste, en particulier l’expérience agricole du Danemark, où même les poules sont soumises au plan et à la standardisation, de sorte qu’elles pondent de très grandes quantités d’œufs de taille et de couleur identiques.
L’industrialisation de l’agriculture signifie l’élimination de l’actuelle contradiction fondamentale entre le village et la ville, et par conséquent entre le paysan et l’ouvrier : du point de vue de leurs rôles dans l’économie du pays, de leurs conditions de vie, de leurs niveaux culturels, ils doivent se rapprocher jusqu’au point où s’efface la frontière entre eux. Une société dans laquelle l’agriculture mécanisée fera pleinement partie de l’économie planifiée, où la ville intégrera les avantages du village (vastes espaces, verdure), où le village sera enrichi des avantages de la ville (rues pavées, éclairage électrique, canalisations), où aura donc disparu l’opposition entre la ville et le village, où le paysan et l’ouvrier se transformeront en coopérateurs de même valeur et égaux en droits dans le cadre d’une production unifiée – une telle société sera authentiquement socialiste.
Le chemin vers cette société est long et difficile. Les étapes les plus importantes, sur ce chemin, sont les centrales électriques. Elles apporteront au village la lumière et l’énergie transformée en force : contre le pouvoir de la terre, le pouvoir de l’électricité !
Récemment, nous inaugurions la centrale de Chatoura, l’une de nos meilleures réalisations, qui est construite sur une tourbière. De Moscou à Chatoura, il n’y a qu’un peu plus de cent kilomètres. En un sens, c’est un jet de pierre. Et pourtant, quelles différences ! Moscou est la capitale de l’Internationale Communiste. Mais éloignez-vous de quelques dizaines de kilomètres – et c’est la nature sauvage, les marais gelés, les bêtes sauvages, des villages de cabanes en bois somnolant sous la neige. De la fenêtre d’un train, on peut voir, parfois, les traces des loups. Des élans demeuraient là où s’élève désormais la centrale, il y a quelques années, quand débutait le chantier. Désormais, la distance entre Moscou et Chatoura est jalonnée par la structure élégante de pylônes métalliques soutenant un fil de 115 000 volts. Et sous ces pylônes, renards et louves, au prochain printemps, feront naître leurs petits. Il en va ainsi de toute notre culture : elle est faite de contradictions extrêmes, c’est-à-dire de grands succès de la technique et de la pensée universelle, d’une part, et des conditions primitives de la taïga, d’autre part.
Chatoura vit sur une tourbière servant de pâturage. Vraiment, tous les miracles créés par l’imagination enfantine de la religion, et même par la fantaisie créatrice de la poésie, pâlissent devant ce simple fait : des machines, occupant un tout petit espace, dévorent le marais séculaire, le transformant en une énergie invisible et restituant celle-ci dans des lignes de haute tension jusqu’à cette industrie qui a produit ces mêmes machines.
Chatoura est une belle œuvre, créée par des constructeurs aussi dévoués que doués. Sa beauté n’est pas exposée, pas clinquante, mais provient de ses propriétés internes et des besoins de la technique. Le critère le plus élevé – et le seul – de la technique, c’est l’efficacité. Sa vérification est fournie par l’économie. Mais cela suppose la plus complète conformité entre les parties et le tout, les moyens et la fin. Les critères économiques et techniques coïncident entièrement avec l’esthétique. On peut dire sans paradoxe : Chatoura est belle parce que le kilowattheure de son énergie est meilleur marché que le kilowattheure des autres centrales se situant dans des conditions similaires.
Chatoura s’élève sur un marais. Il y a chez nous, en Union Soviétique, beaucoup plus de marais que de centrales électriques. Il y a chez nous beaucoup d’autres sortes de combustibles attendant leur transformation en force motrice. Plus au sud, le Dniepr traverse la région industrielle la plus riche ; il dépense en vain sa fantastique puissance, bondit sur des rapides d’âge immémoriaux, attend que nous domptions son courant par un barrage et le forcions à éclairer, animer, enrichir les villes et les champs. Nous le forcerons !
Aux États-Unis d’Amérique du Nord la consommation électrique, par an et par habitant, est de 500 kilowattheures. Chez nous elle est seulement de 20 kilowattheures, c’est-à-dire 25 fois moins. De manière générale, nous avons 50 fois moins de force motrice par personne qu’aux États-Unis. Le système soviétique doté de la technique américaine, ce sera le socialisme. Notre organisation sociale donnera à la technique américaine une application tout autre, incomparablement plus rationnelle. Mais la technique américaine transformera aussi notre organisation, la libérera de l’héritage de l’arriération et de la barbarie. De la combinaison de l’organisation soviétique et de la technique américaine naîtront une nouvelle technique et une nouvelle culture – une technique et une culture pour tous, sans privilégiés et sans exclus.
B. Le principe de la « chaîne de production » dans l’économie socialiste
Le principe de l’économie socialiste est l’harmonie, c’est-à-dire la continuité fondée sur la coordination interne. Techniquement, ce principe trouve sa plus haute expression dans la chaîne de production. En quoi consiste-t-elle ? En un tapis roulant (un « convoyeur ») qui apporte à l’ouvrier – ou emporte à partir de lui – tout ce qui est nécessaire à la marche du travail. On sait de quelle manière Ford utilise une combinaison de convoyeurs comme moyen de transport interne, de transmission et de commande. Mais la chaîne est quelque chose de plus important encore : elle représente une méthode de régulation de la production, car l’ouvrier doit impérativement conformer ses gestes au mouvement du convoyeur. Le capitalisme s’en sert pour obtenir une exploitation maximale de l’ouvrier. Mais cet usage est lié au capitalisme et non à la chaîne elle-même. En effet, de quel côté se dirige le développement des méthodes de régulation du travail : du côté du paiement aux pièces ou du côté de la chaîne ? Tout indique que c’est du côté de la chaîne. Le paiement aux pièces, comme tout autre aspect du contrôle individuel sur le travail, est caractéristique des premières phases du développement du capitalisme. Par ce procédé, on exerce une pression physiologique maximale sur chaque ouvrier individuel, mais sans coordination des efforts des différents ouvriers. Or ces deux tâches sont automatiquement accomplies par la chaîne de production. L’organisation socialiste de l’économie devra réduire la charge physiologique individuelle de l’ouvrier grâce à la croissance des capacités techniques, tout en sauvegardant la coordination des efforts des différents ouvriers. Telle est et telle sera la signification de la chaîne socialiste, à la différence de la chaîne capitaliste. Pour parler concrètement, le problème central consiste à conformer le mouvement du convoyeur au nombre d’heures de travail prévues – ou, au contraire, à régler le temps de travail sur la vitesse donnée du convoyeur.
Dans le système capitaliste, la chaîne est appliquée dans le cadre d’une entreprise individuelle comme une méthode de transport interne. Mais le principe de la chaîne en lui-même est beaucoup plus vaste. Chaque entreprise individuelle reçoit de l’extérieur des matières premières, du combustible, des consommables et de la main-d’œuvre supplémentaire. Les relations entre les entreprises, aussi gigantesques soient-elles, sont réglées par les lois du marché, même s’il est vrai que ces lois sont à bien des égards limitées par toutes sortes d’accords à long terme. Mais chaque usine prise séparément, et plus encore la société dans son ensemble, a intérêt à ce que les matières premières soient livrées à temps, sans traîner dans les stocks, sans interruption dans la production – bref, qu’elles soient livrées suivant le principe de la chaîne, en plein accord avec le rythme de la production. Pour cela, il n’est pas absolument nécessaire d’imaginer la chaîne comme un tapis roulant. Les différentes formes qu’elle peut prendre sont illimitées. Le chemin de fer, s’il travaille selon un plan, c’est-à-dire sans embouteillages, sans stockage saisonnier des marchandises, sans tous les éléments de l’anarchie capitaliste – et c’est ainsi que travaillera le socialisme, justement – sera une puissante chaîne de production garantissant aux usines la fourniture, en temps utile, de matières premières, de combustible, de matériel et de personnel. Cela s’applique aux paquebots, aux camions, etc. : toutes les formes de communication deviendront des moyens de transport au sein d’une économie globalement planifiée. Par exemple, le pipeline représente une sorte de chaîne pour les liquides. Plus étendu sera le réseau de pipelines, moins il y aura besoin de réservoirs, plus réduite sera la quantité de pétrole transformée en capital mort.
Le système de la chaîne n’implique pas que les entreprises soient géographiquement regroupées. Au contraire, la technique moderne permet leur dispersion – non de façon chaotique et accidentelle, mais en tenant compte de la localisation optimale pour chaque usine particulière. La possibilité d’une large distribution géographique des entreprises industrielles, sans laquelle la ville ne peut pas être diluée dans le village et le village dans la ville, est garantie dans une forte mesure par l’utilisation de l’énergie électrique comme force motrice. Le fil métallique est le convoyeur d’énergie le plus sophistiqué ; il ouvre la possibilité d’une diffusion de la force motrice dans les plus petites unités, qui peuvent être activées ou interrompues par la simple pression d’un bouton. De par ces propriétés, le « convoyeur » énergétique se heurte vivement aux cloisons de la propriété privée. Dans son développement actuel, l’électricité est la partie la plus « socialiste » de la technique. Et pour cause : c’est son secteur le plus avancé.
De ce point de vue, la chaîne hydraulique de l’agriculture – les systèmes d’irrigation et d’évacuation des eaux – marque un progrès gigantesque dans l’exploitation de la terre. Plus la chimie, l’industrie mécanique et l’électrification seront à même de libérer l’agriculture de l’emprise des éléments naturels, plus elle répondra à un plan, plus l’actuelle « économie villageoise » fera partie intégrante du système de la chaîne socialiste, qui règlera et coordonnera toute la production, à commencer par le sous-sol (extraction du minerai de charbon) et le sol (labourage, semailles des champs).
À partir de son expérience de la chaîne de production, le vieux Ford s’efforce d’élaborer une sorte de philosophie sociale. Cette tentative représente la très curieuse combinaison d’une expérience productive et administrative de très grande échelle avec l’insupportable étroitesse d’esprit du philistin auto-satisfait devenu multimillionnaire tout en demeurant un simple petit bourgeois qui a fait fortune. Ford dit : « si vous voulez la richesse pour vous et le bien-être pour vos concitoyens, faites comme moi ! ». Le philosophe Emmanuel Kant demandait à tout un chacun d’agir de telle façon qu’il puisse devenir une norme pour les autres. Au sens philosophique, Ford est donc kantien. Mais dans la pratique, la « norme », pour les 200 000 ouvriers de Ford, n’est pas la conduite de Ford ; c’est le rythme de ses convoyeurs : il détermine le rythme de leur vie, le mouvement de leurs mains, de leurs pieds et de leurs idées. Pour « le bien-être de nos concitoyens », il faut séparer le fordisme de Ford, le socialiser et le nettoyer. C’est ce que fera le socialisme.
Une question écrite, qui m’a été transmise, me demande : « Mais qu’en est-il de la monotonie du travail, de la dépersonnalisation, de la “déspiritualisation” dues au travail à la chaîne ? ». Cette crainte n’est pas fondée. Si vous réfléchissez et poussez cette objection jusqu’à son terme, vous en viendrez à critiquer la division du travail et le machinisme en général. C’est une voie réactionnaire. Il n’y a jamais rien eu et il n’y aura jamais rien de commun entre le socialisme et l’hostilité à l’égard du machinisme. La tâche essentielle, principale, et la plus importante, est d’en finir avec le besoin. Pour cela, il faut que le travail humain produise la plus grande quantité de biens possible. Pain, chaussures, vêtements, journaux : tout ce qui est nécessaire doit être produit en quantités telles que personne ne puisse craindre d’en manquer. Il faut abolir le besoin, et avec lui l’avidité.
La prospérité et le loisir doivent être conquis, et avec ceux-ci la joie de vivre pour tous. La plus haute productivité du travail est inaccessible sans le machinisme et l’automatisation, dont l’expression la plus achevée est la chaîne de production. La monotonie du travail sera compensée par la réduction de sa durée et sa facilité croissante. Il y aura d’ailleurs toujours des branches industrielles exigeant de la créativité individuelle, et il ne manquera pas de vocations pour y répondre et y faire leur chemin. Ce dont nous parlons, ici, c’est des productions basiques les plus importantes. Nul doute que de nouvelles révolutions technologiques – chimiques et énergétiques – supplanteront la mécanisation telle que nous la connaissons aujourd’hui. Mais laissons à l’avenir le soin de s’en occuper. Un voyage dans un bateau propulsé par des rames exige une grande créativité personnelle. Un voyage dans un bateau à vapeur est plus « monotone », mais plus confortable et plus sûr. En outre, vous ne pouvez pas traverser l’océan dans un canot à rames. Or nous devons traverser l’océan du besoin humain.
Il est bien connu que les besoins physiques sont beaucoup plus limités que les besoins spirituels. La satisfaction excessive des besoins physiques conduit vite à la satiété. Les besoins spirituels, eux, ne connaissent pas de limites. Mais pour que germent des besoins spirituels, la satisfaction complète des besoins physiques est nécessaire. Certes, nous ne pouvons pas reporter, et nous ne reporterons pas la lutte pour l’élévation du niveau spirituel des masses jusqu’au jour où nous n’aurons plus de chômage, plus d’enfants abandonnés et plus de misère. Tout ce qu’il est possible de faire doit être fait. Mais s’imaginer que nous pourrons créer une culture authentiquement nouvelle avant d’avoir garanti la prospérité, l’abondance et le loisir des masses, ce serait se livrer à un méprisable rêve éveillé. Nous devons et pouvons vérifier nos progrès à travers leurs reflets dans la vie quotidienne de l’ouvrier et du paysan.
C. La révolution culturelle
Je pense vous avoir démontré que la création d’une nouvelle culture n’est pas une tâche qui peut être réalisée indépendamment de notre travail économique et social en général.
Le commerce appartient-il à la « culture prolétarienne » ? D’un point de vue abstrait, on devrait répondre à cette question par la négative. Mais le point de vue abstrait ne convient pas. Dans l’époque de transition, et en particulier au stade initial où nous sommes, les biens produits prennent toujours – et prendront encore longtemps – la forme sociale de marchandises. Nous devons apprendre à les traiter comme telles, c’est-à-dire à correctement les vendre et les acheter. Sans cela, nous ne pourrons pas passer du stade initial au stade suivant. Lénine nous disait : « apprenez à vendre », et nous recommandait de prendre exemple sur l’Europe, dans ce domaine. Nous le savons bien : la culture du commerce est l’une des plus importantes composantes culturelles de la période de transition. Je ne sais pas s’il faut appeler « culture prolétarienne » cette culture commerciale de l’État ouvrier et des coopératives. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’une étape vers la culture socialiste.
Quand Lénine parlait de la révolution culturelle, il visait surtout l’élévation du niveau culturel des masses. Le système métrique est le produit de la science bourgeoise. Mais une grande tâche culturelle et révolutionnaire consiste à former 100 millions de paysans à l’usage de ce système de mesure simple. Il est pratiquement certain que nous n’y parviendrons pas sans l’aide du tracteur et de l’énergie électrique. La technologie est la base de la culture. L’instrument décisif de la révolution culturelle doit être une révolution technologique.
À propos du capitalisme, nous disons que le développement des forces productives est entravé par les formes sociales de l’État bourgeois et de la propriété bourgeoise. Ayant accompli la révolution prolétarienne, nous disons : le développement de nouvelles formes sociales dépend du développement des forces productives, c’est-à-dire de la technique. En ce sens, c’est d’abord l’industrialisation – et non la littérature ou la philosophie – qui sera le levier central de la révolution culturelle. J’espère que personne n’y verra, de ma part, une attitude malveillante ou irrespectueuse à l’égard de la philosophie et de la poésie. Sans pensée théorique et sans art, la vie humaine serait vide et misérable. Mais après tout, c’est bien ainsi qu’elle est pour des millions de personnes. La révolution culturelle doit leur fournir les conditions d’un véritable accès à la culture, et non à quelques-unes de ses miettes. Or cela suppose de créer des conditions matérielles très avancées. C’est pourquoi une machine qui fabrique automatiquement des bouteilles est pour nous, aujourd’hui, un facteur primordial de la révolution culturelle, tandis qu’un poème héroïque est seulement un facteur secondaire.
Marx disait : « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières ; ce qui importe, c’est de le transformer. » Il n’y avait là aucun dénigrement de la philosophie. Marx était l’un des plus grands philosophes de tous les temps. Ses mots signifiaient seulement que le développement ultérieur de la philosophie, comme de toute la culture en général (matérielle et spirituelle) exige une révolution dans les rapports sociaux. Et c’est pour cela que Marx, partant de la philosophie, a fait appel à la révolution prolétarienne – non contre la philosophie, mais justement pour celle-ci. De même, on peut dire aujourd’hui : il est bon que les poètes chantent la révolution et le prolétariat, mais une puissante turbine chante encore mieux. Nous avons beaucoup de chansons médiocres qui circulent dans des cercles restreints ; par contre, nous manquons cruellement de turbines. Je ne suis pas du tout en train de suggérer que la médiocrité des vers est ce qui empêche la production de turbines. Mais il est absolument nécessaire de bien orienter l’opinion publique, de parvenir à une bonne compréhension des véritables rapports entre les phénomènes, du pourquoi et du comment. Il ne faut pas comprendre la révolution culturelle de façon superficielle, idéaliste, ou comme quelque chose qui serait l’objet de petits groupes d’études. Cette question concerne le changement des conditions de vie, des méthodes de travail et des habitudes quotidiennes d’un grand peuple, de toute une famille de peuples. Seul le système puissant du tracteur permettra au paysan de redresser son dos pour la première fois de l’histoire ; seule une machine à souffler le verre produisant des centaines de milliers de bouteilles libérera les poumons des souffleurs de verre ; seule une turbine de dizaines, voire de centaines de milliers chevaux-vapeur, seul l’avion accessible à tous, toutes ces choses en même temps et d’autres encore permettront à l’ensemble de la population – et non seulement à une petite minorité – de bénéficier de cette révolution culturelle. Et seule une telle révolution méritera ce nom. Sur cette base fleuriront une philosophie nouvelle et un art nouveau.
Marx écrivait : « Les idées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les idées dominantes. » C’est aussi le cas lorsque c’est le prolétariat qui domine, mais d’une façon différente des autres classes. Une fois qu’elle a pris le pouvoir, la bourgeoisie a cherché à perpétuer sa domination. Toute sa culture était subordonnée à cet objectif. À l’inverse, le prolétariat, une fois au pouvoir, s’efforce d’écourter autant que possible la période de sa domination, c’est-à-dire de construire une société sans classes.
D. La culture et les mœurs
Vendre d’une manière cultivée, c’est d’abord arrêter de duper les acheteurs. C’est rompre, en somme, avec cette vieille tradition nationale dont la formule est : « si tu ne trompes pas, tu ne vendras pas ».
Le mensonge et la tromperie ne relèvent pas d’un défaut individuel ; il s’agit de fonctions (ou d’actions) de l’ordre social. Le mensonge est un moyen de la lutte et, par conséquent, découle de la contradiction entre les intérêts. Les contradictions fondamentales découlent des relations entre les classes. En ce sens, on peut dire que la tromperie est aussi vieille que les sociétés de classes. Mais en fait dans la lutte pour l’existence les animaux eux-mêmes, déjà, « rusent » et trompent. Et un rôle considérable a été joué par la tromperie – la ruse militaire – dans la vie des tribus primitives. Une telle tromperie découle plus ou moins directement de la lutte zoologique pour l’existence. Mais à partir de l’époque dite « civilisée », c’est-à-dire depuis l’apparition de la société de classes, le mensonge s’est terriblement complexifié ; il est devenu une fonction sociale, s’est réfracté suivant une ligne de classe, est devenu un élément organique, intégré, de la « culture » humaine. Le socialisme rejettera cette composante de la culture. Dans la société socialiste, et plus encore dans la société communiste, les relations sociales seront complètement transparentes, au sens où elles n’auront plus besoin de ces méthodes auxiliaires que sont la tromperie, le mensonge, la falsification, la contrefaçon, la trahison et la perfidie.
Cependant, nous en sommes encore loin. Dans nos relations et nos mœurs, il y a toujours beaucoup de mensonges qui s’enracinent, historiquement, aussi bien dans le servage que dans les rapports sociaux bourgeois. La plus haute expression idéologique du servage est la religion. Les rapports sociaux de la monarchie féodale se fondaient sur la tradition aveugle et s’élevaient jusqu’au mythe religieux. Le mythe est une interprétation imaginaire, fausse, des phénomènes naturels, des institutions sociales et de leurs relations. Cependant, les masses opprimées n’étaient pas les seules à croire au mythe trompeur ; la plupart de ceux au profit desquels était forgé le mythe – les dominants – y croyaient et s’en réclamaient « de bonne foi ». Une idéologie objectivement fausse, tissée de superstitions, n’implique pas la duplicité subjective. Mais avec la complexification croissante des rapports sociaux, c’est-à-dire le développement de l’ordre bourgeois, ce dernier entre en contradiction croissante avec le mythe religieux. La religion devient alors la source d’une tromperie toujours plus grande et raffinée.
L’idéologie bourgeoise s’est développée comme un rationalisme dirigé contre les mythologies. La bourgeoisie radicale a tenté de se passer de religion, de fonder son État sur la raison, et non sur la tradition. La démocratie bourgeoise – avec ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité – en fut une expression. Cependant, l’économie capitaliste a engendré une contradiction monstrueuse entre ces principes démocratiques et la réalité quotidienne. Pour masquer ces contradictions, il fallait un nouveau type de mensonge, plus élevé. La démocratie bourgeoisie, précisément, généralise d’une façon inédite le recours au mensonge politique. Il ne s’agit plus du mensonge « objectif » de la religion ; il s’agit de tromper le peuple de façon délibérée et organisée, au moyen d’une combinaison de méthodes très complexes. La technique du mensonge est cultivée non moins que la technique de l’électricité. La presse la plus mensongère se trouve dans les démocraties les plus « développées » : la France et les États-Unis.
Mais en même temps, il faut reconnaître qu’on commerce plus honnêtement en France que chez nous, et en accordant beaucoup plus d’attention aux exigences de l’acheteur. Lorsqu’elle atteint un certain degré de prospérité, la bourgeoisie renonce aux méthodes d’escroquerie de l’accumulation primitive – non sur la base de considérations morales abstraites, mais pour des raisons matérielles : la duperie, la contrefaçon et l’escroquerie nuisent à la réputation d’une entreprise et minent son développement. Les principes du commerce « honnête » découlent des intérêts du commerce lui-même à un certain stade de son développement ; ces principes entrent alors dans la morale établie, et l’opinion publique veille à leur respect.
Il est vrai que la guerre impérialiste a introduit des changements colossaux dans ce domaine ; elle a ramené l’Europe de l’Est loin en arrière. Mais dans l’après-guerre, les efforts de « stabilisation » du capitalisme ont eu raison des manifestations les plus dangereuses de la régression culturelle dans le domaine des rapports commerciaux. Quoi qu’il en soit, si l’on considère notre commerce soviétique dans sa globalité, c’est-à-dire de l’usine jusqu’au consommateur du village éloigné, on doit reconnaître que nous commerçons toujours d’une façon beaucoup moins cultivée que dans les pays capitalistes avancés. Cela résulte de notre pauvreté, de notre pénurie de marchandises, de notre arriération économique et culturelle.
Le régime de la dictature prolétarienne n’est pas moins hostile à la mythologie objectivement fausse du Moyen Âge qu’à la tromperie consciente de la démocratie capitaliste. Le régime révolutionnaire a tout intérêt à démasquer les relations sociales. Il a tout intérêt à l’honnêteté politique, à dire ce qui est. Mais on ne doit pas oublier que le régime de la dictature révolutionnaire est un régime de transition, et donc un régime contradictoire. L’existence de puissants ennemis nous oblige à recourir à la ruse militaire. Or la ruse est indissociable du mensonge. Il faut seulement que la ruse contre nos ennemis ne puisse pas tromper notre propre peuple, c’est-à-dire les masses laborieuses et leur parti. C’est une condition fondamentale de la politique révolutionnaire ; elle traverse comme un fil rouge toute l’œuvre de Lénine.
Chez nous, le nouvel État et les nouvelles formes sociales ont créé la possibilité et la nécessité d’un degré de franchise inédit, dans l’histoire, entre les gouvernants et les gouvernés. On ne peut pas en dire autant de nos rapports sociaux du quotidien, sur lesquels pèsent lourdement notre arriération économique, notre arriération culturelle et, en général, tout l’héritage du passé. Certes, nous vivons nettement mieux qu’en 1920. Mais la pénurie de très nombreux biens indispensables au bien-être marque toujours profondément notre vie et nos mœurs. Il en sera ainsi encore pendant de nombreuses années. Il en découle de grandes et de petites contradictions, de grandes et de petites disproportions, mais aussi la lutte liée à ces contradictions – et la ruse, le mensonge, la duperie liés à cette lutte. À cela, une seule issue : l’élévation du niveau de technique, tant dans la production que dans le commerce. Une orientation correcte, dans ce domaine, peut déjà contribuer à améliorer nos « mœurs ». L’interaction de l’amélioration de la technique et des mœurs nous permettra de progresser vers la construction d’une société de coopérateurs civilisés, c’est-à-dire vers la culture socialiste.
[1] Famoussov, personnage de la pièce de Griboïedov « Le malheur d'avoir trop d'esprit », officier supérieur petit-bourgeois pédant, tout imbu de son pseudo savoir. Son seul intérêt est de vivre dans le rang ; il a horreur de tout ce qui peut faire offense à l'autorité et déranger sa situation confortable.
[2] Bien entendu, cette question n'a rien de commun avec la mode d'un certain freudisme qui n'est qu'espièglerie et polissonnerie érotique. Une telle démangeaison de la langue n'a aucun rapport avec la science et indique seulement un état de dépression : le centre de gravité se déplace du cerveau à la moelle épinière… – Trotsky