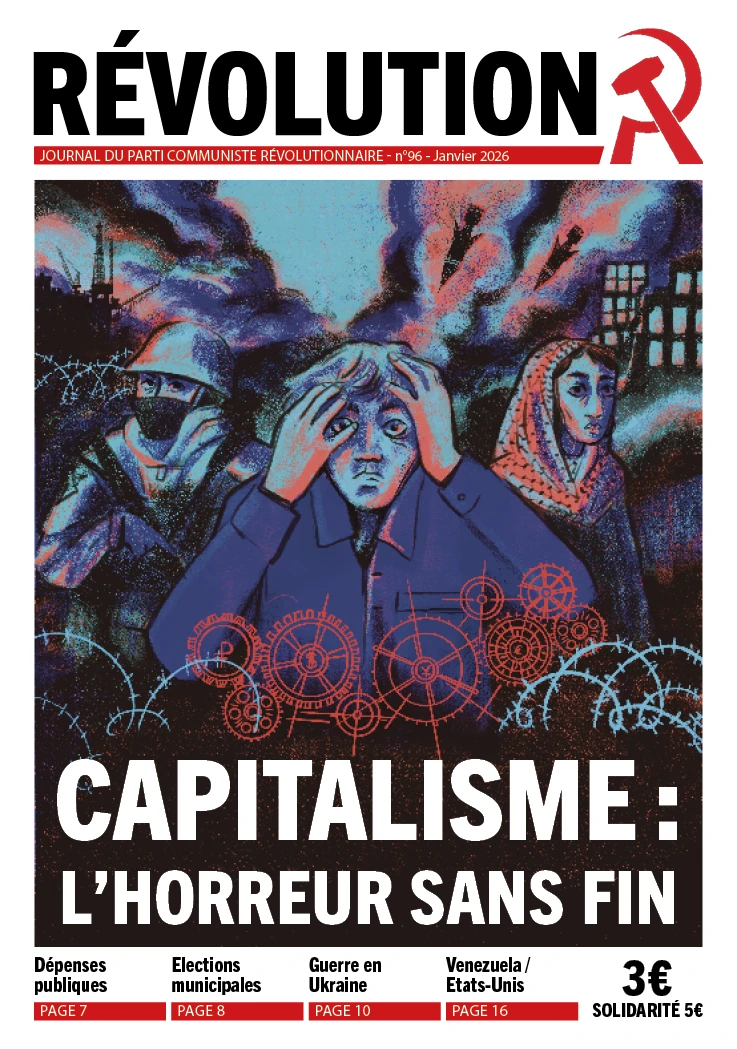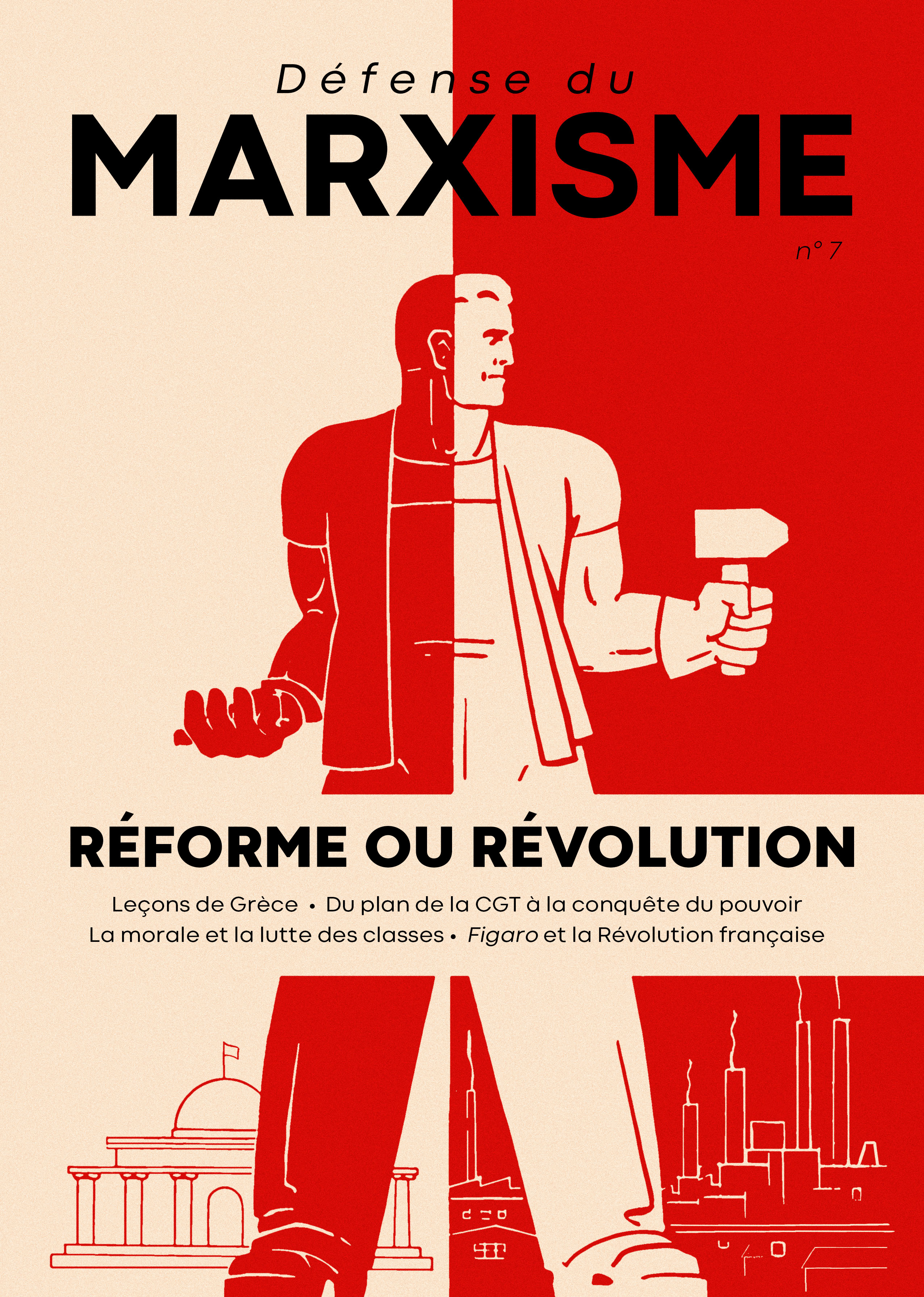La Résistance et la Libération figurent parmi les épisodes les plus remarquables de la lutte des classes en France. La mobilisation massive de la classe ouvrière ouvrait la perspective d’un renversement révolutionnaire du capitalisme. Cependant, les dirigeants du mouvement ouvrier – à commencer par ceux du Parti Communiste Français – ont trahi cette mobilisation. Ils ont tout fait pour remettre sur pied le capitalisme français et maintenir les peuples des colonies sous le joug de l’impérialisme français.
Le Parti Communiste et la guerre
Depuis sa stalinisation, au milieu des années 1920, le PC français est devenu un outil de la politique étrangère de l’URSS stalinienne [1]. Ce sont les intérêts de la bureaucratie du Kremlin – et non plus ceux de la révolution prolétarienne mondiale – qui déterminent l’orientation de sa ligne. Les virages brutaux dictés par Moscou ont parfois pris par surprise les dirigeants communistes français eux-mêmes.
Jusqu’à l’été 1939, Moscou cherche à conclure une alliance militaire avec la bourgeoisie française, que le PC présente comme une « amie de la paix » et de la « démocratie ». Or, en réalité, la Deuxième Guerre mondiale – comme la Première – n’est pas menée « pour la démocratie », mais oppose les « vieux » impérialismes français et britannique à leur « jeune » rival, l’impérialisme allemand, dont le nazisme n’était que l’« essence distillée », comme l’écrivait Trotsky. Loin de toute préoccupation « démocratique », la France et le Royaume-Uni tiennent sous leur joug des centaines de millions d’indigènes dans les colonies. Par ailleurs, dès le 26 août 1939, avant même que la guerre n’éclate, le gouvernement français interdit la presse communiste et trotskiste, avant d’interdire le PC lui-même, fin septembre.
Durant l’été 1939, fidèle à la ligne dictée par Moscou, Maurice Thorez, le principal dirigeant du PC, va jusqu’à s’engager démonstrativement dans l’armée française. Hélas pour lui, c’est avec Hitler que Staline décide finalement de signer un pacte militaire en août 1939. Thorez déserte en catastrophe et part à l’étranger, tandis que le PC dénonce la guerre qui vient d’éclater et qu’il approuvait jusqu’alors sans réserve.
En mai-juin 1940, les armées nazies balaient les troupes françaises et occupent Paris. Le 10 juillet, l’Assemblée nationale réfugiée à Vichy donne les pleins pouvoirs au Maréchal Philippe Pétain, qui instaure une dictature bonapartiste – le « régime de Vichy » – et proclame une politique de « collaboration » avec l’Allemagne. Si certains militants communistes entrent en résistance contre Vichy et l’occupant nazi dès l’été 1940, la politique officielle du PC reste très confuse. Certains de ses dirigeants tentent même (en vain) de négocier avec les nazis le droit de faire reparaître légalement leur journal, L’Humanité, au nom de l’alliance scellée par le pacte germano-soviétique.
L’invasion de l’URSS par l’armée allemande, en juin 1941, provoque un nouveau virage à 180 degrés : les différents PC du monde entier reçoivent de Moscou l’ordre d’aider à tout prix l’effort de guerre des Alliés. En France, le PC mène donc une politique d’alliance avec l’aile bourgeoise de la Résistance : il intègre en 1943 le gouvernement dirigé par De Gaulle, que l’URSS avait déjà reconnu comme seul dirigeant légitime dès décembre 1941, et adopte un discours essentiellement nationaliste. Il change même de nom en 1943 pour devenir le Parti Communiste Français (PCF), tandis que sa propagande adopte un ton anti-allemand plutôt qu’antifasciste. Au lieu de mettre l’accent sur une politique de classe – notamment vis-à-vis de la classe ouvrière allemande, qui subit elle aussi la botte nazie – L’Humanité clandestine avance le mot d’ordre : « chacun son boche » ! Les maquis qu’il contrôle ne combattent pas sous des insignes communistes, mais sous le drapeau tricolore, sans étoile rouge, ni faucille et marteau.
L’accumulation des défaites du Reich pousse progressivement de nombreux dirigeants bourgeois, et même certains pétainistes, à rallier la résistance. C’est par exemple le cas du général Alphonse Juin, passé du pétainisme au gaullisme en l’espace de quelques jours de novembre 1942, alors que les troupes américaines occupent l’Algérie, une colonie française. Au nom de « l’unité nationale », le PCF ferme les yeux sur cette « lessive » gaulliste.
De leur côté, les groupes de la résistance communiste bravent tous les risques. Pourchassés par la police de Vichy et par les Allemands, ils n’hésitent pas à organiser des diffusions de tracts, des grèves et même des manifestations publiques, au nez et à la barbe des autorités d’occupation. Des milliers de militants paieront ce dévouement de leur vie.
Le PCF bénéficie aussi de l’aura des victoires remportées par l’Armée Rouge en URSS. Aux yeux de la population française, les communistes deviennent une sorte d’incarnation de la Résistance à l’occupant nazi. A la Libération, le PCF est donc en position de force. Cependant, sa direction va tout faire pour restaurer le pouvoir de la bourgeoisie française, au lieu de la renverser.
Le soulèvement de l’été 1944
A partir de l’année 1944, la Résistance est devenue une force importante. Des dizaines de milliers de personnes ont rejoint les maquis, harcèlent les troupes allemandes et la Milice de Vichy. Si De Gaulle essaie de contenir au maximum l’action de la résistance gaulliste, pour la cantonner à un rôle de supplétif des forces régulières des Alliés, le PCF se jette à fond dans l’action clandestine et la guerre de guérilla.
La répression nazie s’intensifie durant l’année 1944, et particulièrement après les débarquements alliés en Normandie (6 juin 1944) et en Provence (15 août 1944). Plusieurs maquis (comme celui des Glières, en mars, ou celui du Vercors en juillet) sont la cible d’offensives allemandes et vichystes. Mais celles-ci subissent parfois des revers. En juillet 1944, un maquis communiste du Limousin, dirigé par l’ancien instituteur Georges Guingouin, résiste victorieusement à une offensive de l’armée allemande et de miliciens vichystes lors de la bataille du mont Gargan.
Tout au long de l’été 1944, alors que l’insurrection et l’action des maquis s’intensifient, les exactions commises par les Allemands et Vichy se multiplient. Le 9 juin, plus d’une centaine de civils sont pendus par les SS de la division Das Reich à Tulle (Limousin). Le lendemain, une autre unité de la même division incendie le village d’Oradour-sur-Glane après avoir massacré ses 640 habitants.
Après deux mois de combat acharnés en Normandie, les Alliés réussissent enfin à percer le front et s’avancent vers Paris. Dans le même temps, les unités débarquées en Provence remontent la vallée du Rhône vers le Nord, à la poursuite des troupes nazies en retraite. Mais partout ailleurs, notamment dans le Massif Central et dans le Sud-Ouest, la Libération est le fait des maquis qui investissent les villes. Dans de nombreuses régions, le pouvoir est alors entre les mains de la population insurgée.
Fin août 1944, la population de Paris se soulève à son tour. Cette insurrection, largement à l’initiative de la résistance communiste, terrifie les dirigeants alliés : ils craignent que le PCF n’en profite pour prendre le pouvoir. De Gaulle dépêche en urgence des troupes françaises, composées pour partie d’exilés républicains espagnols, qui vont libérer la ville « conjointement » avec sa population insurgée.
Mais le PCF a déjà reçu de Moscou des consignes strictes : il faut à tout prix restaurer l’autorité de l’Etat bourgeois. Staline espère en effet maintenir après la guerre les bonnes relations tissées avec les puissances impérialistes occidentales. La bureaucratie soviétique redoute aussi qu’une révolution prolétarienne victorieuse, dans un pays d’Europe occidentale, ne débouche sur un Etat ouvrier sain, dépourvu de bureaucratie, qui serait un « mauvais exemple » pour le peuple soviétique.
Le retour à « l’ordre »
Dans les régions libérées par la Résistance, De Gaulle dépêche en urgence des préfets, qui prennent la relève des organes de pouvoir issus de la Résistance, sans que ceux-ci ne résistent. Ce transfert de pouvoir s’opère avec le concours et l’approbation du PCF, de la CGT et de toutes les grandes organisations du mouvement ouvrier. La bourgeoisie est alors confrontée au problème du désarmement des « Milices patriotiques », prolongement des maquis qui ont mené la lutte armée contre Vichy et les Allemands. Renforcées à la libération par un afflux de volontaires, ces milices ont participé aux combats contre les Allemands durant l’automne, et ont parfois subi de lourdes pertes. Elles incarnent une autorité parallèle à celle de l’Etat bourgeois que la Résistance gaulliste est en train de restaurer. A la fin de l’automne, le PCF ordonne leur désarmement et l’intégration de leurs effectifs dans l’armée régulière, où ils se retrouvent parfois sous les ordres d’officiers ex-pétainistes, comme le général Juin.
Cette intégration est d’autant plus facile à faire accepter aux anciens résistants que la guerre n’est pas finie. Les Allemands occupent encore l’Alsace (Colmar n’est libérée qu’en février 1945), mais aussi de nombreux ports sur la côte atlantique ou de la Manche (comme Dunkerque, Saint-Malo ou La Rochelle). De nombreux résistants et maquisards rejoignent donc bien volontiers l’armée régulière pour continuer la lutte contre les Allemands. Nombre d’entre eux seront d’ailleurs tués dans ces combats de la dernière année de guerre. Ce contexte est d’une aide précieuse pour les efforts de « retour à l’ordre » du gouvernement et du PCF.
Pendant que les forces de la « Résistance intérieure » sont désarmées, la bourgeoisie protège l’appareil d’Etat. L’épuration « sauvage », menée spontanément par les maquisards durant les semaines de la Libération à l’été 1944, est remplacée par une épuration « légale », qui se montre particulièrement indulgente. Par exemple, alors que les préfets ont joué un rôle clé dans la répression de la Résistance et la déportation des juifs, un seul d’entre eux sera sanctionné : Maurice Papon, jugé et condamné en… 1998 !
De même, l’épuration légale ne frappe qu’une poignée de patrons : ceux trop ouvertement engagés dans la collaboration. C’est le cas de Louis Renault, qui a spontanément mis son entreprise au service de la Wehrmacht. Il est arrêté et meurt en prison en octobre 1944, tandis que ses usines sont nationalisées. Mais son cas est l’arbre qui cache la forêt. La grande majorité des patrons « collabos » ont pu continuer à jouir de leur fortune. Le patron du groupe L’Oréal, Eugène Schueller, a été en 1941 l’un des deux fondateurs d’un parti pro-nazi, le Mouvement social révolutionnaire, qui dénonçait le bolchevisme et la « pollution de la race » par les juifs. Il échappe pourtant à toute sanction à la Libération. Sa petite-fille, Françoise Bettencourt, est aujourd’hui la femme la plus riche du monde.
Un gouvernement d’unité nationale
Alors qu’ils ont joué un rôle prépondérant dans la Résistance, les communistes acceptent d’être largement minoritaires au sein du nouveau gouvernement, avec seulement deux ministres sur 21. Pour rassurer la classe dirigeante, tous les postes clés (Economie, Intérieur, Défense, etc.) restent entre les mains de ministres bourgeois ou de l’un des quelques ministres « socialistes », tous issus de l’aile la plus droitière de la SFIO.
Lors des élections d’octobre 1945, De Gaulle et son programme de République présidentielle aux relents vichystes sont largement rejetés par les électeurs. Il doit quitter le pouvoir. Le gouvernement est alors partagé entre trois partis : le PCF, arrivé en tête de tous les scrutins nationaux ; les socialistes ; un nouveau parti bourgeois, le Mouvement républicain populaire (MRP). Il faut noter que, comme tant d’autres, ce parti adopte alors un discours « socialiste ». Ce n’est pas très étonnant. Après 15 années de crise économique mondiale, de guerre impérialiste, de collaboration et de fascisme, le capitalisme et la bourgeoisie sont profondément discrédités. A l’inverse, le mouvement ouvrier est extrêmement puissant. Le PCF compte plus de 800 000 adhérents ; il contrôle la CGT, forte de plus de cinq millions de syndiqués. Mais au lieu de dénoncer l’hypocrisie des bourgeois du MRP, qui se proclament « socialistes » par calcul électoral, le PCF participe à un gouvernement avec eux dans le but de sauver le régime bourgeois.
Dans la mesure où le rapport de force l’empêche d’écraser la classe ouvrière, la classe dirigeante va la désarmer, la désorienter et, finalement, l’épuiser en s’appuyant sur la complicité des dirigeants du mouvement ouvrier. C’est ce processus que Ted Grant, en se basant sur les analyses de Trotsky sur l’Allemagne de Weimar, qualifiait de « contre-révolution sous une forme démocratique » 2.
La Sécurité sociale
Pour se maintenir au pouvoir, la classe dirigeante doit « lâcher du lest » et concéder une série de réformes sociales. La plus connue d’entre elles est la Sécurité sociale.
Ce n’est pas un projet nouveau. Dès l’avant-guerre, des « technocrates » bourgeois sortis des grandes écoles, proches des milieux bancaires et des grands industriels, envisageaient de nationaliser les assurances sociales, pour mettre fin au gâchis engendré par la concurrence entre les multiples firmes privées et les mutuelles syndicales. Leur objectif était de « rationaliser » le capitalisme français pour le rendre plus compétitif sur le marché mondial, en appuyant la finance et les grandes industries privées sur des services sociaux nationalisés et planifiés selon les intérêts de la classe dirigeante.
C’est sur ces projets que se base la Sécurité sociale mise en place à la Libération. Elle marque évidemment un véritable progrès pour nombre de travailleurs, qui sont ainsi relativement protégés contre la misère en cas de handicap ou de maladie. Mais elle représente aussi un intérêt certain pour la bourgeoisie. Le financement de ce nouveau régime doit être assuré « paritairement » par les salariés et les patrons. Mais en réalité, toute la richesse de la société est produite par les travailleurs ; les profits des patrons sont prélevés sur cette richesse. Ce système « paritaire » signifie donc que les salariés sont « taxés » deux fois : la première à travers la part de la richesse directement accaparée par le patron, la seconde par l’impôt et les cotisations sociales. La Sécurité sociale fait porter à l’ensemble de la société le poids financier de l’entretien médical des salariés, lesquels produisent les richesses des grands capitalistes et, dans le même temps, vont supporter le gros des efforts de la remise sur pied de l’économie française, pour le plus grand bénéfice de la classe dirigeante.
Les nationalisations et la « bataille de la production »
Avant 1939, l’industrie française était très en retard vis-à-vis des Etats-Unis ou de l’Allemagne. Les bombardements alliés, puis les sabotages effectués par les troupes allemandes en retraite ont dévasté le parc industriel et le réseau ferroviaire français. En 1945, le PIB français n’est qu’à 40 % de son niveau d’avant-guerre. Nombre de patrons et de politiciens bourgeois réclament alors l’intervention de l’Etat pour éponger les pertes et rationaliser la production.
Les mines de charbon, plusieurs entreprises de Crédit, le Gaz, l’Electricité, les quatre plus grandes banques et plusieurs autres entreprises passent sous le contrôle de l’Etat. Cependant, l’économie reste majoritairement privée. Un commissariat au plan est mis en place, mais cette « planification » n’est qu’indicative : elle se contente d’inciter les entreprises privées à investir dans des secteurs désignés par l’Etat, en les appâtant par des aides financières et des avantages fiscaux. Seuls des secteurs « stratégiques » sont nationalisés, pour faire peser le poids de leur remise sur pied sur l’ensemble de la population – et utiliser ensuite ces entreprises et infrastructures « rationalisées » pour aider le capitalisme français à être plus compétitif sur le marché mondial. La grande majorité de ces entreprises seront ensuite rendues au secteur privé, souvent pour une bouchée de pain. Par exemple, les banques seront privatisées dès les années 1960.
Toutes les nationalisations s’opèrent sans la participation des salariés et, parfois, sans même que les gestionnaires ne changent ! Quelques expériences de gestion ouvrière apparaissent pourtant spontanément. A Marseille, 15 entreprises sont « réquisitionnées » par la CGT locale après l’arrestation ou la fuite de leurs patrons « collabos ». Mais cette initiative reste isolée ; elle est même condamnée par la direction nationale du PCF, qui accuse les militants marseillais de « vouloir créer des soviets ». En 1947, l’Assemblée nationale vote à l’unanimité – y compris les députés communistes – une loi qui rend les entreprises réquisitionnées à leurs anciens propriétaires et les indemnise !
Au nom de l’intérêt national, les dirigeants du PCF soutiennent de toutes leurs forces cette remise sur pied du capitalisme français, qu’ils qualifient de « bataille de la production », mais qui se mène sur le dos de la classe ouvrière. Entre 1945 et 1948, la productivité du travail est multipliée par deux alors que le pouvoir d’achat moyen recule d’un tiers. L’inflation atteint près de 60 % en 1946 et 1947. La faim se fait toujours sentir et les « tickets de rationnement » restent en vigueur jusqu’en 1949.
Ces souffrances n’empêchent pas le PCF de conseiller aux travailleurs de « produire d’abord, revendiquer ensuite ». En juillet 1945, Maurice Thorez prononce un discours devant des mineurs du Nord qui travaillent dans des puits extrêmement dangereux, suite aux sabotages opérés par les Allemands. Thorez proclame alors : « Produire, c’est aujourd’hui la forme la plus élevée du devoir de classe, du devoir des Français. Hier, notre arme était le sabotage, l’action armée contre l’ennemi ; aujourd’hui, l’arme, c’est la production pour faire échec aux plans de la réaction. »
La défense de l’empire colonial français
Durant la conférence de Brazzaville, en 1944, De Gaulle avait soulevé de grands espoirs en parlant d’une future « participation indigène » à la gestion des colonies. Des dizaines de milliers d’« Indigènes » ont combattu dans les rangs des Forces Françaises Libres (FFL). Ils représentent près de 60 % des effectifs combattants en 1944, et environ la moitié des morts au combat. Mais leurs espoirs sont vite déçus.
Après les débarquements de Normandie (6 juin 1944) et de Provence (15 août 1944), l’état-major français organise le « blanchiment » de ses troupes. Les soldats coloniaux sont désarmés, puis renvoyés dans les colonies où l’administration coloniale les attend de pied ferme. A Thiaroye, au Sénégal, des soldats indigènes réclament leurs arriérés de solde impayés : ils sont massacrés par dizaines.
Le 8 mai 1945, des nationalistes algériens organisent une manifestation à Sétif pour fêter la capitulation nazie et réclamer l’égalité des droits politiques. Ils sont férocement réprimés. Un soulèvement éclate ; il est écrasé dans le sang. L’armée française et des milices de colons massacrent entre 10 000 et 40 000 Algériens. Le PCF approuve la répression de ce qu’il qualifie de « complot fasciste » animé par des « provocateurs hitlériens ». L’Humanité du 12 mai 1945 appelle même à « châtier impitoyablement et rapidement les organisateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l’émeute ».
En Indochine, Hô Chi Minh proclame l’indépendance du Vietnam le 21 septembre 1945. Un an plus tard, en novembre 1946, l’armée française bombarde le port d’Haiphong et déclenche la guerre d’Indochine. A Madagascar, un soulèvement indépendantiste éclate en mars 1947. Il échoue et sa répression fait entre 11 000 et 100 000 morts. Dans ces deux cas, le PCF a protesté plus ou moins mollement, mais il est quand même resté au gouvernement, sacrifiant les peuples colonisés sur l’autel de la « reconstruction ».
Les grèves de 1947
Au ministère du Travail, les communistes font certes avancer le Code du travail et la Sécurité sociale, mais ils poussent aussi au travail à outrance et tentent de contenir la lutte des classes lorsqu’elle finit par refaire surface après trois années de « bataille de la production ».
 En avril 1947, une grève éclate à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt – nationalisée en 1945 – pour protester contre la réduction des rations de pain par le gouvernement. Le PCF condamne cette grève et celles qui éclatent dans son sillage comme des manœuvres « irresponsables », car elles risquent de nuire à la productivité des entreprises nationalisées. Mais l’autorité du parti sur la classe ouvrière n’est plus aussi forte qu’en 1945. Le secrétaire de la CGT Métallurgie, Eugène Hénaff, est même hué par les grévistes de Renault lors d’un meeting. Les grèves se développent sans que les dirigeants communistes ne parviennent à les arrêter. Dans certaines villes, elles prennent un caractère explosif : à Nevers et à Lyon, la préfecture est envahie par les manifestants.
En avril 1947, une grève éclate à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt – nationalisée en 1945 – pour protester contre la réduction des rations de pain par le gouvernement. Le PCF condamne cette grève et celles qui éclatent dans son sillage comme des manœuvres « irresponsables », car elles risquent de nuire à la productivité des entreprises nationalisées. Mais l’autorité du parti sur la classe ouvrière n’est plus aussi forte qu’en 1945. Le secrétaire de la CGT Métallurgie, Eugène Hénaff, est même hué par les grévistes de Renault lors d’un meeting. Les grèves se développent sans que les dirigeants communistes ne parviennent à les arrêter. Dans certaines villes, elles prennent un caractère explosif : à Nevers et à Lyon, la préfecture est envahie par les manifestants.
Pour la bourgeoisie, la participation du PCF au gouvernement n’est donc plus aussi intéressante qu’auparavant. C’est d’autant plus le cas que la guerre froide a commencé. En mai 1947, le PCF est brutalement chassé du gouvernement par ses anciens alliés de la SFIO et du MRP.
Le PCF se rallie alors progressivement au mouvement de grève qu’il a d’abord condamné, mais ce retournement intervient trop tard : le mouvement s’est épuisé et commence à refluer à partir de décembre 1947. Pour l’achever, la bourgeoisie recourt à un mélange de répression et de concessions, notamment une prime généralisée de 1500 francs et la hausse des allocations familiales.
Cette défaite laisse des traces. Les zigzags de la direction du PCF aident la bourgeoisie à diviser le mouvement syndical. Fin 1947, l’aile droite de la CGT, appuyée par des militants sectaires, scissionne et créée une « CGT-Force Ouvrière » qui est financée par l’impérialisme américain, mais reste très minoritaire.
En 1948, un nouveau mouvement de grève éclate parmi les mineurs du Nord. Si le PCF le soutient et joue un rôle clé dans son organisation, la direction du parti ne fait aucune tentative pour l’étendre à d’autres secteurs. Les dirigeants staliniens espèrent négocier avec le pouvoir, et peut-être même revenir au gouvernement. Isolée, la grève des mineurs est brutalement réprimée par le gouvernement, qui envoie les CRS et l’armée. Plusieurs grévistes sont tués. Le mouvement finit par refluer en novembre 1948.
Les années de la Libération et de l’après-guerre ont été une occasion manquée de renverser le capitalisme français. Les travailleurs étaient massivement organisés et profondément hostiles à l’ordre bourgeois, tandis que la classe dirigeante était discréditée par la collaboration et Vichy. Si le PCF avait été un véritable parti marxiste et révolutionnaire, il aurait pu s’appuyer sur l’enthousiasme et la mobilisation révolutionnaire des masses ouvrières et paysannes pour engager une offensive révolutionnaire contre le capitalisme. Par exemple, il aurait été possible de s’appuyer sur les réquisitions spontanées d’entreprises – comme celles de Marseille – pour mener une campagne déterminée de nationalisations des grands leviers de l’industrie et des infrastructures, sous le contrôle de la classe ouvrière. De même, si les Comités de libération et les Milices patriotiques avaient été maintenus et organisés à l’échelle nationale, ils auraient pu constituer l’architecture d’un Etat ouvrier. Celui-ci aurait pu renverser l’Etat bourgeois discrédité par la collaboration et mener une véritable épuration de tous les criminels collaborateurs du nazisme et de Pétain. A l’échelle mondiale, l’état d’esprit de la classe ouvrière était tel que les impérialistes américains et britanniques n’auraient pas pu lancer leurs troupes dans une intervention militaire contre la révolution socialiste en France.
De manière générale, si le mouvement ouvrier – et en premier lieu le PCF – avait jeté toute son autorité dans une lutte révolutionnaire contre le capitalisme, la classe dirigeante n’aurait rien pu faire. Au lieu de cela, les dirigeants staliniens ont préféré sauver le capitalisme français. Le PCF a payé un lourd tribut à cette politique de collaboration de classes. Entre 1946 et 1951, il est passé de plus de 800 000 membres à 220 000. Il a aussi perdu près d’un million d’électeurs.
Aujourd’hui, les jeunes et les travailleurs qui veulent abattre ce système doivent tirer les leçons de cette trahison et mettre sur pied une direction révolutionnaire déterminée à mener la classe ouvrière jusqu’à la victoire.