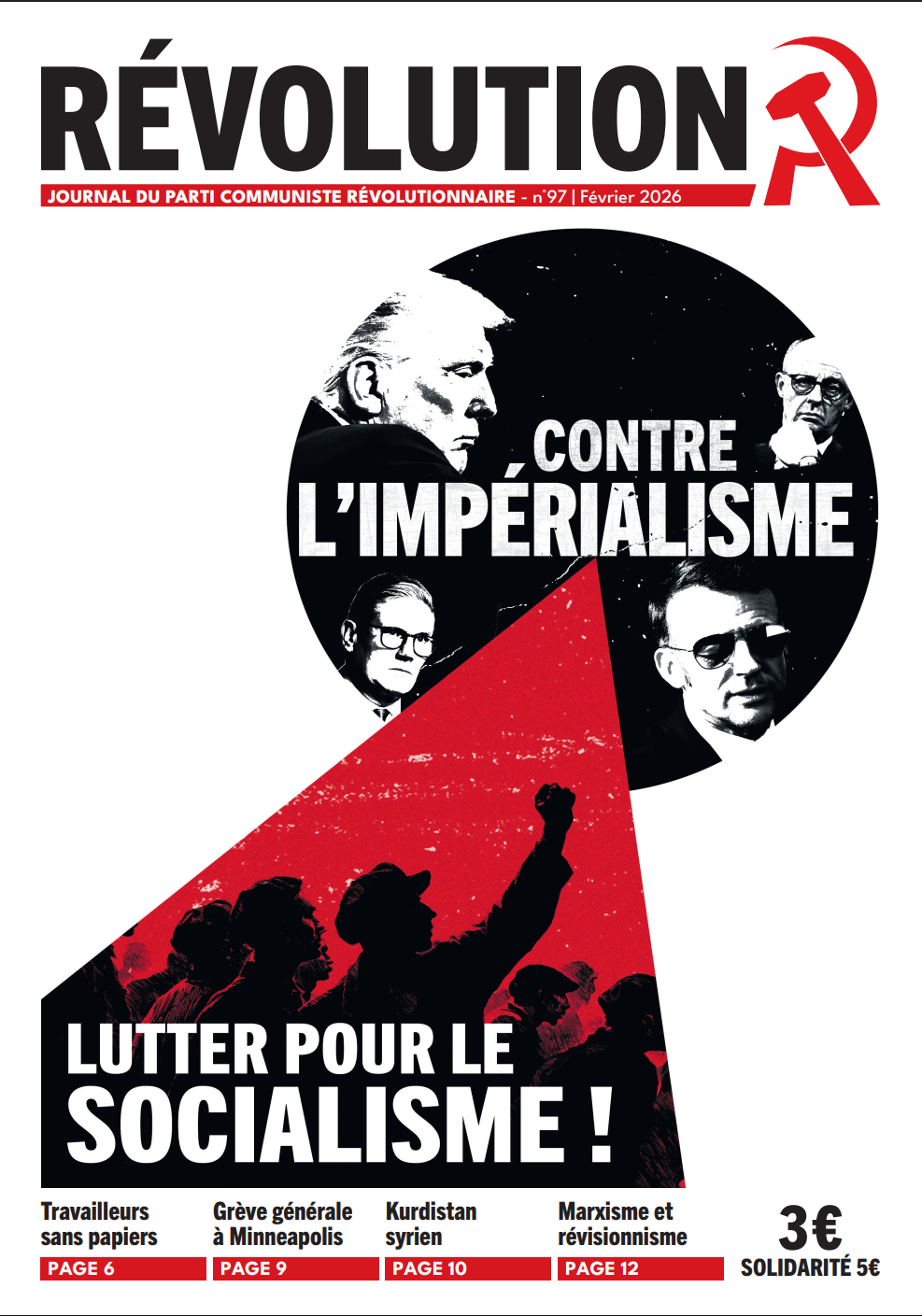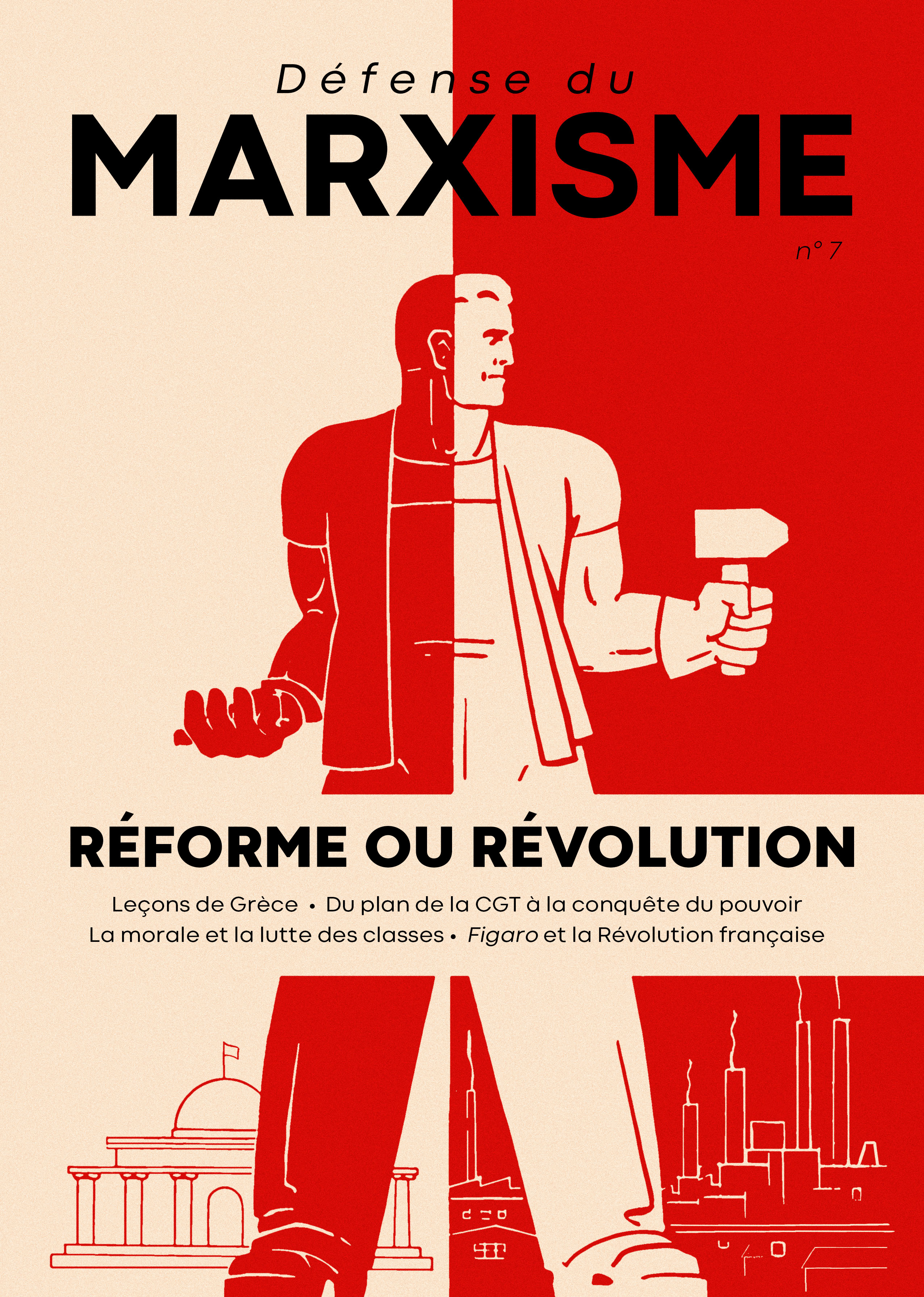Chaque année, à l’occasion du 1er mai, des millions de travailleurs à travers le monde manifestent pour exprimer leur aspiration à une vie meilleure. Il s’agit d’une tradition établie du mouvement ouvrier… qui peut s’accompagner, parfois, du sentiment de n’être qu’un acte purement symbolique. En revenant sur ses origines, on constate qu’elle conserve pourtant toute sa pertinence.
Le massacre de Haymarket Square
Le 1er mai naît à la fin du XIXe siècle, du projet d’organiser une journée de débrayage pour réclamer l’instauration d’une durée maximale de la journée de travail de 8 heures, sous le mot d’ordre : « 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de repos. »
C’est aux Etat-Unis qu’est organisée en 1886 la première de ces journées de lutte. La date du 1er mai est choisie car elle correspond au début de l’année comptable, et donc aussi à la fin des contrats des ouvriers. Le 1er mai 1886, plus de 300 000 travailleurs américains manifestent dans les grandes villes du pays. La répression est brutale. A Chicago, trois grévistes des usines sont tués. Lors de la manifestation organisée pour protester contre leur assassinat, une bombe posée par un provocateur inconnu fait plusieurs morts et de nombreux blessés. La police saisit ce prétexte pour tuer plusieurs grévistes. C’est le tristement célèbre massacre de Haymarket Square[1].
Lors du procès des militants arrêtés, le procureur offre une démonstration frappante de l’« impartialité » de la justice bourgeoise, en déclarant : « Nous savons que ces huit hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient, mais ils ont été choisis parce qu’ils sont des meneurs ; Messieurs du jury, faites d’eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. » Malgré l’absence de toute preuve sérieuse, 5 militants ouvriers sont condamnés à mort et 3 autres à la prison à perpétuité.
Internationalisme
Dès son premier congrès en 1889, la deuxième Internationale adopte la revendication de la journée de 8 heures et la date du 1er mai en hommage aux grévistes tués à Chicago, donnant à cette manifestation un caractère internationaliste.
Engels le souligne dans une préface au Manifeste du parti communiste qu’il rédige le 1er mai 1890 : « Au moment où j’écris ces lignes, le prolétariat d’Europe et d’Amérique passe la revue de ses forces, pour la première fois mobilisées en une seule armée, sous un même drapeau et pour un même but immédiat : la fixation légale de la journée normale de huit heures, proclamée dès 1866 par le Congrès de l’Internationale à Genève, et de nouveau par le Congrès ouvrier de Paris en 1889. Le spectacle de cette journée montrera aux capitalistes et aux propriétaires fonciers de tous les pays que les prolétaires de tous les pays sont effectivement unis. »
Plusieurs mobilisations de masse, mais aussi la crainte profonde par la bourgeoisie d’une « contagion révolutionnaire » après la révolution russe, permettent d’arracher la journée de 8 heures. En France, c’est le cas en 1919. Mais l’obtention de cette revendication historique ne met pas fin aux grandes mobilisations du 1er mai.
La bourgeoisie tente alors d’émousser le tranchant révolutionnaire et internationaliste de cette journée. En 1941, le régime de Pétain transforme ainsi le 1er mai en un jour férié consacré à « la fête du Travail et de la Concorde sociale ». Cette journée de mobilisation de lutte des classes est ainsi officiellement transformée en une commémoration de l’entente entre les classes. Aujourd’hui encore, des dirigeants bourgeois reprennent la même idée. Le 1er mai 2019, Emmanuel Macron avait ainsi souhaité une bonne fête à « ceux qui aiment le travail ».
Cette soi-disant unité des exploités et des exploiteurs autour du totem du « Travail » apparaît de plus en plus abstraite alors que s’aggrave la crise du capitalisme. Quelle unité pourrait être possible quand la bourgeoisie mène une offensive générale contre notre classe ?
Comme l’écrivait la grande marxiste Rosa Luxemburg en 1894 : « aussi longtemps que la lutte des travailleurs contre la bourgeoisie et les classes dominantes continuera, aussi longtemps que toutes les revendications ne seront pas satisfaites, le 1er mai sera l’expression annuelle de ces revendications. »
[1] Le 1er mai a aussi ses martyrs en France. À Fourmies, dans le Nord, neuf manifestants, dont deux enfants, furent abattus par l’armée à l’occasion du 1er mai 1891.