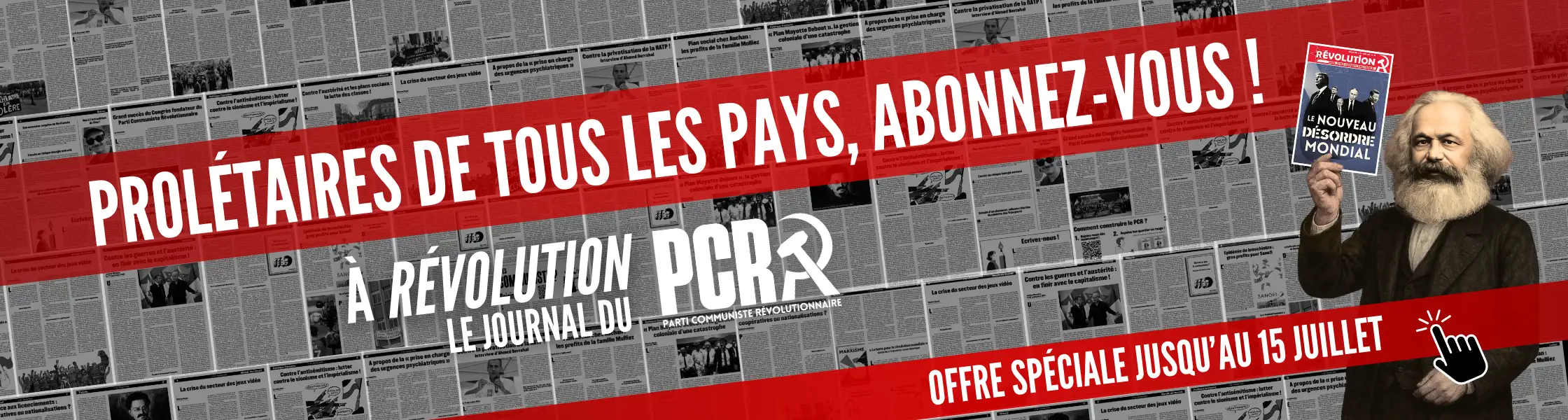Le 1er juillet 1921, le Parti communiste chinois (PCC) était fondé lors d’un congrès clandestin dans la concession française de Shanghai. Le parti ne comptait alors que 57 membres. Quelques années plus tard, il en comptait des milliers et jouait un rôle crucial dans la révolution chinoise de 1925-1927. Ses militants firent preuve d’un dévouement sans bornes. Malheureusement, la politique imposée par la direction stalinienne de l’Internationale Communiste mena la révolution dans une impasse et le PCC au massacre.
La Chine en 1900
Au début du XXe siècle, la Chine est un géant de près de 400 millions d’habitants. Ses pieds d’argile, ce sont ses structures sociales et politiques archaïques : un régime impérial en complète décadence – dont la postérité a retenu les complots incessants des eunuques de la Cité interdite – et une économie agraire reposant sur l’exploitation brutale des masses paysannes par une minorité de grands propriétaires terriens. Moins de 10 % de la population possède plus de 50 % des terres. Près de 70 % des paysans sont contraints de louer des terres à des tarifs dépassant souvent la moitié des revenus de leur récolte. Chaque année, de nombreux paysans pauvres sont chassés de leurs terres par leurs créanciers.
Profitant de la faiblesse du pays, les puissances impérialistes ont obtenu, par la guerre ou la menace, des avantages commerciaux exorbitants. Le Royaume-Uni a même fait deux guerres à la Chine pour que celle-ci autorise les trafiquants britanniques à y vendre de l’opium, alors que cette drogue est interdite en Grande-Bretagne. En 1860, pendant la deuxième de ces « guerres de l’Opium », les troupes françaises et britanniques pillent et détruisent le Palais d’Eté, un chef-d’œuvre de l’architecture chinoise. Victor Hugo lui-même dénonce cet acte de barbarie : « Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le Palais d’Eté. L’un a pillé, l’autre a incendié. [...] L’un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l’autre a empli ses coffres ; et l’on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l’histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l’histoire, l’un des deux bandits s’appellera la France, l’autre s’appellera l’Angleterre. » [1]
Les puissances impérialistes ont aussi extorqué des « concessions » : des territoires qui restent officiellement chinois, mais dans lesquels les impôts, la police, les douanes, etc., sont gérés par la puissance coloniale concernée. La Chine est ainsi ravalée au rang de semi-colonie.
Avec les armées étrangères arrive le capitalisme, toujours à la recherche de nouveaux marchés, de main-d’œuvre et de matières premières. Il implante des usines d’où sortent une bourgeoisie « compradore » (employée par les capitalistes occidentaux) et surtout une classe ouvrière – petite mais concentrée dans les usines géantes des concessions. En 1919, la moitié des ouvriers industriels de Chine travaillent dans la seule ville de Shanghai.
En 1905, le docteur Sun Yat-sen fonde le parti nationaliste, le Kuomintang, qui devient le principal parti d’opposition au régime impérial. Son programme est un mélange confus de libéralisme, de nationalisme et de socialisme réformiste. Il prône la modernisation de la société chinoise et sa libération de la domination étrangère – mais, dans le même temps, il cherche à s’assurer le soutien des puissances impérialistes.
La confusion de son programme est le reflet de l’impuissance de la bourgeoisie chinoise, que le Kuomintang représente : cette classe est dépendante du soutien des impérialistes étrangers, et ne peut donc pas les combattre résolument ; elle est liée par des milliers de liens familiaux et commerciaux aux grands propriétaires terriens, et ne peut donc pas réclamer une véritable réforme agraire ; enfin, elle a besoin de l’appareil d’Etat réactionnaire pour réprimer les mobilisations de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre, et ne peut donc pas sérieusement lutter pour la démocratie. Cette situation n’est pas propre à la Chine ; elle existait aussi dans la Russie d’avant 1917 et dans tous les pays où le capitalisme s’était développé sous perfusion de l’impérialisme.
C’est ce qui avait conduit le marxiste russe Léon Trotsky à élaborer la théorie de la « révolution permanente ». La bourgeoisie russe étant incapable de diriger « sa » révolution « démocratique », cette tâche revenait à la classe ouvrière, qui devait entraîner derrière elle la paysannerie pauvre pour lutter contre le régime tsariste, mais aussi – dans le même mouvement – contre l’impérialisme et le capitalisme. [2] Cette analyse de Trotsky s’applique parfaitement à la Chine du premier quart du XXe siècle.
1911 : la révolution inachevée
En octobre 1911, de jeunes officiers de l’armée impériale chinoise se mutinent. En quelques semaines, leur rébellion s’étend à tout le pays, à la grande stupéfaction des dirigeants bourgeois du Kuomintang. Le régime impérial est tellement rongé par la corruption et les intrigues qu’il est incapable de résister. En janvier 1912, la République de Chine est proclamée. Le mois suivant, le jeune empereur Puyi – alors âgé de six ans – abdique.
Rentré d’exil, Sun Yat-sen est proclamé président, mais est très vite relégué au second plan par une clique réactionnaire dirigée par Yuan Shikai, ancien ministre impérial. Par la suite, cette situation ne fait qu’empirer. L’inconstance et les hésitations du Kuomintang favorisent une vague de réaction qui culmine dans une tentative avortée de rétablissement de l’Empire en 1917.
Des provinces entières font alors sécession – notamment le Tibet, dont les dirigeants craignent que la révolution ne remette en cause leur pouvoir théocratique. D’autres provinces tombent aux mains de « seigneurs de la guerre » rivaux. La Chine bascule dans une guerre civile généralisée.
Sun Yat-sen et ses partisans se réfugient au sud du pays, à Canton, pour y fonder leur propre gouvernement. Le Kuomintang est alors convaincu que la solution aux problèmes de la Chine passe par une intervention des puissances impérialistes, qui viendraient « rétablir l’ordre » en Chine.
Loin de mettre fin aux désordres, les puissances impérialistes en profitent pour asseoir leur influence. C’est particulièrement le cas du Japon. Après avoir gagné une guerre contre la Chine en 1895 (ce qui lui a permis d’annexer l’île de Taïwan), puis envahi la Corée aux prix d’une guerre contre la Russie en 1904-1905, le Japon impérial lorgne à nouveau vers la Chine. En 1915, le gouvernement japonais exige que la Chine reconnaisse officiellement la tutelle japonaise – une exigence que le gouvernement officiel de Pékin finit par accepter au début de 1919.
Dès que cette nouvelle se répand, en mai 1919, c’est l’explosion : les étudiants de Pékin, entraînant derrière eux les masses populaires, organisent des meetings de protestation et engagent la première grève politique de masse de l’histoire du pays. Le soulèvement est finalement écrasé par les troupes coalisées des seigneurs de la guerre. Mais ce « mouvement du 4 mai » marque un tournant : pour la première fois, les masses chinoises ont joué un rôle central dans la vie politique du pays. Quant à l’échec du mouvement, il pousse de nombreux intellectuels radicaux à se tourner vers la révolution qui l’a emporté deux ans plus tôt, en Russie.
Le PCC, l’IC et le Kuomintang
De nombreux intellectuels, lettrés ou étudiants, cherchent une explication rationnelle au chaos dans lequel est plongé la Chine. Nombre d’entre eux se plongent dans l’étude des idées marxistes et traduisent les quelques œuvres de Marx, Engels, Lénine et Trotsky qui atteignent la Chine. Dispersés en une dizaine de différents petits groupes, ils s’efforcent d’entrer en contact avec les premiers syndicats qui commencent à apparaître.
Le mouvement du 4 mai les pousse à se rassembler en un parti unifié. En juillet 1921, un congrès clandestin rassemble douze délégués et un représentant de l’Internationale Communiste (IC) – le hollandais Maring – dans la concession de Shanghai. Le Parti communiste chinois (PCC) est né. Dirigé par Chen Duxiu, le « premier des marxistes chinois », il compte 57 membres, principalement des universitaires. Lors de son deuxième congrès, l’année suivante, ses effectifs sont montés à 123 adhérents. Lors de ce congrès, il propose au Kuomintang un « front unique anti-impérialiste », que Sun Yat-sen s’empresse de rejeter.
A cette époque, la position de l’IC est très claire. Lors de son deuxième congrès, en 1920, Lénine introduit lui-même la discussion sur les questions nationales et coloniales. Les « thèses » adoptées à cette occasion affirment :
« Il existe dans les pays opprimés deux mouvements qui, chaque jour, se séparent de plus en plus : le premier est le mouvement bourgeois démocratique nationaliste qui a un programme d’indépendance politique et d’ordre bourgeois ; l’autre est celui des paysans et des ouvriers ignorants et pauvres pour leur émancipation de toute espèce d’exploitation. Le premier tente de diriger le second et y a souvent réussi dans une certaine mesure. Mais l’Internationale Communiste et les partis adhérents doivent combattre cette tendance et chercher à développer les sentiments de classe indépendants dans les masses ouvrières des colonies. L’une des plus grandes tâches à cette fin est la formation de partis communistes qui organisent les ouvriers et les paysans et les conduisent à la révolution et à l’établissement de la République soviétique. [...] La révolution dans les colonies, dans son premier stade, ne peut pas être une révolution communiste, mais si dès son début, la direction est aux mains d’une avant-garde communiste, les masses ne seront pas égarées et dans les différentes périodes du mouvement leur expérience révolutionnaire ne fera que grandir. » [3]
Les conclusions pratiques de cette perspective sont identiques à celles de la théorie de la « révolution permanente » : elles s’appliquent incontestablement à la position que le jeune PCC devrait adopter vis-à-vis du Kuomintang, dans l’intérêt de la révolution socialiste.
En août 1922, Maring, au nom de l’Internationale, propose pourtant l’adhésion individuelle des communistes chinois au Kuomintang. Il explique qu’il s’agit de faciliter le développement du PCC en utilisant le Kuomintang comme une « passerelle » vers les masses, tout en « poussant » le parti nationaliste vers la gauche. Tous les membres du bureau politique du PCC s’opposent alors à ce qui leur apparaît, à juste titre, comme une subordination du parti à un mouvement bourgeois.
Ce tournant s’explique par les transformations que commence à subir l’IC. Conçue par Lénine et Trotsky comme le « parti mondial de la révolution », l’IC est en train de se transformer en un outil de la bureaucratie stalinienne qui s’empare progressivement du pouvoir en URSS. Le principal objectif de cette bureaucratie est de défendre son pouvoir et ses privilèges. Elle abandonne progressivement la perspective de la révolution mondiale au profit de la « construction du socialisme dans un seul pays », une théorie anti-marxiste avancée pour la première fois par Staline en 1924. Lénine a consacré son dernier combat à la lutte contre cette bureaucratie montante. Après sa mort, c’est Trotsky et l’« opposition de gauche » qui ont repris le flambeau de cette lutte pour défendre le bolchevisme authentique contre le stalinisme. [4]
Cette bureaucratisation de l’URSS et l’IC explique l’attitude de celle-ci sur la question chinoise. Plutôt que d’aider au renforcement autonome du PC chinois, la direction bureaucratisée de l’IC en fait un instrument de sa diplomatie vis-à-vis du Kuomintang, qui contrôle déjà une portion du territoire chinois. Pour justifier cette politique, les dirigeants staliniens de l’IC abandonnent les idées défendues par Lénine en 1920 au profit d’une conception empruntée aux réformistes russes, les mencheviks : la révolution chinoise étant une « révolution bourgeoise », le Kuomintang – qui représente la bourgeoisie chinoise « nationale et progressiste » – devrait la diriger ; quant au PCC, il devrait se contenter de lui apporter son soutien. Sous la pression des dirigeants de l’IC, le PCC finit par adopter lors de son troisième congrès, en juin 1923, le principe de l’adhésion individuelle de ses militants au Kuomintang.
Si Sun Yat-sen est hostile aux communistes chinois, il est très intéressé par l’aide que peut lui apporter l’URSS dans la lutte contre ses rivaux, les « seigneurs de la guerre ». En échange de cet appui, il est prêt à rendre hommage à la révolution russe… tant qu’on ne lui demande pas d’en appliquer le programme. Exemple caricatural de ces hommages purement formels au communisme, la Chambre de commerce de Canton, qui regroupe les capitalistes du sud-est de la Chine, se met à conclure toutes ses déclarations officielles par la formule : « Vive la révolution mondiale ! »
Très vite, des conseillers soviétiques arrivent pour réorganiser l’armée et la police du Kuomintang, tandis que plusieurs communistes entrent dans la direction exécutive du parti nationaliste. Symbole de l’aide soviétique, l’académie militaire de Huangpu est créée en juin 1924 pour former les futurs cadres de l’armée nationaliste. L’enseignement y est assuré par des officiers de l’Armée rouge russe, et l’encadrement politique de la formation est assuré par Chou En-lai, membre du PCC et futur ministre de Mao. L’école est dirigée par un jeune officier nationaliste, Tchang Kaï-chek, qui est aussi le gendre de Sun Yat-sen. Tchang Kaï-chek entretient des relations privilégiées avec la bourgeoisie de Canton, mais aussi avec la pègre de Shanghai. Après la mort de Sun Yat-sen en mars 1925, il prend progressivement la direction du Kuomintang.
Révolution et contre-révolution
Le 30 mai 1925, la police britannique tire sur une manifestation dans la concession de Shanghai, faisant treize morts. En réaction, une vague de grèves d’une ampleur inédite déferle sur la Chine. Un syndicat unifié dirigé par des communistes est créé à Shanghai. Dans les campagnes, des « unions paysannes » – dirigées, elles aussi, par des communistes – apparaissent et s’attaquent aux propriétaires terriens. Cette puissante vague de luttes marque le début de la « deuxième » révolution chinoise, qui va durer jusqu’en 1927.
Un mois plus tard, une nouvelle fusillade de la police britannique pousse les communistes à déclencher la grève-boycott de Hong-Kong. Le principe est simple : dans les territoires contrôlés par le Kuomintang, aucun travailleur chinois ne doit charger ou décharger des navires ou des marchandises passés par la colonie britannique, qui est alors la plaque tournante de toute l’économie impérialiste en Chine du Sud.
Organisé par des militants communistes, le comité de grève de Canton devient de facto un « deuxième pouvoir » parallèle au gouvernement du Kuomintang. Chargé de vérifier l’application du boycott et de défendre les piquets de grève, il se dote très vite de comités locaux, de milices ouvrières et de tribunaux pour punir les contrevenants. Tous ces éléments rapprochent ces comités de grève de ce qu’étaient les soviets pendant la Révolution russe. Malgré cela, les théoriciens staliniens de l’époque affirment que la formation de soviets est impossible en Chine !
L’entrée en action des masses chinoises a une autre conséquence : elle terrorise les dirigeants bourgeois du Kuomintang, qui décident de lutter contre le PCC par tous les moyens. A l’automne 1925, plusieurs cadres dirigeants du parti nationaliste se réunissent même, avec l’approbation de Tchang Kaï-chek, pour prêter serment – sur la tombe de Sun Yat-sen – de combattre le communisme.
En attendant, le pouvoir à Canton est aux mains du comité de grève. Mais ses dirigeants communistes sont paralysés par les instructions de l’Internationale, qui leur demande de ne pas remettre en cause la direction de la révolution par le Kuomintang et la « bourgeoisie progressiste ». Cette situation de double pouvoir ne pouvait durer longtemps. Le 20 mars 1926, Tchang Kaï-chek passe à l’action. S’appuyant sur les cadets de l’académie militaire de Huangpu, qui sont surtout des fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, il proclame la loi martiale, fait désarmer les piquets de grève et disperser les tribunaux populaires. Les communistes qui dirigent la grève sont arrêtés.
Pour Tchang, cette première offensive est l’occasion de tâter la résistance du PCC. Or les communistes ne réagissent pas ; ils suivent les consignes d’« apaisement » données par la direction de l’IC. Celle-ci va jusqu’à démentir que ce coup d’Etat ait eu lieu ; elle réaffirme publiquement son soutien au Kuomintang et à Tchang Kaï-chek lui-même. Ne rencontrant aucune résistance, la direction du Kuomintang décide d’expulser les communistes de tous les postes de direction au sein du parti.
La marche sur Shanghai
En juillet 1926, ayant réduit les communistes à l’obéissance, Tchang Kaï-chek lance la grande offensive contre les seigneurs de la guerre, qui était préparée depuis de longs mois. Il s’agit de marcher jusqu’à Pékin pour écraser les seigneurs de la guerre du Nord et instaurer le pouvoir du Kuomintang sur l’ensemble du territoire chinois.
Cette « expédition du Nord » avance facilement, car elle est précédée par une véritable marée d’insurrections paysannes. A l’approche de l’armée nationaliste, les paysans pauvres se soulèvent contre les propriétaires terriens et réalisent eux-mêmes la réforme agraire qui leur est promise par la propagande du Kuomintang.
Au début de 1927, l’armée du Kuomintang approche de Shanghai, balayant les troupes démoralisées et désorganisées des seigneurs de la guerre. La prise de Shanghai, la plus grande métropole de Chine, représenterait pour les communistes un atout de premier plan. Malgré la clandestinité et la répression conjointe des seigneurs de la guerre et des impérialistes, des milliers de travailleurs ont rejoint le PCC et pourraient servir de base à la constitution d’une Armée rouge chinoise. Le port de Shanghai pourrait aussi servir de point d’entrée pour des livraisons d’armes et de matériel venant d’URSS. Mais cela supposerait que le PCC rompe avec le Kuomintang et adopte une politique révolutionnaire indépendante. Au lieu de cela, ses militants vont se faire massacrer – presque sans résistance – par les troupes de Tchang Kaï-chek.
En février 1927, les communistes de Shanghai lancent une insurrection contre les seigneurs de la guerre. L’objectif est de faciliter la progression de l’armée nationaliste. Mais à l’annonce de ce soulèvement, les généraux nationalistes interrompent leur offensive : ils espèrent que les seigneurs de la guerre vont liquider les communistes avant leur arrivée. La répression est féroce, mais les structures clandestines du PCC se maintiennent à Shanghai. Le 21 mars, ses militants organisent même un second soulèvement – qui est victorieux, cette fois-ci, et ouvre la ville aux troupes nationalistes.
Dès lors, tout s’accélère. Tchang Kaï-chek prend directement contact avec les représentants des puissances impérialistes pour négocier leur soutien contre les communistes. Dans les campagnes, des troupes nationalistes, composées pour la plupart de soldats des seigneurs de la guerre qui ont changé de camp, écrasent les paysans révoltés et répriment les grèves.
Les dirigeants du PCC s’inquiètent des préparatifs de putsch de Tchang. Ils ne sont pas seuls. En mars 1927, les représentants de l’IC en Chine envoient à Moscou un rapport soulignant que Tchang et la direction du Kuomintang s’éloignent de la révolution et se rapprochent des impérialistes. [5]
En Russie, Trotsky et l’opposition de gauche dénoncent le danger d’un coup d’Etat de Tchang et réclament que le PCC reprenne son indépendance vis-à-vis du Kuomintang. Staline leur répond le 5 avril : il affirme qu’il est « impossible » que Tchang mène un coup d’Etat et insiste pour que les communistes se soumettent à la discipline du Kuomintang, qui pourtant vient tout juste de demander le désarmement des milices ouvrières de Shanghai.
Une semaine plus tard, le 12 avril 1927, les troupes de Tchang Kaï-chek, appuyées par la pègre et par la police des concessions occidentales, attaquent les organisations ouvrières de Shanghai. Des milliers de communistes et de syndicalistes sont massacrés. Le lendemain, en réponse à ce massacre, la direction de l’IC demande à Tchang de ne pas prendre « d’initiative unilatérale ». Cependant, les communistes sont pourchassés et massacrés par les troupes du Kuomintang – à Shanghai, mais aussi à Canton et dans les autres villes contrôlées par Tchang. En quelques mois, cette répression « anti-communiste » fait près de 300 000 morts.
Le 21 avril, face aux piles de cadavres qui s’amoncellent dans les rues de Shanghai et de Canton, Staline est contraint de reconnaître la « trahison de Tchang Kaï-chek », mais il ajoute que les événements ont confirmé la justesse de la ligne de l’IC ! Le PCC est sommé de s’allier à « l’aile gauche » du Kuomintang, qui regroupe les dirigeants bourgeois opposés à la dictature que Tchang veut leur imposer. Trotsky condamne cette politique, appelle à nouveau à l’indépendance du PCC et prédit une rapide réconciliation entre Tchang et ce soi-disant « Kuomintang de gauche », sur le dos des communistes.
De fait, après avoir interdit les grèves et fait massacrer des syndicalistes, la soi-disant « gauche » du Kuomintang se rallie à Tchang Kaï-chek en juillet 1927. La faillite de la politique de l’IC est flagrante. L’alliance avec le Kuomintang, imposée aux communistes chinois, a mené au massacre de l’avant-garde de la classe ouvrière et à l’écrasement des paysans révoltés. Pour étouffer toute critique de sa ligne désastreuse, la direction stalinienne exclut les oppositionnels de gauche du PC soviétique et accuse la direction du PC chinois – qui n’a fait que lui obéir – d’être responsable de l’échec de la révolution.
Pour tenter de faire oublier ce désastre, le PCC reçoit de Moscou l’ordre de lancer immédiatement des insurrections pour créer des « soviets chinois ». Ce virage brusque est insensé. Pendant des années, les communistes ont expliqué aux paysans et aux ouvriers qu’il leur fallait se soumettre au Kuomintang ; et soudainement, ils leur disent qu’il faut le renverser par la force, alors même que l’avant-garde de la classe ouvrière a été massacrée ou emprisonnée – et que les soulèvements paysans ont été écrasés dans le sang !
Des soulèvements héroïques mais improvisés, sur commande de Moscou, sont réprimés par Tchang et font des dizaines de milliers de morts supplémentaires. En conséquence, le PCC est durablement marginalisé. Deux décennies plus tard, en 1949, c’est un PCC complètement stalinisé et dominé par la clique bureaucratique de Mao Zedong qui prendra le pouvoir sur les ruines du régime de Tchang. [6]
Aujourd’hui, le capitalisme a été restauré en Chine. La bureaucratie maoïste a donné naissance à une classe capitaliste qui exploite brutalement la classe ouvrière chinoise. Mais celle-ci n’est plus le prolétariat archi-minoritaire de 1927 ; elle est désormais la classe ouvrière la plus puissante du monde. En réaction à des conditions de vie et de travail infernales, les travailleurs chinois commencent à se mobiliser. Les grèves et les manifestations se multiplient. Lorsque la classe ouvrière chinoise se soulèvera, renouant avec ses authentiques traditions révolutionnaires, elle fera trembler l’ensemble du monde capitaliste.
[1] Victor Hugo, « Au capitaine Butler », 25 novembre 1861.
[2] Lire « La théorie de la révolution permanente ».
[3] Thèses et additions sur les questions nationales et coloniales, juillet-août 1920.
[4] A ce sujet, voir notre rubrique « La révolution russe et le stalinisme ».
[5] Connu sous le nom de « Lettre de Shanghai », ce courrier sera censuré en URSS jusqu’en 1956.
[6] Lire « La révolution chinoise de 1949 ».