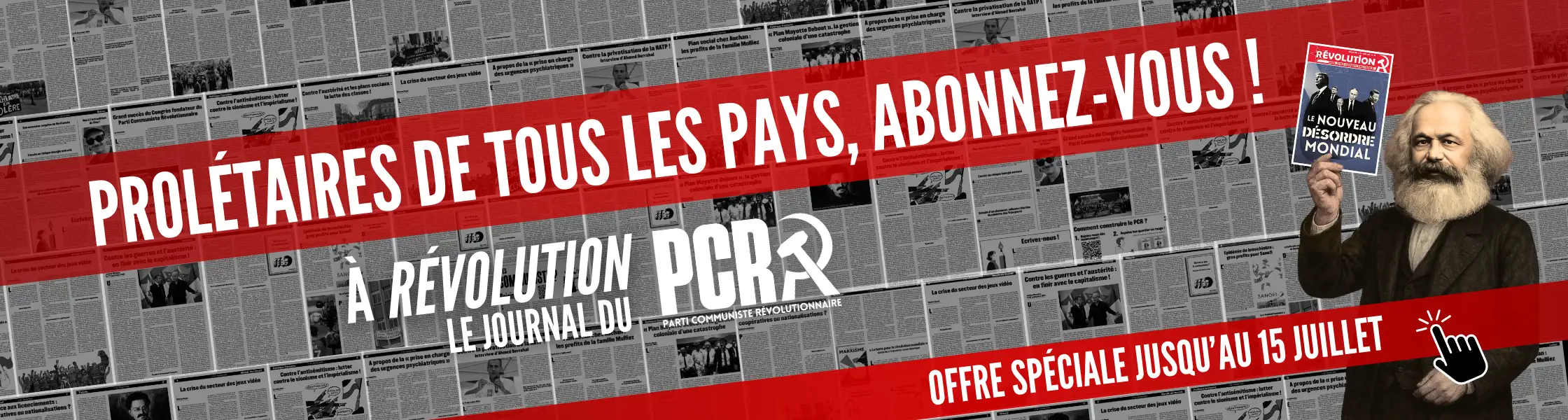Cet article a été publié le 24 avril 2025 sur In Defence of Marxism.
Le pape François est mort lundi 21 avril, à l’âge de 88 ans. Lors de son pontificat, il avait tenté de rénover l’image de l’Eglise et de lui donner un « visage humain », pour endiguer la crise de cette institution. Quoi qu’on pense de lui, il a joué son rôle avec brio. Mais la mission était vouée à l’échec. La crise de l’Eglise s’est poursuivie, et elle va continuer de s’aggraver après sa mort.
Après avoir été exposée dans la basilique Saint-Pierre, la dépouille de François sera modestement enterrée – selon ses volontés – dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, hors du Vatican, dans une tombe « simple et sans décoration ».
François cultivait cette image depuis ses années en Argentine, bien avant d’arriver au Vatican en 2013 : celle d’un homme qui rompt le pain avec les pauvres, d’un archevêque qui ne rechigne pas à prendre les transports en commun. Lorsqu’il a emménagé au Vatican, il a évité les somptueux appartements habituellement dévolus aux papes pour s’installer dans une modeste chambre d’invité.
A la tête d’une des organisations les plus riches de la planète, François voulait, paradoxalement, apparaître comme un homme simple, humble et pauvre, proche des souffrances des gens. Son nom de pape témoigne de l’image qu’il voulait associer à la sienne : celle d’un homme renommé pour sa pauvreté, saint François d’Assise.
Il a donc cherché à se distinguer de ses prédécesseurs, en parlant du changement climatique, en affichant sa sympathie pour les réfugiés, en dénonçant les horreurs de la guerre – en veillant soigneusement à se présenter comme un ami des opprimés. Tous les soirs jusqu’à la semaine de sa mort, il échangeait avec la communauté chrétienne de Gaza, qui se réunit sous les bombes israéliennes. Il a même formulé quelques timides critiques du capitalisme, ou du moins de ses symptômes.
Cela a poussé certains à gauche à pleurer la mort d’un pape soi-disant « socialiste ». Ces bonnes âmes ont ainsi ajouté leurs propres petits pleurs à ceux des réactionnaires de tous poils : présidents, Premiers ministres, monarques et médias de droite de toute la planète.
En réalité, il n’y avait pas plus de « socialisme » dans les opinions du pape François que dans celles de ses prédécesseurs, Benoît XVI le « rottweiler de Dieu » et Jean-Paul II le pape combattant de la Guerre froide. Comme eux, il était à la tête de l’une des plus importantes institutions de l’ordre capitaliste, qui est elle-même une gigantesque entreprise. A l’instar du système lui-même, l’Eglise traverse une crise profonde et multiforme.
L’Eglise catholique est un pilier de la classe dirigeante, et ce, depuis le IVe siècle. Son rôle fondamental dans la société de classes a toujours été de promettre aux masses un paradis après la mort pour mieux leur faire accepter l’enfer sur la terre. Elle sert à dissuader les masses pauvres de se rebeller contre les riches et les puissants de ce monde – qu’il s’agisse des seigneurs féodaux d’antan ou des capitalistes d’aujourd’hui. Une telle organisation ne peut conserver son statut qu’à condition d’être capable de s’adapter et de manœuvrer à travers les crises. Sur fond de colère croissante de la classe ouvrière et de rejet croissant de l’Eglise, il fallait un homme comme François pour restaurer la réputation des institutions ecclésiastiques.
A cet égard, le choix de son nom de pape ne manque pas de sel.
Lorsque son homonyme, François d’Assise, parcourait les rues de Rome au XIIIe siècle, l’Eglise catholique était alors déjà en crise. La société féodale avait atteint son apogée, et commençait à entrer en crise. L’Eglise était de plus en plus détestée par les masses pauvres des villes et des campagnes, du fait de son opulence, de son hypocrisie et de son soutien indéfectible au joug des rois et des seigneurs. A travers toute l’Europe, des sectes hérétiques apparaissaient et prêchaient aux pauvres la haine de classe contre les riches.
Selon la légende, alors qu’il priait devant le crucifix de l’église Saint-Damien, François d’Assise eut la surprise d’entendre le Seigneur lui ordonner depuis l’image sainte : « Va et répare mon Eglise qui, tu le vois, tombe en ruine ! »
Saint François d’Assise s’est attelé à sa mission. A l’image des prêcheurs des sectes hérétiques communisantes qui parcouraient l’Europe, il fit appel à la conscience de classe des pauvres d’Italie. Son message était tiré des enseignements de l’Eglise primitive : le Royaume des Cieux appartient aux pauvres et Dieu méprise la richesse. Mais il s’en est servi pour embrigader les pauvres dans l’Ordre franciscain… et en faire les plus ardents défenseurs de l’autorité du pape et du statu quo.
Comme saint François, le pape François a été appelé à « réparer l’Eglise qui tombe en ruine », à rénover cet instrument qui sert désormais l’ordre capitaliste et à restaurer sa réputation ternie auprès des pauvres et des opprimés.
Une mystérieuse boîte blanche
Le pontificat de François débuta par une crise. En 2013, Benoît XVI devenait le premier pape à abdiquer depuis presque exactement 600 ans. Le dernier en date, Grégoire XII, l’avait fait en 1415 pour résoudre un schisme dans l’Eglise d’Occident. Quant à Benoît XVI, il a démissionné pour des « raisons de santé »… en tout cas, c’était l’explication officielle.
En réalité, son abdication tombait à pic. Le Vatican était alors embourbé dans le scandale des « Vatileaks », qui avaient mis au jour plusieurs affaires de blanchiment d’argent, de corruption, de pots-de-vin, de détournement et d’évasion fiscale au cœur des finances troubles de l’Eglise.
Mais malgré son abdication, le pape Benoît n’avait pas l’intention de s’en aller. Il a insisté pour garder le titre de « pape émérite », afin d’incarner un pôle fractionnel pour l’aile conservatrice de l’Eglise, jusqu’à sa mort en 2022.
C’est dans ces circonstances que la fumée blanche apparut le 13 mars 2013 pour annoncer que le cardinal argentin Jorge Bergoglio, devenu pape François, succéderait à Benoît XVI en tant qu’Evêque de Rome.
La rencontre entre deux papes est une chose assez rare, mais les circonstances du départ de Benoît XVI ont permis d’opérer une passation de pouvoir entre le pape émérite et le pape élu. A cette occasion, Benoît a remis une boîte blanche à François. « Tout est là », lui a-t-il dit, « des documents relatifs aux situations les plus délicates et les plus difficiles de l’Eglise. Des cas d’abus, de corruption, de transactions obscures, d’actes répréhensibles. »
La boîte devait être bien grande, ou les documents imprimés en tout petit, tant les charges pesant sur l’Eglise catholique se sont accumulées au cours des décennies. L’institution est submergée par une interminable liste de crimes et d’abus, y compris de très nombreux abus sexuels contre des enfants – ainsi que par la dissimulation de ces affaires.
Dans de nombreux pays, comme l’Irlande, l’Eglise a perdu l’autorité incontestée dont elle jouissait auparavant, et est devenue un objet de détestation universelle pour les jeunes générations. De l’Europe à l’Amérique, le dégoût à l’égard des crimes de l’Eglise et la crise générale de la foi ont décimé le troupeau des fidèles. Rien qu’en Allemagne, l’Eglise a perdu trois millions de paroissiens depuis l’an 2000.
Tandis que l’Eglise perd ses ouailles dans les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord, elle continue de grandir dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Un cinquième seulement des catholiques vivent en Europe aujourd’hui, contre 70 % en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Mais gagner des paroissiens dans les pays pauvres ne remplira pas les coffres d’une organisation dont les dépenses augmentent, y compris les retraites de son clergé vieillissant qu’elle peine à renouveler, et les indemnisations qu’elle doit verser aux victimes de ses crimes.
Que ceux qui s’inquiéteraient des finances de l’Eglise catholique se rassurent néanmoins. Personne ne sait précisément combien vaut l’Eglise – car elle fait très attention à déguiser ses opérations financières – mais elle possède un patrimoine immense. La conduite des âmes est une entreprise très lucrative.
Rien qu’en Italie, l’Eglise possède plus de 4000 propriétés foncières. A l’échelle mondiale, on estime qu’elle détient 715 000 km2 en patrimoine immobilier et terrien : plus que la superficie du Texas. Bien que l’Eglise catholique allemande ait perdu de nombreux fidèles, sa richesse reste estimée à environ 430 milliards d’euros.
La richesse de l’Eglise se mesure presque certainement en milliers de milliards de dollars. Et comme l’a montré le scandale des Vatileaks, derrière le voile de mystère du Vatican, se cache un foyer de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de corruption et de malversations.
L’Eglise catholique contemporaine est une immense et très profitable entreprise capitaliste, qui englobe de nombreuses sociétés et un grand parc immobilier. Le fait que ses pratiques financières véreuses soient semblables à celles des autres grands groupes ne devrait surprendre personne.
Mais même en Afrique et en Amérique latine, où l’Eglise catholique trouve de nouveaux convertis, elle est soumise à rude concurrence par les sectes évangélistes.
Tandis que l’Eglise catholique justifie la domination d’oligarchies brutales et promet le salut aux pauvres au terme d’une vie de souffrance, d’autres obédiences – comme les Eglises pentecôtistes – proposent un programme plus attrayant. Ces soi-disant Eglises « de santé et de prospérité » promettent aux pauvres qu’en récompense de leur dévotion, la richesse leur sera accordée dans leur vie terrestre.
Voilà donc la situation dont le pape François a hérité : une Eglise plongée dans les crises et les scandales, déficitaire malgré ses immenses richesses, consumée par des controverses doctrinales, des scissions et des intrigues internes, et désertée par ses fidèles dans de nombreuses régions du monde.
En ces temps où le discrédit frappe tous les piliers de l’ordre établi, l’Eglise avait besoin d’un homme capable de renouveler son image, de lui donner un visage humain et un nouveau départ. Toute la carrière du pape François l’avait préparé pour cette tâche.
Le pape et la « guerre sale »
Le pape François est né Jorge Mario Bergoglio en Argentine en 1936. Après avoir rejoint l’Ordre des Jésuites en 1958, à 22 ans, il fut son « supérieur provincial » – c’est-à-dire le dirigeant de l’Ordre en Argentine – de 1973 à 1979.
Il était donc à la tête des Jésuites quand la junte militaire du général Videla a posé son talon de fer sur l’Argentine. 30 000 personnes ont été tuées ou ont « disparu » au cours de la « guerre sale » menée par la junte. Les premières victimes furent les communistes, les syndicalistes combatifs et les intellectuels.
La junte a aussi assassiné un grand nombre de prêtres de gauche. Ce n’est pas étonnant, car l’Eglise est traversée par les mêmes divisions de classe que la société en général. Parmi les rangs inférieurs de l’Eglise et de l’Ordre des Jésuites, de nombreux prêtres poussés par leur sympathie pour les pauvres s’opposèrent frontalement au régime, et prirent même parfois les armes contre lui.
Quant aux échelons supérieurs de l’Eglise catholique, ils ne se contentèrent pas de couvrir les crimes de la junte : ils l’aidèrent directement à massacrer ses opposants. Des témoins directs ont vu des cardinaux aller jusqu’à livrer eux-mêmes des prêtres au régime pour les faire tuer. L’Eglise a même mis ses îles privées à disposition de la marine argentine pour y cacher des prisonniers politiques lors des visites des commissions d’enquête sur le respect des Droits de l’Homme.
Quel fut le rôle de Jorge Bergoglio, le futur pape François, lors de ces années noires ? Cela reste flou. Certains l’accusent d’avoir été directement mêlé à l’enlèvement de plusieurs prêtres de gauche, dont Orland Yoro et Francisco Jalics. D’autres prétendent au contraire qu’il a aidé des prêtres dissidents à fuir l’Argentine.
En tout cas, quel que fût son rôle dans les disparitions, il n’a jamais élevé la voix contre la junte. Complice direct ou non, cet « ami des pauvres » est resté silencieux tandis que le régime broyait les pauvres et massacrait leurs dirigeants.
Mais ce qui l’a rendu papabile, aux yeux de sa hiérarchie, c’est son œuvre ultérieure, les services qu’il a rendus après la chute de la dictature. Quand la junte est tombée, l’Eglise catholique était profondément discréditée par sa complicité avec les crimes du régime. Il lui fallait un homme capable de laver sa réputation : un « homme du peuple », « ami des pauvres ».
Tel fut le rôle de Jorge Bergoglio, nommé archevêque de Buenos Aires en 1998. Sous sa direction, l’Eglise catholique a fait tout son possible pour se réhabiliter aux yeux des masses. Bergoglio a encouragé les « prêtres des bidonvilles » à mener des œuvres de charité dans les quartiers pauvres, les villas miserias, à y réparer les églises décrépites, les écoles et les terrains de football. Il discutait et buvait du maté avec les résidents pauvres et allait jusqu’à laver et embrasser les pieds des prostituées et des toxicomanes.
Après avoir aidé à tuer et à emprisonner les représentants des pauvres et de la classe ouvrière, l’Eglise leur offrait maintenant un consolateur. Pourquoi la même hiérarchie ecclésiastique qui avait sur les mains le sang des desaparecidos, qui avait même assassiné ses propres dissidents de gauche au sein du clergé, s’est-elle choisi cet « ami des pauvres » ?
En temps de lutte de classe, quand l’affrontement entre la révolution et la contre-révolution confine à la guerre civile, les échelons supérieurs de la hiérarchie ecclésiastique se rangent toujours du côté de leur classe, de l’oligarchie dominante et des égorgeurs contre-révolutionnaires.
Mais l’Eglise ne sert pas qu’à sanctifier les actes les plus abominables de la classe dirigeante en les arrosant d’un peu d’eau bénite. En faisant preuve de munificence et de charité, en enseignant que les pauvres sont bénis, qu’il y a de la dignité et de l’honneur dans la misère et que la soumission patiente à la souffrance lors de la vie terrestre permet de sauver son âme pour l’au-delà, l’Eglise rend un immense service à la classe dirigeante. Elle réconforte les masses pour les réconcilier avec leur sort.
Le pape François était expert dans ce domaine. Pendant les périodes de lutte révolutionnaire des masses contre leurs exploiteurs et leurs oppresseurs, il n’a montré aucune sympathie pour les prêtres de gauche qui osaient rompre avec leur hiérarchie et prendre le parti de la classe ouvrière et des pauvres, en Argentine ou ailleurs en Amérique latine.
Mais une fois ces hommes courageux devenus inoffensifs – parce qu’on les avait tués – c’est avec joie que François offrait des miettes de consolation aux masses. C’est ainsi qu’un martyr comme l’archevêque salvadorien Oscar Romero, qui fut assassiné par des escadrons de la mort pour son opposition au régime militaire, a pu être méprisé par sa hiérarchie de son vivant et canonisé par le pape François après sa mort.
Comme l’expliquait un théologien de l’université de Dayton en Ohio, son passage par l’archevêché en Argentine a constitué une importante expérience pour le préparer à sa tâche en tant que pape :
« Comme archevêque, il a affronté une tâche monumentale […] S’il a pu restaurer la crédibilité de l’Eglise là-bas, il saura gérer les scandales qui ont frappé l’Eglise à travers le monde, car il sait se connecter avec le peuple ».
Quelles que fussent les intentions de Jorge Bergoglio, ses efforts pour réhabiliter l’Eglise argentine, pour transformer cet ennemi mortel des pauvres en un « ami » consolant, ont rendu un inestimable service à la classe dirigeante. L’archevêque de Buenos Aires s’est ainsi qualifié pour une plus haute mission : redorer l’image ternie de l’institution tout entière.
De profondes divisions
Au cours de sa carrière, le pape François a su manœuvrer avec talent, sans toucher à rien de fondamental en matière de doctrine ou d’intérêt matériel de la hiérarchie ecclésiastique. Il se lamentait à propos des horreurs du capitalisme tout en prêchant une patiente résignation. « Nous avons créé de nouvelles idoles », regrettait-il dans une de ses exhortations. « L’adoration de l’antique veau d’or (cf. Ex 32, 1-35) a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans visage et sans but véritablement humain. »
En ce qui concerne les féroces controverses doctrinales et les luttes intestines de pouvoir au sein de l’Eglise, il a su se donner une image de « réformateur » sans jamais rien faire de concret en ce sens.
Il a été salué comme un ami de la communauté LGBT pour avoir déclaré « qui suis-je pour juger ? » à propos de l’homosexualité, et admis la bénédiction des couples gays… tout en s’opposant au mariage homosexuel. En matière d’IVG, il s’est dit favorable à ce que les politiciens catholiques pro-choix reçoivent les sacrements… tout en condamnant l’avortement comme un péché mortel. Il a promu des femmes à des postes de direction dans la Curie romaine, la bureaucratie du Vatican… tout en s’opposant à l’ordination de femmes prêtres.
Bien qu’il ait tenté d’afficher sa « transparence » face aux scandales financiers, le pape François n’aurait rien pu faire pour nettoyer les écuries d’Augias des finances vaticanes, même s’il l’avait voulu. Les malversations, la fraude, la corruption et le blanchiment – pour ne pas parler des autres crimes – sont inhérents à cette institution. Ce n’est là que le reflet de la corruption du système capitaliste tout entier, dont l’Eglise catholique n’est qu’un des piliers, certes très riche et influent.
François a gagné une réputation d’« humanité », de sympathie pour les pauvres et pour les opprimés. Cette réputation de « progressiste » et de « réformateur » lui a même valu une authentique popularité, sans qu’il ait eu besoin de faire plus que quelques gestes symboliques.
Il ne pouvait pas faire plus. En tant que chef d’une institution de la classe dirigeante, qui en partage toutes les tares, toute la pourriture, tous les abus et tous les crimes, il était incapable de résoudre les problèmes qui rongent l’Eglise.
La colère provoquée par la crise du capitalisme s’est abattue sur l’Eglise catholique, avec une intensité inédite, précisément sous le pontificat de François.
Il suffit de regarder deux des pays qui étaient jusqu’à peu les plus catholiques d’Europe. En Irlande, depuis l’élection de François, deux référendums – sur le mariage homosexuel en 2015 et sur le droit à l’avortement en 2018 – ont été des coups très durs pour l’Eglise. En Pologne, en 2020, 500 000 personnes ont manifesté pour réclamer le droit à l’avortement et la séparation de l’Eglise et de l’Etat, tandis que l’assistance des jeunes à la messe s’est effondrée.
En Amérique latine, un mouvement massif et combatif des femmes, la Marea Verde, a arraché le droit à l’avortement sur les terres catholiques du Mexique, de Colombie et d’Argentine, la patrie de François. Si l’Eglise catholique a continué de progresser à travers le continent, l’athéisme s’est répandu bien plus rapidement.
A mesure que la crise insoutenable du capitalisme force les couches les plus opprimées de la société à se lever pour combattre, la colère se tourne également contre l’Eglise, dont le bilan en matière de brutalité et d’oppression contre les femmes est sans équivalent dans l’histoire.
Quand les cardinaux se réuniront pour élire un nouveau pape, toutes les contradictions que François a échoué à contenir resurgiront à la surface. Les intrigues, les luttes de pouvoir, la polarisation et les fractures, entre les « libéraux » et les « conservateurs », et entre les Eglises déclinantes mais riches d’Europe et d’Amérique du Nord, et les Eglises croissantes mais pauvres d’Afrique et d’Amérique latine… tout cela sera exposé aux yeux de tous.
Pour la classe ouvrière, pour les pauvres de la planète, peu importe que le prochain pape ait le visage souriant d’un « réformateur » ou les traits hargneux d’un réactionnaire assumé. L’Eglise et sa hiérarchie étaient, sont et seront toujours leurs ennemis.