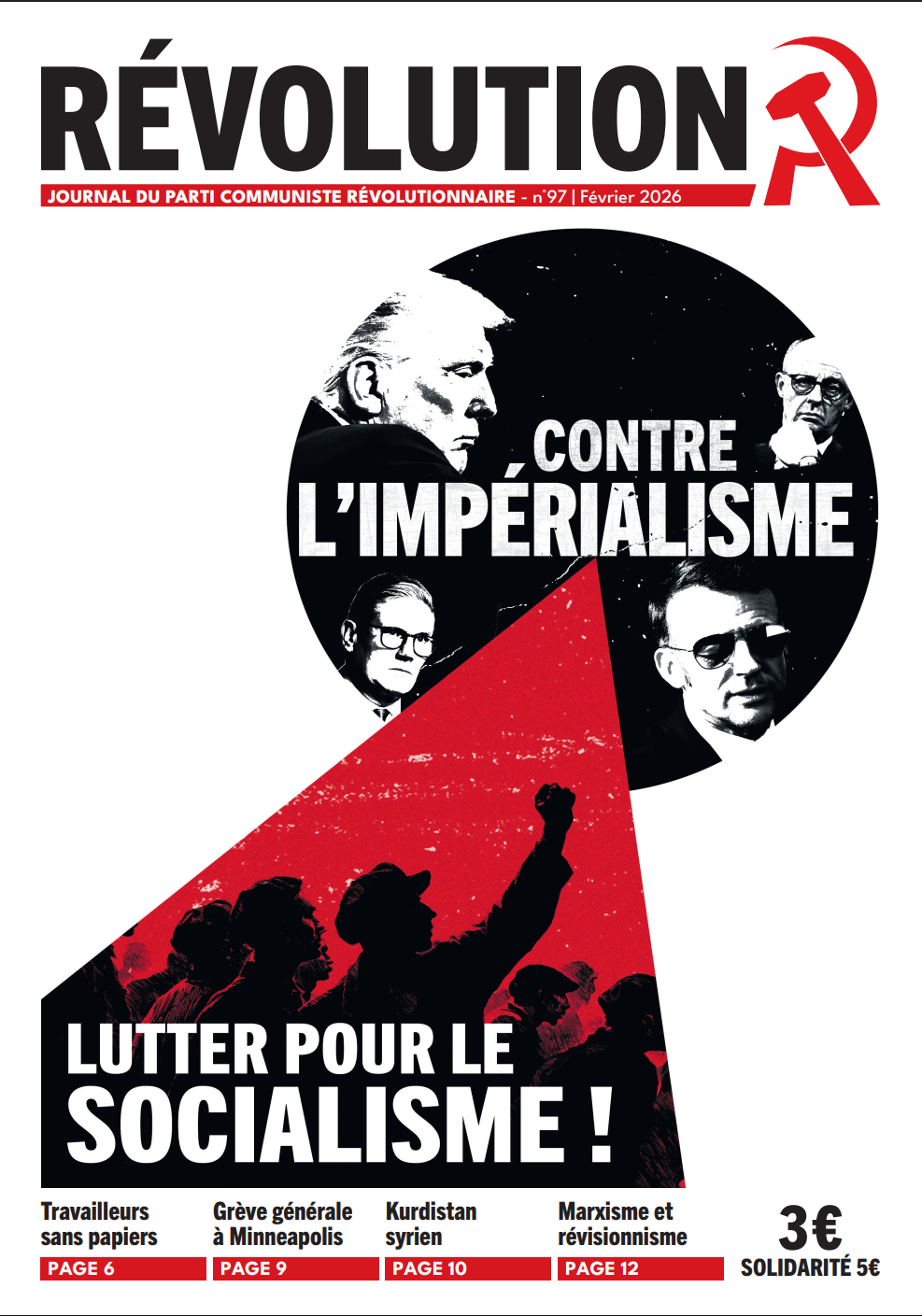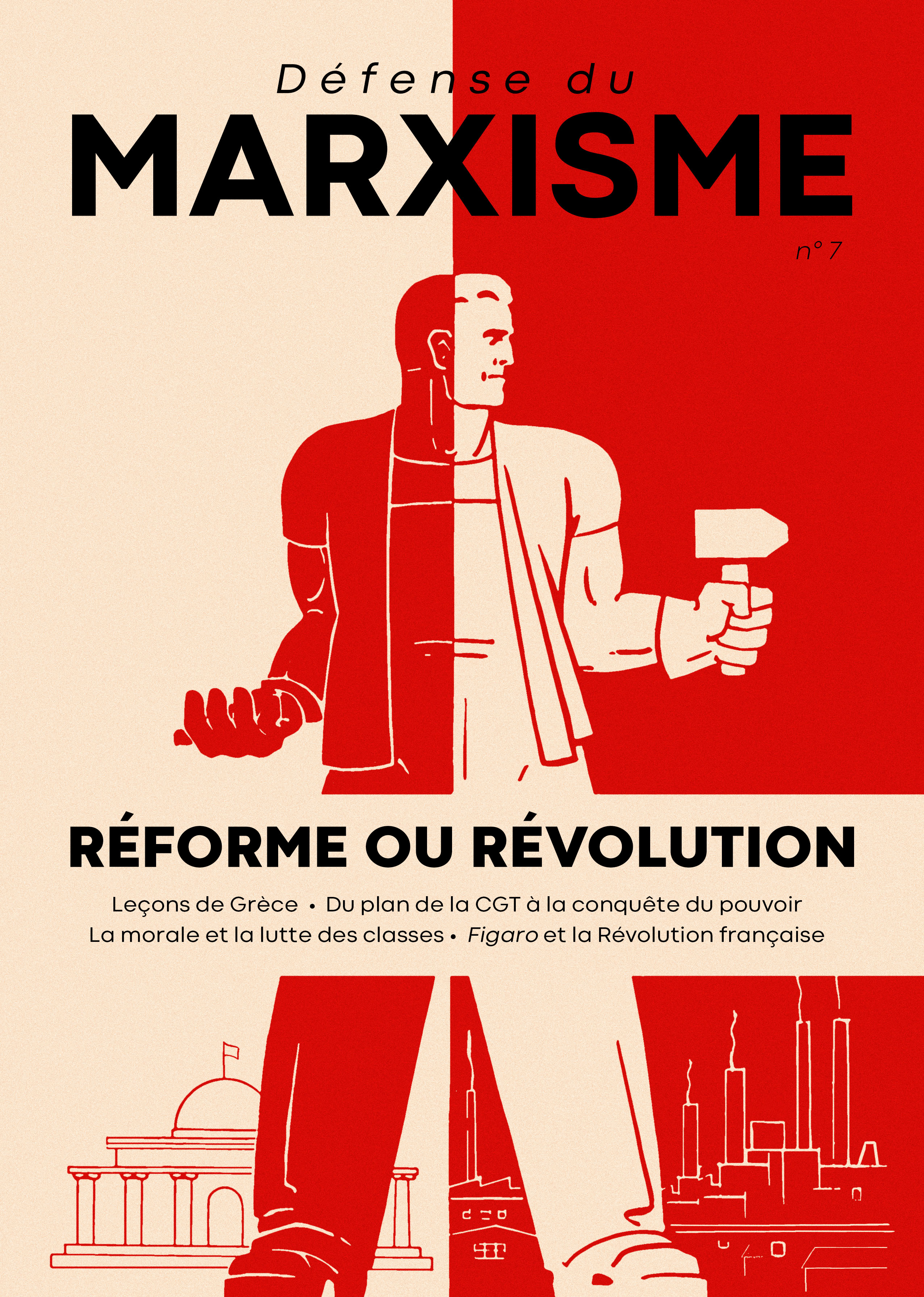Colonisée par la France depuis la fin du XVIIe siècle, La Réunion est devenue un département français en 1946. Mais cette modification administrative n’a rien changé à la situation économique et sociale désastreuse que connaissait la majorité de la population de l’île, composée de descendants d’esclaves ou de travailleurs amenés depuis d’autres colonies. Leur pauvreté est encore aggravée par la crise économique que connaît l’île après la Seconde Guerre mondiale.
En 1946, le trafic maritime vers La Réunion ne représente plus qu’environ 40 % de ce qu’il était avant-guerre. De plus, plusieurs cyclones ont ravagé les exploitations agricoles en 1944 et 1945, ce qui entraine des pénuries alimentaires. Les infrastructures – notamment les écoles et les services de santé – sont largement sous-développées. En 1951, le taux de mortalité infantile est de 164 ‰, soit près du triple de la moyenne nationale ! Cette misère généralisée nourrit la colère de la population réunionnaise. Le Parti communiste français se développe alors massivement dans l’île. En 1958, il obtient près du tiers des suffrages lors des élections législatives. L’année suivante, ses sections locales deviennent formellement indépendantes du PCF et constituent le Parti communiste réunionnais. Le nouveau parti revendique l’autonomie du territoire mais reste profondément réformiste, à l’image de son parti frère de métropole.
Cette croissance d’un parti « autonomiste » inquiète l’impérialisme français, qui tient à conserver cette position stratégique dans l’Océan Indien. Le régime gaulliste envoie donc dans l’île un de ses hommes à poigne, l’ancien Premier ministre Michel Debré. En 1963, ce « baron du gaullisme » est élu député de La Réunion, après qu’une campagne massive de trucage électoral lui ait assuré près de 80 % des voix.
Répression et exploitation
Pour enrayer la « menace communiste », Debré, devenu le véritable gouverneur de l’île, déclenche une intense campagne de répression contre le PC réunionnais. Le parti est « interdit d’antenne » sur les chaînes de l’ORTF, les fonctionnaires membres du PC sont mutés de force en métropole tandis que certains de ses dirigeants sont poursuivis en justice. Accusé d’« atteinte à l’intégrité du territoire » sur la seule base d’articles de journaux, le principal dirigeant du parti, Paul Vergès, est même contraint de passer dans la clandestinité pendant plus de deux ans.
Pour restaurer l’autorité de l’impérialisme français, Debré s’attaque aussi au sous-développement de l’île. Grâce à ses relais au sein du gouvernement gaulliste, il obtient des budgets pour développer les infrastructures et les services publics, notamment le système scolaire. Mais il veut aussi exploiter au maximum ce qu’il considère comme la principale richesse de La Réunion : sa force de travail. La population a en effet doublé depuis la guerre. En 1967, 56 % de la population a moins de 20 ans.
Debré fait donc adopter à La Réunion le « Service Militaire Adapté », qui remplace la conscription par une formation professionnelle : pour fuir le chômage, des milliers de jeunes Réunionnais vont travailler pour des salaires très bas, dans des « formations » encadrées par l’armée.
Les autorités françaises implantent aussi à La Réunion le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d’outre-mer), dont l’objectif est d’importer des travailleurs vers la métropole. En l’espace de 20 ans, ce sont plus de 37 000 travailleurs qui rejoignent la France métropolitaine, présentée comme un Eldorado par la propagande gouvernementale. Une fois arrivés, les travailleurs réunionnais sont soumis à une stricte surveillance par les services du Bumidom. Assimilés à des travailleurs immigrés, ils sont traités comme tels par le patronat.
Les « enfants de la Creuse »
Le pouvoir gaulliste a aussi l’idée d’utiliser la population réunionnaise pour compenser le déficit de paysans que l’exode rural entraine dans les campagnes de métropole. Les autorités vont déporter en France des enfants hébergés dans les services d’aide sociale de La Réunion. Entre 1962 et 1984, au moins 2150 enfants sont envoyés en « séjour » en métropole, dans les départements ruraux de la Creuse, de l’Oise, du Tarn, et bien d’autres. Comme l’écrit alors Témoignages, le journal du Parti communiste réunionnais, il s’agit en réalité de « déportations » organisées dans le cadre d’un véritable « trafic d’enfants ».
Agés de 9 mois à 21 ans lors de leur déportation, ces enfants sont traités comme des orphelins par les services sociaux et deviennent officiellement des « pupilles de l'Etat », ce qui fait perdre tout droit à leurs parents. Nombre de ces « enfants de la Creuse » n’ont ensuite jamais revu leurs familles. Les fratries sont dispersées et les enfants triés selon leur âge, leurs qualités physiques et leur sexe. Dès 13 ans, les garçons sont déscolarisés et envoyés aux champs ; les filles, se retrouvent dans des institutions religieuses ou placées comme bonnes à tout faire. Pour assurer leur « intégration », il leur est interdit de parler le Créole.
Souvent considérés comme de véritables petits esclaves par leur « famille d’accueil », une bonne partie de ces enfants sont régulièrement soumis à de mauvais traitements : les cas d’humiliation, de coups ou même de viols sont très nombreux. Dès les années 1970, des médecins remarquent que beaucoup de ces enfants souffrent de troubles psychiques, parfois très graves (dépression, schizophrénie, suicides…). En 1975, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé écrit à Michel Debré pour lui demander de mettre fin à ces « déportations ». Mais celui-ci répond que cette politique a produit « les meilleurs résultats »… Ces déportations ne prennent fin qu’en 1984, après l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir.
Contrôler les naissances, coûte que coûte
Obsédé par la « surpopulation » du département, l’Etat finance des campagnes de propagande antinataliste. Dans les rues, on peut alors voir des affiches comparant les Réunionnaises à des kangourous et l’île à une boîte de sardines débordant d’enfants ! Mais, cette propagande ne suffit pas à enrayer la hausse démographique, qui est causée avant tout par le sous-développement économique. Les autorités françaises se lancent alors dans une vaste entreprise de stérilisations et d’avortements forcés.
Interrogé à propos de la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse en 1975, Michel Debré la condamnait comme « une erreur historique ». Dès son arrivée à La Réunion, en 1963, le nouveau député s’était pourtant entouré d’un réseau de médecins proches du parti gaulliste, qui vont contraindre plusieurs milliers de femmes à subir des avortements et des stérilisations. Ce système est alors aussi utilisé par ces médecins dévoyés pour détourner auprès de la Sécurité sociale des sommes faramineuses, l’équivalent de plusieurs millions d’euros.
Quand le scandale finit par éclater en 1971, deux médecins sont condamnés à trois ans de prison, mais aucune condamnation n’est prononcée contre les autres accusés, pas même contre le directeur de la clinique où étaient pratiquées les stérilisations forcées. Il faut dire que ce notable était aussi un cadre local du parti gaulliste. Aucun responsable de l’administration n’est poursuivi. Un des médecins condamnés, le docteur Ladjadj, avait pourtant déclaré au procès : « la sécurité sociale, le président du conseil général m’ont donné le feu vert pour les stérilisations ».
Quant aux victimes qui avaient porté plainte, les « 30 Courageuses », elles n’obtiennent pour la plupart aucune réparation. Certaines d’entre elles se voient même au contraire présenter la facture de leurs frais de justice. Seules deux compensations sont versées… aux maris de deux des victimes !
Michel Debré, quant à lui, n’a jamais eu à répondre ni des déportations d’enfants, ni des stérilisations et des avortements forcés. Il est mort tranquillement, dans son lit, en 1996, et a alors reçu les hommages de la plupart des grands politiciens bourgeois.
De mauvais choix ?
En 2014, la députée socialiste Ericka Bareigts a présenté une motion pour que soit reconnue la responsabilité morale de l’Etat français dans l’affaire des « Enfants de la Creuse ». Elle déclarait alors à la tribune de l’Assemblée nationale : « Le choix politique fait à l’époque était un mauvais choix ».
En réalité, l’application de cette politique criminelle par le régime gaulliste n’était pas une question de « choix » mais d’intérêts de classe. Il s’agissait de défendre les intérêts de l’impérialisme français et notamment de maintenir son contrôle sur une position stratégique.
C’est au nom des mêmes intérêts que fut menée la répression meurtrière du soulèvement de la Guadeloupe en mai 1967, qui fit entre 87 et 200 morts. Ce sont aujourd’hui les mêmes intérêts qui expliquent le sous-développement de Mayotte et l’acharnement de l’Etat contre les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. L’impérialisme français continuera à mener une politique criminelle pour défendre les profits de sa classe dirigeante, tant qu’il ne sera pas renversé !