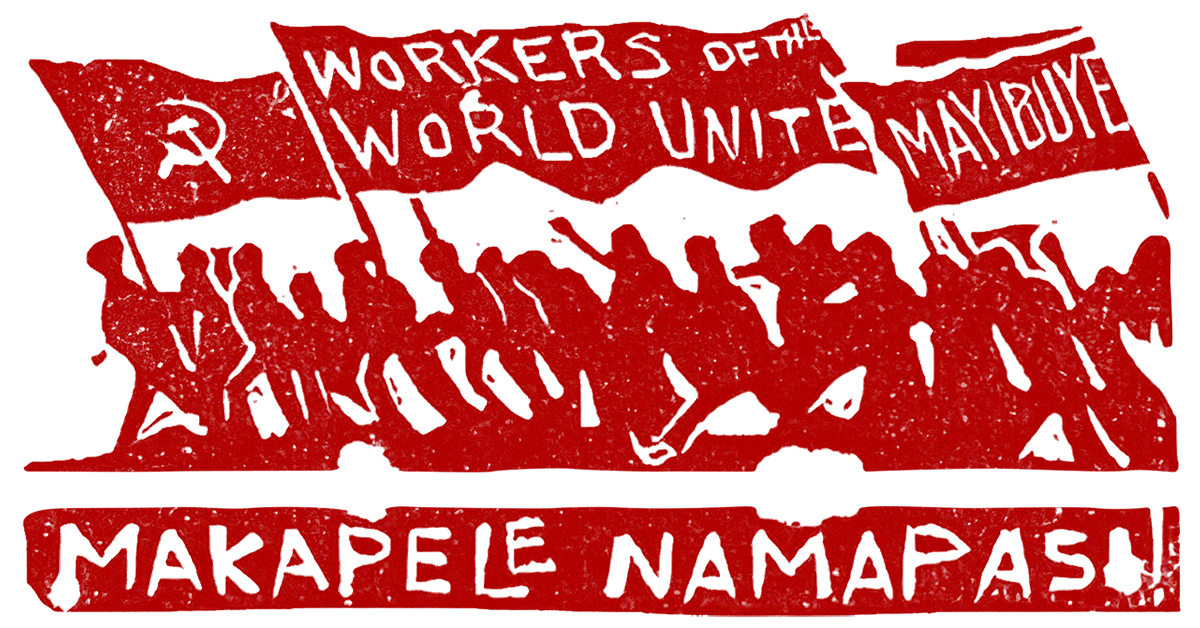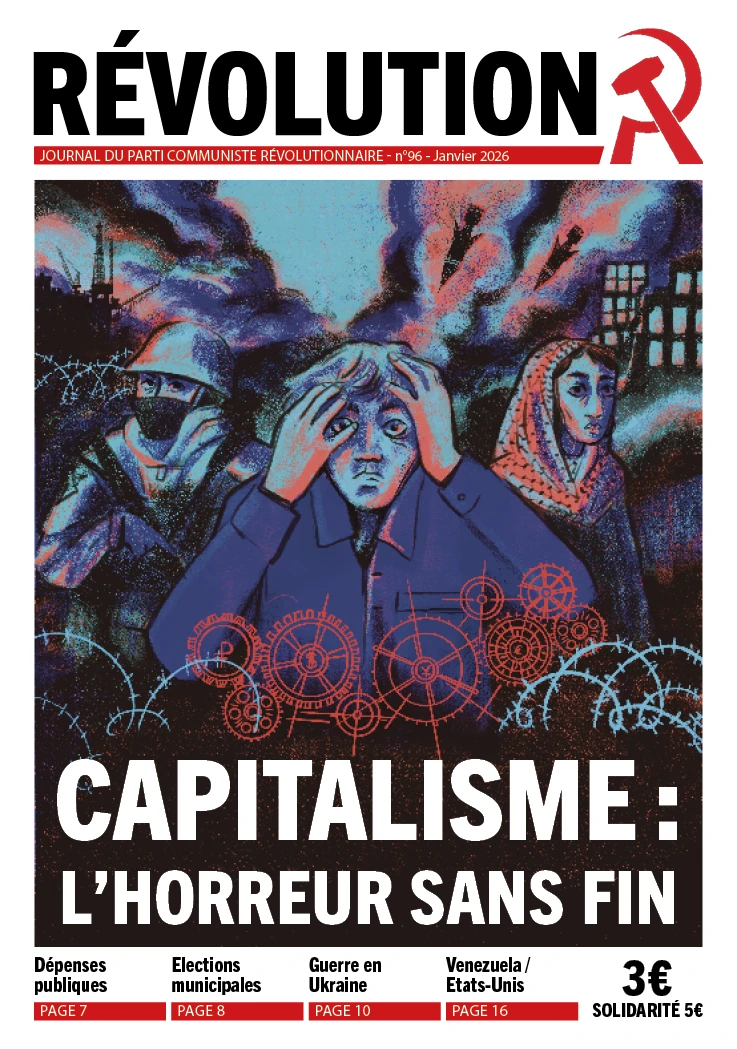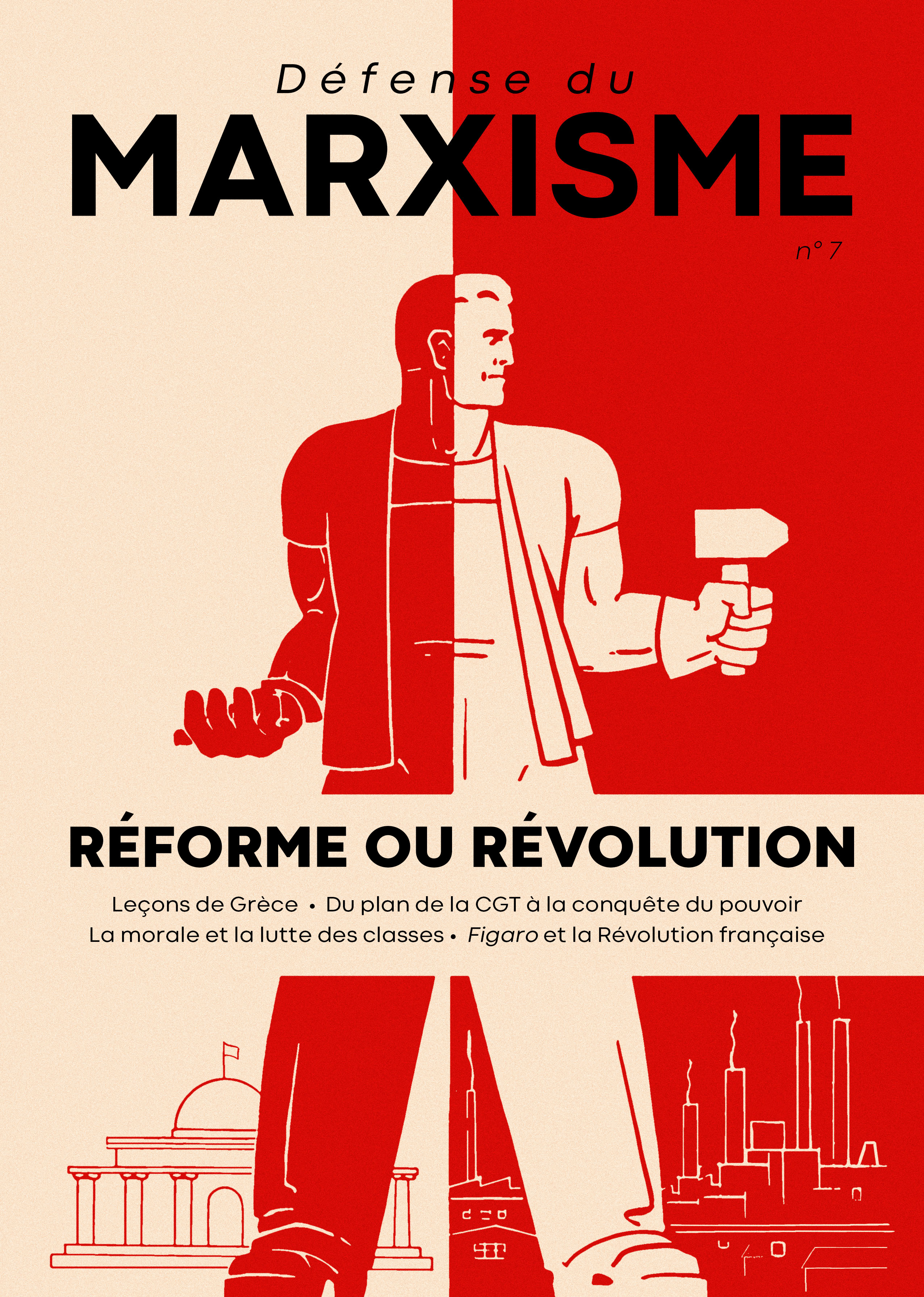Article publié dans le numéro 2 de la revue Défense du marxisme
Au début des années 1930, le jeune Parti communiste sud-africain est entré dans une crise profonde. Le parti fut réduit à une secte insignifiante grâce à une combinaison des politiques désastreuses de l’Internationale communiste stalinienne durant la soi-disant « Troisième période », ainsi que du régime interne toxique caractérisé par les expulsions bureaucratiques et d’âpres conflits personnels.
Lors de cette période, plusieurs groupes de communistes qui avaient été soit expulsés du parti ou étaient partis dégoûtés ont commencé à se coaliser autour des idées de l’Opposition de gauche de Trotsky. L’un de ces groupes de trotskistes sud-africains avait fondé le « Lenin Club » dans la ville de Le Cap en juillet 1933. Ce groupe entama la rédaction d’un programme politique en août 1934, dans l’optique de lancer un parti politique : le Parti ouvrier d’Afrique du Sud.
Lors du processus de rédaction, des différences importantes ont émergé au sein du groupe, et la majorité soumit des thèses au Secrétariat international de l’Opposition de gauche pour avoir son avis. Dans ces thèses, la majorité rejetait le slogan d’une « République noire » en Afrique du Sud, un slogan mis de l’avant par le PC sud-africain stalinien à l’époque. Elle le considérait comme une concession au nationalisme, par opposition à une lutte unie des travailleurs noirs et blancs pour renverser le capitalisme et ériger un État ouvrier à l’image de l’Union soviétique.
Dans sa lettre, Trotsky adresse cette question et plusieurs autres reliées au contexte sud-africain, expliquant le lien entre les revendications « nationales-démocratiques » telles que la « République noire », et la révolution socialiste.
Nous rééditons ici la lettre de Trotsky, trente ans après la première élection démocratique en Afrique du Sud, car elle fournit une application brève mais brillante de l’approche communiste envers les luttes de libération nationale des peuples opprimés.
La lettre de Trotsky contient aussi des réflexions qui se sont avérées prophétiques au vu des événements ultérieurs. Nous pouvons le voir notamment en ce qui concerne le rôle central de la lutte de classe dans le renversement de l’apartheid, la trahison des revendications sociales claires des travailleurs sud-africains par la direction du Congrès national africain dans les années 1990, et l’abandon complet de toute indépendance politique par le PC sud-africain, ce qui a empêché la classe ouvrière de jouer un rôle indépendant lors de la révolution sud-africaine.
Trente ans plus tard, les objectifs sociaux de la révolution sud-africaine n’ont pas été atteints. Seule une révolution socialiste, menée par un parti révolutionnaire de la classe ouvrière indépendant, peut offrir une issue à la crise pour les masses sud-africaines.
Les thèses ont sans doute été rédigées sur la base d’une étude sérieuse, tant des conditions économiques et politiques de l’Afrique du Sud que de la littérature du marxisme et du léninisme, celle des bolcheviks-léninistes en particulier. Aborder de façon scientifique et sérieuse toutes les questions, c’est une des conditions les plus importantes de succès pour une organisation révolutionnaire. L’exemple de nos amis sud-africains confirme une fois de plus qu’à l’époque actuelle, seuls les bolcheviks-léninistes, c’est-à-dire les révolutionnaires prolétariens conséquents, s’intéressent sérieusement à la théorie, analysent la réalité, apprennent eux-mêmes avant d’apprendre aux autres. La bureaucratie stalinienne, elle, a depuis longtemps remplacé le marxisme par une combinaison d’ignorance et d’insolence.
Dans les lignes qui suivent, je veux faire quelques remarques au sujet du projet de thèses qui doivent servir de programme à la Ligue communiste d’Afrique du Sud. Je n’oppose en aucun cas mes remarques au texte de ces thèses. Ma connaissance des conditions en Afrique du Sud est trop insuffisante pour que je puisse prétendre à une opinion pleinement achevée sur toute une série de questions pratiques. C’est seulement dans quelques cas qu’il m’arrivera d’exprimer mon désaccord avec certaines affirmations du projet. Mais, même là, et autant que j’en puisse juger de loin, il n’y a pas de désaccords principiels avec les auteurs des thèses : il s’agit plutôt de quelques formulations politiques exagérées dans la lutte contre la néfaste politique du stalinisme.
Mais il est de l’intérêt de notre cause de ne pas dissimuler même l’imprécision de certaines formulations, et, au contraire, de les soumettre à examen public, afin de parvenir à un texte le plus clair possible, irréprochable. Tel est le but des lignes suivantes, dictées par le désir d’apporter aux bolcheviks-léninistes sud-africains une coopération, même mince, dans l’immense travail, lourd de responsabilités, qu’ils ont entrepris.
Les possessions sud-africaines de la Grande-Bretagne ne constituent un « dominion » que du point de vue de la minorité blanche. Du point de vue de la majorité noire, l’Afrique du Sud est une colonie esclave.
Aucune révolution sociale et au premier chef aucune révolution agraire n’est concevable avec le maintien de la domination de l’impérialisme britannique sur le dominion sud-africain. Le renversement de la domination britannique en Afrique du Sud est aussi nécessaire pour le triomphe du socialisme en Afrique du Sud qu’en Grande-Bretagne même.
Si, comme on peut le supposer, la révolution commence d’abord en Grande-Bretagne, la bourgeoisie anglaise sera battue d’autant plus rapidement dans la métropole que moindre sera l’appui qu’elle pourra trouver dans ses colonies et dominions, y compris dans une possession aussi importante pour elle que l’Afrique du Sud. La lutte pour chasser l’impérialisme britannique, ses instruments, ses agents, s’inscrit ainsi nécessairement dans le programme du parti prolétarien de l’Afrique du Sud.
Le renversement de la domination de l’impérialisme britannique en Afrique du Sud peut être le résultat de la défaite militaire de la Grande-Bretagne et de la désagrégation de son empire ; dans ce cas, les Blancs d’Afrique du Sud peuvent encore maintenir pendant une certaine période, sans doute pas très longtemps, leur domination sur les Noirs. Une autre variante, qui peut en fait être liée à la première, serait la révolution en Grande-Bretagne et dans ses possessions. Les trois quarts de la population de l’Afrique du Sud presque 6 millions sur 8 sont des gens de couleur. La révolution victorieuse, inconcevable sans l’éveil des masses indigènes, leur donnera à son tour ce qui leur manque tellement aujourd’hui : la confiance dans leurs propres forces, une conscience accrue de leur personnalité, le développement de leur culture. Dans ces conditions, la République sud-africaine deviendra avant tout une république « noire » : cela n’exclut, bien entendu, ni une complète égalité de droits pour les Blancs, ni de fraternelles relations entre les deux races (ce qui dépend surtout de la conduite des Blancs). Mais il est absolument évident que la majorité écrasante de la population, affranchie de la dépendance servile, marquera l’État d’une empreinte déterminante.
Dans la mesure où la révolution victorieuse changera radicalement les rapports non seulement entre les classes, mais aussi entre les races, et assurera aux Noirs la place dans l’État qui correspond à leur nombre, la révolution sociale en Afrique du Sud aura également un caractère national. Nous n’avons pas la moindre raison de fermer les yeux sur cet aspect de la question, ou de minimiser son importance. Au contraire, le parti prolétarien doit, et en paroles, et en acte, ouvertement et hardiment, prendre entre ses mains la résolution du problème national (racial).
Mais la résolution de ce problème, le parti prolétarien peut et doit la réaliser par ses propres méthodes.
L’instrument historique de l’émancipation nationale ne peut être que la lutte de classes. L’Internationale communiste, depuis 1924, a transformé le processus d’« émancipation nationale » des peuples coloniaux en une abstraction démocratique creuse, élevée au-dessus de la réalité des rapports de classes. Pour lutter contre l’oppression nationale, les différentes classes s’affranchissent pour un temps de leurs intérêts matériels et deviennent de simples forces « anti-impérialistes ». Pour que ces « forces » immatérielles remplissent de bon cœur la tâche que leur a confiée l’Internationale communiste, on leur promet en récompense un État « national-démocratique » immatériel (avec l’inévitable référence à la formule de Lénine sur la « dictature démocratique des ouvriers et des paysans »).
Les thèses indiquent qu’en 1917 Lénine a ouvertement et, une fois pour toutes, liquidé la formule de la « dictature démocratique des ouvriers et des paysans », en tant que condition prétendument nécessaire pour résoudre la question agraire. C’est absolument exact. Mais, pour éviter tout malentendu, il faut ajouter : a) que Lénine parlait toujours de dictature révolutionnaire bourgeoise-démocratique, et pas d’un État « populaire » immatériel, b) que, dans la lutte pour la dictature bourgeoise-démocratique, il ne proposait pas un bloc de toutes les « forces anti tsaristes », mais menait une politique indépendante de classe du prolétariat. Le bloc « anti tsariste » était une idée des socialistes révolutionnaires russes et des cadets de gauche, c’est-à-dire des partis de la petite et moyenne bourgeoisie. Contre eux, le bolchevisme a toujours mené une lutte implacable.
Quand les thèses disent que le mot d’ordre de « république noire » est aussi nuisible (« equally harmful ») à la cause de la révolution que celui de « l’Afrique du Sud aux Blancs », nous ne pouvons être d’accord avec cette affirmation. De la part des Blancs, il s’agit du maintien d’une domination infâme ; de la part des Noirs, des premiers pas vers leur émancipation. Le droit total et inconditionnel des Noirs à l’indépendance, il nous faut le reconnaître absolument et sans réserve. C’est seulement sur la base d’une lutte commune contre la domination des exploiteurs blancs que pourra s’élever et se renforcer la solidarité des travailleurs noirs et des travailleurs blancs. Il est possible qu’après la victoire les Noirs tiennent pour inutile la création en Afrique du Sud d’un État noir particulier. Naturellement, nous ne leur imposerons pas un séparatisme d’État. Mais qu’ils le reconnaissent librement, sur la base de leur expérience propre, pas sous les verges des oppresseurs blancs. Les révolutionnaires prolétariens ne doivent jamais oublier le droit des nationalités opprimées à disposer d’elles-mêmes, y compris leur droit à la séparation complète, et le devoir du prolétariat de la nation qui opprime à défendre ce droit, y compris, s’il le faut, les armes à la main !
Les thèses soulignent à juste titre le fait que c’est la révolution d’Octobre qui a apporté en Russie la solution de la question nationale. Les mouvements nationaux démocratiques ont été en eux-mêmes impuissants à venir à bout de l’oppression nationale du tsarisme. C’est seulement grâce au fait que les mouvements des nationalités opprimées, ainsi que le mouvement agraire de la paysannerie, ont donné au prolétariat la possibilité de conquérir le pouvoir et d’établir sa dictature, que la question nationale, ainsi que la question agraire, ont trouvé une solution hardie et radicale. Mais la combinaison même des mouvements nationaux avec la lutte du prolétariat pour le pouvoir n’a été possible politiquement que parce que le parti bolchevique, tout au long de son histoire, avait mené une lutte implacable contre les oppresseurs grand-russiens et soutenu toujours et sans réserve le droit des nations opprimées à leur indépendance, jusques et y compris la séparation d’avec la Russie.
La politique de Lénine vis-à-vis des nations opprimées n’avait pourtant rien de commun avec celle des épigones. Le parti bolchevique défendait le droit des nations opprimées à disposer d’elles-mêmes par les méthodes de la lutte de classe prolétarienne, rejetant nettement les blocs « anti-impérialistes » charlatanesques avec les nombreux partis « nationaux » petits-bourgeois de la Russie tsariste (le PPS, le parti de Pilsudski en Pologne, les « dachnaki » en Arménie, les nationalistes ukrainiens, les sionistes chez les Juifs, etc.). Le bolchevisme démasque toujours impitoyablement ces partis, de même que les « sociaux-révolutionnaires », leur double nature et leur aventurisme, et surtout le mensonge de leur idéologie prétendument au-dessus des classes. Il ne suspendait même pas son impitoyable critique lorsque les conditions l’obligeaient à conclure tel ou tel accord épisodique strictement pratique avec ceux. Il ne pouvait être question d’une quelconque alliance permanente avec eux sous le drapeau de « l’anti-tsarisme ». C’est seulement grâce à une politique de classe implacable que le bolchevisme a réussi, dans les conditions de la révolution, à écarter les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires, les partis nationaux petits-bourgeois, et à souder autour du prolétariat les masses de la paysannerie et des nationalités opprimées.
« Nous ne devons pas, disent les thèses, concurrencer le congrès national africain dans le domaine des mots d’ordre nationalistes avec l’objectif de conquérir les paysans indigènes. » L’idée en elle-même est juste, mais exige d’être concrétisée. Faute de connaître de façon précise l’activité du congrès national, je ne puis esquisser notre politique à son égard que par analogie, tout en précisant d’ailleurs que je suis prêt à apporter à mes propositions toute correction nécessaire.
- Les bolcheviks-léninistes sont pour la défense du congrès, tel qu’il est, dans tous les cas où il reçoit les coups des oppresseurs blancs et de leurs agents chauvins dans les rangs des organisations ouvrières.
- Les bolcheviks opposent, dans le programme du congrès, les tendances progressistes et les tendances réactionnaires.
- Les bolcheviks démasquent aux yeux des masses indigènes l’incapacité du congrès à obtenir la réalisation même de ses propres revendications, du fait de sa politique superficielle, conciliatrice, et lancent, en opposition au congrès, un programme de lutte de classe révolutionnaire.
- S’ils sont imposés par la situation, des accords temporaires avec le congrès ne peuvent être admis que dans le cadre de tâches pratiques strictement définies, en maintenant la complète indépendance de notre organisation et notre totale liberté de critique politique.
Les thèses lancent comme mot d’ordre politique central non pas l’« État national-démocratique », mais l’« Octobre » sud-africain. Elles montrent – et ce, avec une évidence parfaite
- Que les questions nationale et agraire en Afrique du Sud coïncident quant au fond,
- Que ces deux questions ne peuvent être résolues que par la voie révolutionnaire,
- Que la résolution révolutionnaire de ces tâches conduit à la dictature du prolétariat dirigeant les masses paysannes indigènes,
- Que la dictature du prolétariat ouvre l’ère du régime soviétique et de l’édification socialiste. Cette conclusion constitue la pierre angulaire de tout l’édifice du programme.
Là-dessus, notre solidarité est totale.
Mais il faut amener les masses à cette formule « stratégique » en général par une série de mots d’ordre « tactiques ». On ne peut les élaborer à chaque étape que sur la base d’une analyse des conditions concrètes de la vie et de la lutte du prolétariat et de la paysannerie, ainsi que de toute la situation nationale et internationale. Sans entrer dans ce domaine, je veux seulement m’arrêter brièvement sur la question de la corrélation entre les mots d’ordre nationaux et les mots d’ordre agraires.
Les thèses soulignent à plusieurs reprises qu’il faut d’abord lancer, non des revendications nationales, mais des revendications agraires. C’est une question très importante, qui mérite une sérieuse attention. Rejeter à l’arrière-plan les mots d’ordre nationaux ou les atténuer pour ne pas repousser les chauvins blancs au sein de la classe ouvrière serait, bien entendu, un opportunisme criminel, absolument étranger aux auteurs et partisans des thèses : cela découle très clairement de ces thèses, imprégnées d’internationalisme révolutionnaire. De ces socialistes qui luttent pour les privilèges des Blancs, les thèses disent fort justement : « Il faut voir que ces “socialistes” sont les pires ennemis de la révolution. » Reste une autre explication, indiquée au passage dans le texte lui-même : les masses paysannes arriérées ressentent de façon beaucoup plus immédiate l’oppression agraire que l’oppression nationale. C’est tout à fait possible : la majorité des Noirs sont des paysans, et la plus grande partie des terres est entre les mains de la minorité blanche. Dans leur lutte pour la terre, les paysans russes ont longtemps placé leurs espoirs dans le tsar, et ils se tenaient soigneusement à l’écart de toutes conclusions politiques. Du mot d’ordre traditionnel de l’intelligentsia révolutionnaire « Terre et Liberté ! », le moujik n’a longtemps retenu que la première partie. Il a fallu des dizaines d’années d’agitation agraire et d’influence des ouvriers des villes pour que le paysan en vienne à lier ces deux mots d’ordre.
Le Bantou pauvre et esclave nourrit à peine plus d’espoirs dans le roi d’Angleterre ou en MacDonald. Mais son extrême arriération politique s’exprime aussi par son manque de conscience nationale. Et en même temps, il ressent très vivement la servitude agraire et fiscale. Dans ces conditions, notre propagande peut et doit avant tout partir des mots d’ordre de la révolution agraire, afin d’amener pas à pas, sur la base de leur expérience de la lutte, les paysans conclusions aux politiques et nationales nécessaires. Si ces considérations politiques sont exactes, il ne s’agit pas de la question du programme en lui-même, mais de celle de savoir par quelle voie faire pénétrer ce programme dans la conscience des masses indigènes.
Compte tenu de la faiblesse numérique des forces révolutionnaires et de l’extrême dispersion de la paysannerie, il ne sera pas possible, au moins dans la prochaine période, d’agir sur ces derniers autrement qu’avant tout, sinon exclusivement, par l’intermédiaire de l’avant-garde ouvrière. Il est d’autant plus important d’éduquer cette dernière dans l’esprit d’une claire compréhension de l’importance de la révolution agraire pour la destinée de l’Afrique du Sud.
Le prolétariat du pays comprend des parias noirs arriérés et une caste privilégiée arrogante de Blancs. C’est là que réside la plus grande difficulté dans toute cette situation. Les secousses économiques de l’époque du capitalisme pourrissant, comme l’indiquent justement les thèses, doivent profondément ébranler les vieilles cloisons et faciliter le travail de rassemblement révolutionnaire. Le pire des crimes serait en tout cas pour les révolutionnaires de faire la moindre concession aux privilèges et aux préjugés des Blancs. Celui qui donne le petit doigt au démon du chauvinisme est perdu. À tout ouvrier blanc, le parti révolutionnaire doit poser l’alternative : ou bien avec l’impérialisme britannique et avec la bourgeoisie blanche d’Afrique du Sud, ou bien avec les ouvriers et paysans noirs contre les féodaux et esclavagistes blancs et leurs agents au sein de la classe ouvrière même.
Le renversement de la domination britannique sur la population noire de l’Afrique du Sud ne signifiera pas, bien entendu, la rupture économique et culturelle avec l’ancienne métropole, si cette dernière s’est elle-même affranchie des pillards impérialistes qui l’oppriment. Par l’intermédiaire des Blancs qui lieront dans les faits, dans une lutte commune, leur sort à celui des esclaves coloniaux actuels, l’Angleterre soviétique pourra exercer sur l’Afrique du Sud une puissante influence économique et culturelle, cette fois, non plus sur la base d’une domination, mais sur celle des principes de l’entraide prolétarienne.
Mais l’influence que l’Afrique du Sud soviétique exercera sur tout le continent noir sera peut-être plus importante encore. Aider les Noirs à rattraper la race blanche, afin de s’élever, la main dans la main, à de nouvelles hauteurs de la culture, telle sera l’une des tâches les plus grandioses et les plus nobles du socialisme.
Je veux, pour conclure, dire quelques mots de l’organisation légale et illégale (« Concerning the Constitution of the Party »).
Les thèses soulignent à juste titre le lien indispensable entre l’organisation, le programme et la tactique du parti. L’organisation doit assurer l’accomplissement de toutes les tâches révolutionnaires en complétant l’appareil légal par un appareil illégal. Personne ne propose, bien entendu, de créer un appareil illégal pour des fonctions qui, dans les conditions actuelles, peuvent être remplies par l’appareil légal. Mais dès qu’approche une crise politique, il faut créer des cellules de réserve, illégales, de l’appareil, lesquelles pourront, en cas de besoin, s’étendre. Une certaine partie du travail, d’ailleurs très importante, ne peut en outre, sous aucune condition, être faite ouvertement, c’est-à-dire sous les yeux de l’ennemi de classe.
Pourtant, la forme la plus importante – pour la période actuelle – du travail illégal ou semi-légal pour des révolutionnaires est le travail dans les organisations de masse, avant tout les syndicats.
Les chefs des trade-unions constituent une police officieuse du capital ; ils mènent contre les révolutionnaires une lutte impitoyable. Il faut savoir travailler au sein des organisations de masse sans tomber sous les coups de l’appareil réactionnaire. Le groupe révolutionnaire à l’intérieur des syndicats qui apprend par son expérience toutes les règles élémentaires de la conspiration saura poursuivre son travail dans une situation d’illégalité quand les circonstances l’exigeront.