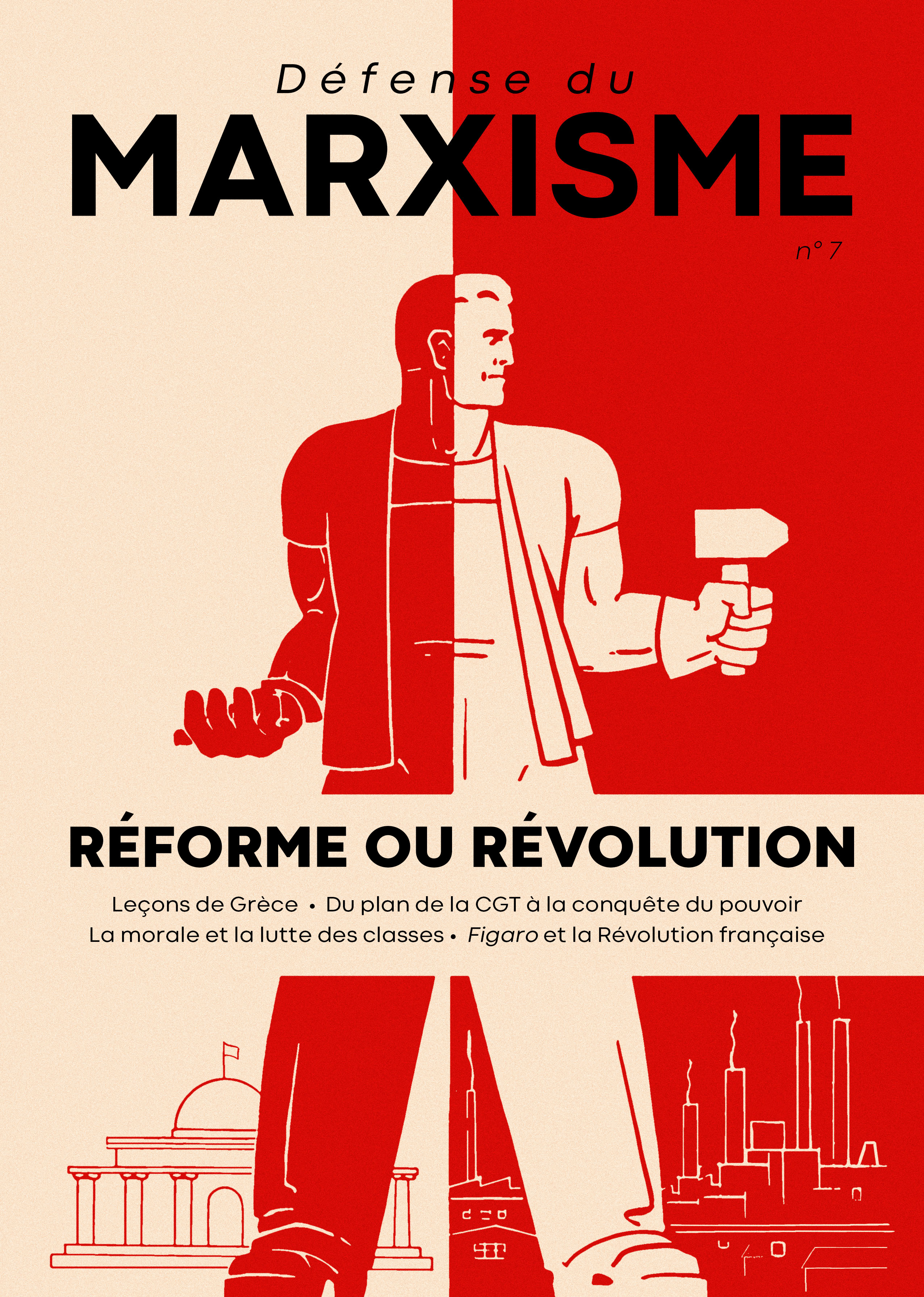Cet article a été écrit le 13 octobre. Depuis, le président Rajoelina a – depuis son exil à Dubaï – dissous l’Assemblée nationale malgache avant que celle-ci ne le démette de ses fonctions et les chefs du CAPSAT ont annoncé qu’ils prenaient le pouvoir.
Les événements se sont déroulés à une vitesse fulgurante le week-end dernier à Madagascar. Le mouvement de masse de la jeunesse, qui a débuté le 25 septembre, a renversé l'ancien régime. Une partie de l'armée s’est désolidarisée de la répression et a rejoint les manifestants. Le président a dû être évacué par un avion militaire français dimanche 12 octobre.
L’élément déclencheur du mouvement a été les coupures d'électricité constantes, qui rendent la vie quotidienne très difficile. Mais ce n'était que le symptôme le plus frappant d'une profonde colère contre la corruption, le contraste obscène entre l’énorme richesse accumulée d’un côté de la société (notamment par d’influents hommes d'affaires) et les conditions de vie désastreuses des masses sur une île où 79 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
De la protestation au soulèvement
Ce qui avait commencé comme un mouvement de protestation pacifique mené par des étudiants, en partie inspirés par les « révolutions de la génération Z » en Indonésie et au Népal, s'est transformé en soulèvement national contre le régime du président Rajoelina. Ce dernier a fait usage d’une répression brutale contre les manifestants, faisant au moins 25 morts. Comme la répression n’a pas réussi à intimider la jeunesse, le régime a tenté de faire des concessions, allant jusqu’à renvoyer le gouvernement et nommer un nouveau Premier ministre. Mais c'était trop peu et trop tard. L’objectif du mouvement était devenu le renversement de ce régime sanglant.
Un premier test du rapport entre les masses et le régime avait eu lieu le 30 septembre, lorsque la jeunesse avait débordé la police dans la capitale, atteignant ainsi la place centrale du 13 mai. Le régime était comme suspendu dans les airs, mais a lancé une répression brutale les jours suivants.
Les affrontements entre les étudiants et la gendarmerie, particulièrement détestée par la population, se sont alors intensifiés. Le mouvement « GenZ Madagascar » a appelé à une grève générale et certaines sections du mouvement syndical l’ont rejoint. Ce fut notamment le cas des étudiants en médecine qui ont avancé leurs propres revendications concernant leurs conditions de travail, les fonctionnaires, les travailleurs de la compagnie d'eau et d'électricité JIRAMA, ainsi que les gardiens de prison, qui ont annoncé qu'ils refuseraient désormais de garder les manifestants arrêtés.
C'est cette pression croissante du mouvement de masse et l'obstination du président à rester au pouvoir – allant jusqu'à tenter de nommer un nouveau Premier ministre – qui a finalement provoqué une fracture au sein de l'armée.
L’armée fait défection
Le 2 octobre, des rumeurs circulaient sur de possibles affrontements à l'intérieur même de casernes militaires, où un climat de mutinerie se développait. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés. La situation était confuse et a mené à l'arrestation de dix soldats du CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques), basé à Soanierana, près de la capitale.
Le 10 octobre, dans la ville d'Antsiranana, au nord du pays, l'un des lieux où le mouvement a été le plus fort, des soldats ont aidé les manifestants et les ont escortés jusqu’au centre-ville. Cela envoyait un message clair de révolte contre les ordres du président.
Le dos au mur, le président Rajoelina a fait plusieurs promesses, notamment celle d'équiper les universités de générateurs électriques. Il a demandé une trêve d'un an, pendant laquelle il s'engageait à résoudre les problèmes soulevés par le mouvement. Il était clairement trop tard. Les masses n'étaient pas disposées à faire de compromis. Elles voulaient que le régime entier soit balayé.
Le 11 octobre, la digue a finalement cédé. Les soldats du CAPSAT, menés par leurs officiers supérieurs, ont annoncé publiquement qu'ils ne participeraient plus à la répression, passant ainsi ouvertement à la rébellion : « Nos enfants souffrent, nous ne sommes pas là pour les tuer et les battre. Nous vivons la même souffrance. Nous devons les soutenir. Ne nous laissons pas manipuler par l'argent ou le pouvoir. »
Leur déclaration souligne que les soldats sont issus de familles de travailleurs et qu’ils ont atteint un point de rupture où ils leur devenait insupportables d’être utilisés contre leurs frères et leurs sœurs (et leurs enfants). Ils souffrent également des mêmes conditions qui affectent les travailleurs en général (pauvreté, coupures d'électricité, etc.).
Dans leur déclaration, les membres du CAPSAT ont appelé les autres unités de l'armée, ainsi que la police et la gendarmerie, à suivre leur exemple. Ils ont appelé la population à défendre leurs casernes, appelé la garde présidentielle à désobéir, et ont lancé un appel à bloquer la route menant à l'aéroport d'Antananarivo, dans le cas où le président tenterait de s'enfuir. Il s'agissait clairement d'un appel à une insurrection générale.
Le président Rajoelina a répondu par une déclaration dénonçant un « coup d'Etat », mais c’était tout ce qu’il pouvait faire maintenant.
Le même jour, les soldats du CAPSAT, après avoir sécurisé leurs casernes, sont sortis, armes à la main, et ont accompagné les manifestants vers la place du 13 mai. Le chemin menant à la place était bloqué par la gendarmerie, ce qui a donné lieu à un bref échange de tirs. Les soldats étaient largement plus nombreux et les gendarmes ont pris la fuite. Un soldat du CAPSAT, Fanomezantsoa Stephano Jacky et deux civils, Safidy et Rivoniandry Riva Rakotomalala, ont été tués lors de l’affrontement. Cela n’a pas empêché la foule, escortée par les soldats mutins d’occuper la place. C’était le début de la fin du régime.
Dans les heures qui ont suivi, le CAPSAT a manœuvré rapidement pour consolider sa position. Une réunion avec les officiers de gendarmerie a négocié la neutralité des gendarmes ainsi que la fin des affrontements. Au moins une unité de gendarmerie s’est alors rangée du côté du peuple. La Force d'intervention nationale de la gendarmerie (FIGN), chargée de la protection présidentielle, a publié une déclaration publique dans laquelle elle présentait ses excuses à la population pour avoir recouru à la répression et annonçait que l'ensemble de la gendarmerie était dorénavant placée sous son contrôle.
Puis vint une dernière étape, lorsque, aux premières heures du dimanche 12 octobre, les officiers du CAPSAT déclarèrent que toutes les unités militaires et policières devaient obéir à leurs ordres. Ils ont nommé un nouveau chef des armées, le Général Démosthène Pikulas, officier du CAPSAT. Puis, la gendarmerie a été placée sous l’autorité du général de brigade Mamelison Mbina Nonos, du FIGN. Les unités militaires rebelles contrôlaient maintenant les forces armées.
Lundi, le Sénat s'est réuni et a destitué son président, le général Richard « Bomba » Ravalomanana, considéré comme le principal responsable de la répression brutale du mouvement. C'était la suite logique des événements. Le pouvoir n'était plus entre les mains des institutions, mais entre celles des soldats mutinés et des masses dans les rues.
Le président Rajoelina s’enfuit
Il restait à savoir ce que le Président Rajoelina allait faire. Des rumeurs laissaient entendre qu’il avait déjà fui le pays, mais le lundi 13 octobre, il annonçait sur son compte Facebook qu’il s'adresserait à la nation dans la soirée. C’était une diversion, puisqu’il a été révélé qu'il s’était alors déjà envolé à bord d’un avion militaire français, d'abord vers La Réunion, puis vers Dubaï. L'ancienne puissance coloniale exerce toujours une influence forte sur la politique et l'économie de l'île.
Le Premier ministre déchu Christian Ntsay, et l’homme d’affaires Mamy Ravatomanga, proche du président, avaient eux aussi quitté l'île à bord d'un jet privé à destination de l'île Maurice.
Et maintenant ? Tout d'abord, il faut souligner que le renversement de Rajoelina est une victoire pour le mouvement révolutionnaire de Madagascar. C'est la lutte courageuse et acharnée des jeunes, qui s’est ensuite étendue à des sections de la classe ouvrière et à la population en général, qui l'a contraint à partir. L'armée n'aurait jamais rompu les rangs sans la lutte inlassable des masses de la jeunesse qui, pendant près de trois semaines, sont restées dans les rues et ont intensifié leurs actions face à une répression sanglante.
Le courage, la résilience et la détermination des masses malgaches face à une répression brutale et malgré leur faible organisation constituent un exemple et une source d'inspiration pour les masses ouvrières et la jeunesse à travers le continent et dans le monde entier.
Comment expliquer la rébellion de l'armée ? D'une part, elle est clairement le résultat de l'impact de la mobilisation des masses sur les soldats et les officiers subalternes, qui sont eux-mêmes issus de familles ouvrières et dont les conditions de vie sont proches de celles des travailleurs. Toute véritable révolution produit de telles divisions dans l'appareil d'Etat selon des lignes de classe.
Il existe aussi un autre facteur. Certains officiers, qui avaient déjà participé à une rébellion similaire en 2009 lors d'un précédent mouvement de masse, ont été motivés par des considérations différentes. Ils voyaient le régime s'effondrer et ne voulaient pas être entraînés dans sa chute. Ils ont pensé qu'une rébellion rapide de l'armée permettrait à l'institution militaire de rester intacte et de pouvoir jouer un rôle dans la transition du pouvoir après la destitution de Rajoelina. Ce qui les motive réellement, c’est leur propre sort et leur volonté de garantir une transition institutionnelle sûre pour la bourgeoisie.
Quelle est la prochaine étape pour la révolution malgache ?
Les masses, bien sûr, sont en liesse et ont accueilli les soldats de la CAPSAT comme des héros. Mais elles doivent rester vigilantes et ne faire aucune confiance aux officiers supérieurs qui n'ont changé de camp qu'à la dernière minute, motivés avant tout par leur propre survie.
Dès le lundi, de nombreux commentateurs faisaient remarquer que de nombreux politiciens essayaient de tirer profit de la situation, alors qu’ils n'avaient joué aucun rôle dans le mouvement.
« Je suis frustré et un peu déçu de ce qu’il se passe actuellement, », déclarait un manifestant à Radio France Internationale (RFI). « J'ai l'impression que les jeunes ont fait tout le travail et que maintenant ce sont les moins jeunes qui sont là à faire leur show, comme d'habitude. Après, c'est politique, donc les jeunes n'ont pas forcément fait de la politique. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu décevant. On dirait un peu une récupération politique. Nous, on aimerait mettre quelqu'un au pouvoir, et non quelqu'un qui était déjà là depuis longtemps et pour qui il est plus facile de prendre la place. Notre lutte est loin d'être finie. »
Le mouvement révolutionnaire de Madagascar a fait d'énormes progrès et s'est mieux organisé au cours des deux semaines de lutte. Des comités de coordination dans les quartiers (KMT) ont été mis en place et, dans certains secteurs de la capitale, des patrouilles de vigilance contre les pillages ont été mises sur pied. Cependant, le mouvement n'est probablement pas encore assez structuré pour résister à l'énorme pression qui s’exerce aujourd’hui en faveur d'un retour à une politique bourgeoise « normale ».
Comme au Bangladesh l’an dernier ou au Népal il y a quelques semaines, la bourgeoisie prône la formation d’un gouvernement provisoire dirigé par des figures « indépendantes » qui ne soient pas discréditées comme le reste des politiciens bourgeois.
Afin de lui donner un semblant de légitimité et d'apaiser la jeunesse étudiante, il est même possible que le mouvement soit consulté sur le choix du président. Certains de ses membres seront peut-être inclus dans le gouvernement. Les nouveaux chefs des forces armées, issus des unités rebelles, vont surveiller l'ensemble du processus. C'est à peu près ce qu’il s’était passé après le mouvement de masse de 2009, dans un processus qui s'est soldé par la prise de pouvoir d'une « figure jeune », « extérieure à la politique ». Son nom ? Le président Rajoelina.
Cependant, la question principale demeure. Aucun des problèmes graves auxquels sont confrontées les masses ne peut être résolu sans s’attaquer au système capitaliste dans son ensemble. Le problème n'est pas seulement la corruption. Celle-ci n’est qu’un symptôme de la pourriture du système capitaliste dans un pays pauvre dominé par l'impérialisme. Le mouvement a réclamé l'expropriation de tous les biens de Mamy Ravatomanga, l'un des capitalistes les plus riches du pays. Ce n'est pas seulement lui, mais tous les capitalistes qui devraient être expropriés.
Si les masses malgaches avaient une direction révolutionnaire dotée d'un programme clair pour renverser le capitalisme, elles pourraient aujourd'hui célébrer la victoire totale de la révolution. En l'absence d'une telle direction, elles devront très probablement passer par la même expérience que les masses du Sri Lanka, du Bangladesh, du Népal, etc.
- Aucune confiance dans les politiciens bourgeois, les personnalités publiques et les généraux de l'armée – les masses de jeunes et de travailleurs ne doivent avoir confiance qu'en leurs propres forces !
- Pas de transition dictée d’en haut vers un nouveau gouvernement capitaliste pour que rien ne change – Tout le pouvoir aux travailleurs organisés en comités démocratiques de lutte !
- Pour le contrôle ouvrier des entreprises publiques (notamment JIRAMA) et pour l'annulation de toutes les mesures de privatisation !
- Exproprions les profits mafieux de Rajoelina, Ravatomanga et leur clique !
- Chassons l’impérialisme français !
- Pour un gouvernement des travailleurs qui prenne le contrôle des ressources de l'île, et les utilise démocratiquement pour satisfaire les besoins de tous !