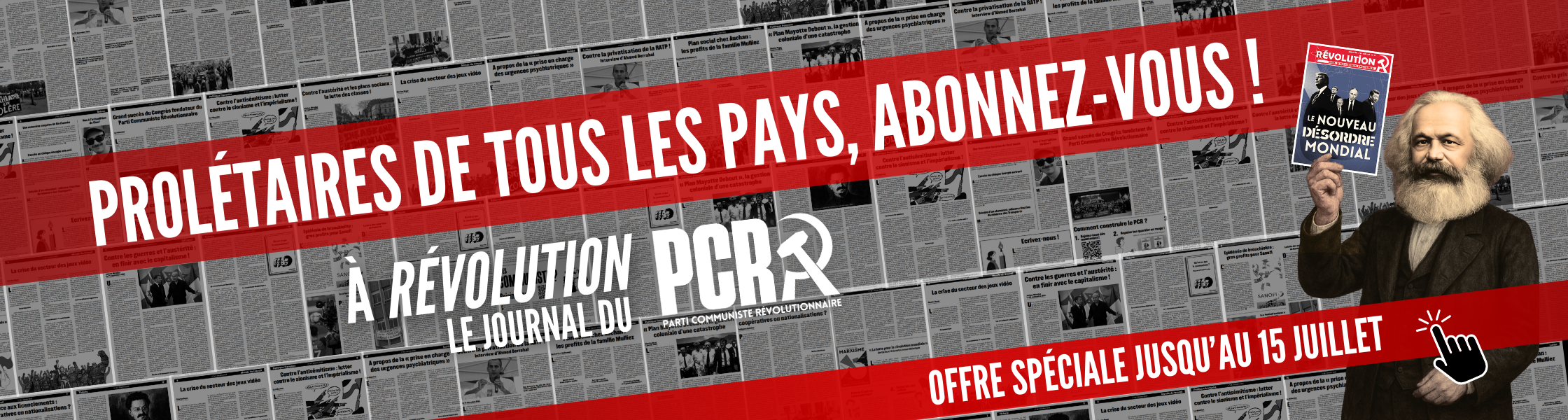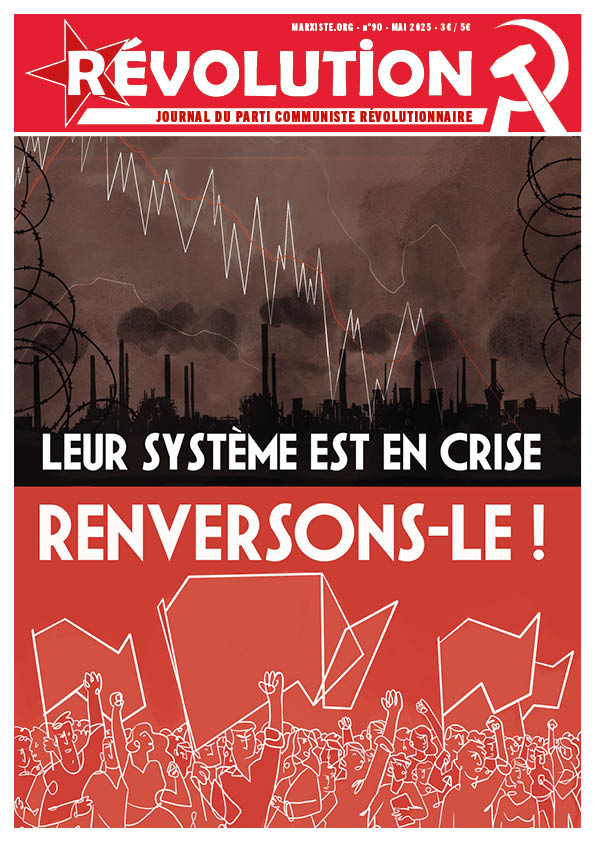Depuis quelques mois, un sujet inhabituel occupe la scène politique et la presse françaises : les relations franco-algériennes. Les responsables politiques français se succèdent pour réclamer « des mesures extrêmement fermes » contre l’Algérie. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est en pointe de cette offensive, menée sous les applaudissements de l’extrême droite. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, semble relégué au second plan sur cette question qui relève pourtant officiellement de ses services. Que signifie cette « escalade » ?
La crise diplomatique
En juillet dernier, Emmanuel Macron adressait un courrier officiel au roi du Maroc, Mohammed VI, dans lequel il reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce territoire est occupé par le Maroc depuis 1975 malgré plusieurs condamnations de l’ONU et la résistance organisée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie. La position adoptée par Macron marquait une rupture avec la position historique de neutralité de la France sur cette question. En réaction, l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France. C’est cet épisode qui marqua le début de la présente crise diplomatique.
Plusieurs incidents se sont ensuite succédé : l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal ; des arrestations médiatisées d’influenceurs algériens… Mi-mars, Paris soumet publiquement à Alger une liste d’une soixantaine de ressortissants à expulser. L’Algérie refuse et invite les autorités françaises à « suivre le canal d’usage en l’occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats ».
La classe dirigeante a trouvé là une nouvelle opportunité d’alimenter sa campagne raciste permanente contre les immigrés. Au nom de la « sécurité nationale », plusieurs ministres et politiciens de droite – notamment Retailleau, Darmanin et Bayrou – proclament la nécessité d’une « réponse graduée ». Celle-ci pourrait aller jusqu’à la rupture des accords de 1968, qui régissent le statut particulier des Algériens résidant en France en matière de circulation, de séjour et d’emploi. Ces accords, dont la plupart des Français ignoraient l’existence jusqu’à présent, sont aujourd’hui dénoncés comme une menace quasi existentielle par tous les ténors de la droite et de l’extrême droite.
Au-delà de l’intérêt que représente le racisme pour la classe dirigeante, la plupart de ces politiciens bourgeois ont aussi un intérêt personnel à cette croisade contre Alger. Retailleau et Wauquiez sont lancés dans une course à la présidence des Républicains, avec la prochaine présidentielle en ligne de mire. Alors qu’ils cherchent tous deux à concurrencer le RN, leur compétition s’apparente de plus en plus à un concours de la déclaration la plus outrageusement raciste.
François Bayrou est aujourd’hui soumis au bon vouloir du RN – qui lui apporte un soutien passif à l’Assemblée nationale en s’abstenant de le censurer. Pour s’attirer les bonnes grâces des députés lepénistes, Bayrou multiplie donc les sorties xénophobes, que ce soit sur la « submersion migratoire » ou sur les accords de 1968.
Les intérêts stratégiques de la bourgeoisie française
En jetant de l’huile sur le feu, Retailleau ne se soucie guère des conséquences diplomatiques et économiques de ses menaces. Pourtant, la bourgeoisie française a d’importants intérêts économiques en Algérie et observe avec inquiétude la détérioration des relations franco-algériennes. En 2023, les échanges commerciaux entre la France et l’Algérie représentaient 11,6 milliards d’euros. Environ 450 entreprises françaises sont implantées en Algérie. Ce sont ces intérêts qui expliquent l’attitude de Macron, qui a tenté à plusieurs reprises de calmer le jeu. Il a même désavoué Retailleau et Bayrou sur la question d’une éventuelle dénonciation des accords de 1968.
Mais le président français joue l’équilibriste car c’est aussi lui, rappelons-le, qui a tiré le coup d’envoi de cette brouille diplomatique. D’autres intérêts économiques sont en effet en jeu dans le Sahara occidental, un territoire très riche en ressources naturelles (comme le phosphate). En visite au Maroc le 29 octobre, Macron déclarait : « nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. » A l’issue de ce voyage diplomatique, plus de 10 milliards d’euros de contrats furent signés pour des entreprises françaises comme Alstom, Veolia, ou encore TotalEnergies. De plus, alors que, fin janvier, Paris a dû rétrocéder au Tchad une de ses dernières bases militaires dans le Sahel, le Maroc reste aussi un précieux appui militaire dans cette région. Les troupes françaises et marocaines mènent notamment des exercices militaires communs, les opérations « Chergui ».
Cette situation est symptomatique du déclin de l’impérialisme français en Afrique. L’Etat français essaie, tant bien que mal, d’y défendre ses dernières positions, et de conquérir de nouveaux marchés, là où les rares opportunités se présentent – comme c’est le cas dans le Sahara occidental. Au passage, il attise les tensions dans la région et sème en France le poison du racisme. Lorsque les impérialistes s’en mêlent, ce sont toujours les travailleurs qui en paient le prix, qu’ils soient français ou algériens.