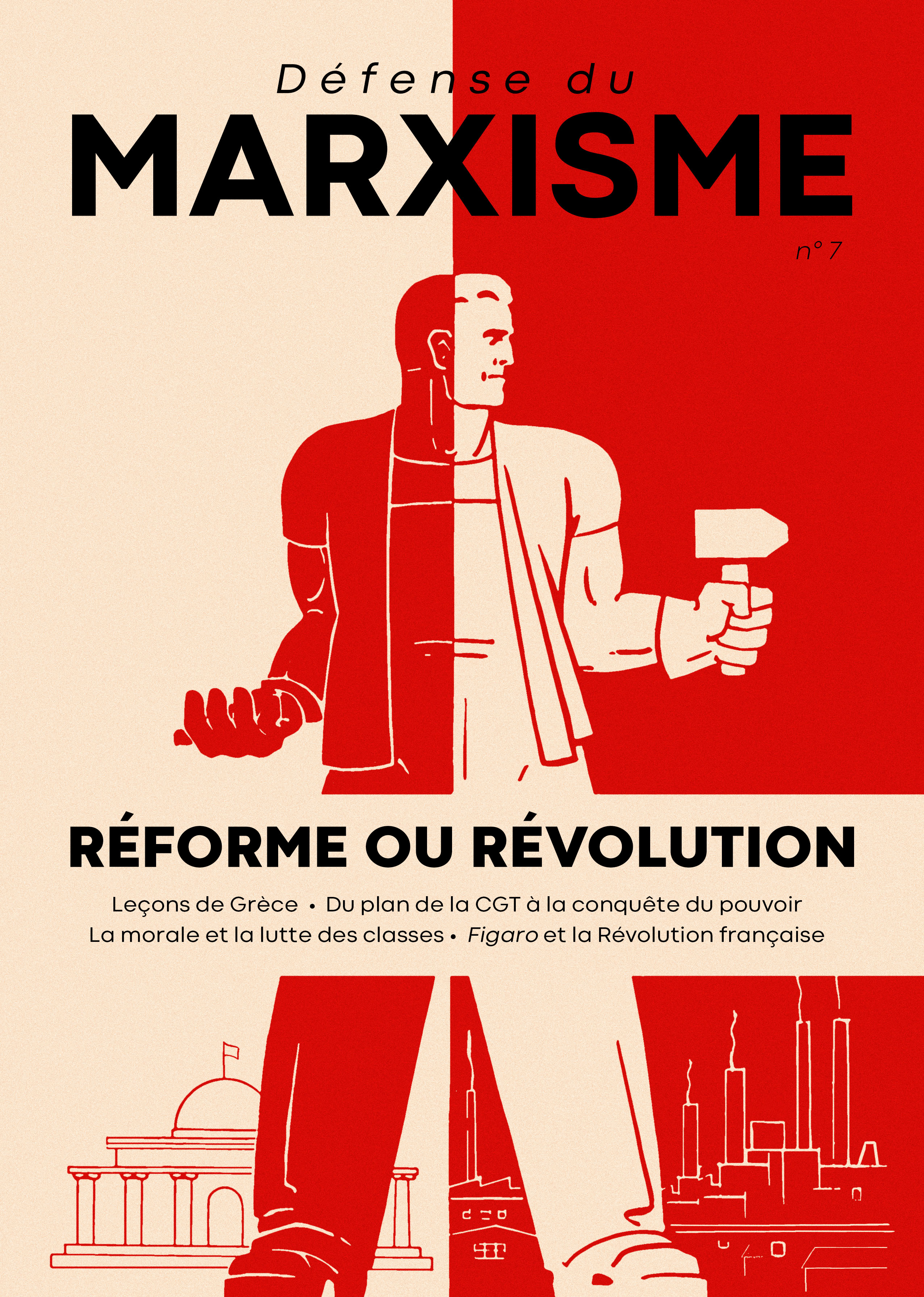Toute l’histoire du mouvement ouvrier international démontre que les travailleurs ne peuvent pas prendre et conserver le pouvoir s’ils ne disposent pas d’un puissant parti révolutionnaire. C’est le facteur qui manque, partout, dans la situation présente. Dans un pays après l’autre, les peuples entrent en action, mais il leur manque un parti révolutionnaire pour renverser le capitalisme.
En 1938, Léon Trotsky écrivait : "La crise historique de l’humanité se résume à la crise de la direction révolutionnaire". C’est plus que jamais d’actualité. La Tendance Marxiste Internationale, dont Révolution est la section française, travaille précisément à la résolution de cette crise. Quel type de partis construisons-nous aux quatre coins du monde ? Sur la base de quelles idées et de quelles méthodes ? Pourquoi nous réclamons-nous du parti bolchevik de Lénine et Trotsky ?