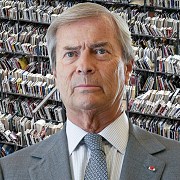Il y a près de dix ans, en septembre 2014, sortait le film Pride. Réalisé par Matthew Warchus, il raconte l’histoire de Mark Ashton et du collectif LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners), un groupe de militants LGBT mobilisés en soutien aux mineurs britanniques lors de leur grande grève de 1984-1985. Porté par des acteurs de renom tels que Bill Nighy et Andrew Scott, Pride est une excellente leçon pour tous ceux qui veulent lutter contre les oppressions.
Deux communautés, un même ennemi
L’action se passe dans l’Angleterre des années Thatcher. Première ministre de 1979 à 1990, Margaret Thatcher enchaîne les attaques contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Elle engage la désindustrialisation de la Grande-Bretagne, et en particulier la fermeture des mines, qui font vivre les travailleurs de régions entières.
Pour tenter de briser la résistance des mineurs, leurs traditions militantes et leurs organisations – à commencer par la NUM (National Union of Miners) d’Arthur Scargill – le gouvernement multiplie les provocations, jusqu’à la fermeture de la mine de Cortonwood, le 1er mars 1984. C’est l’élément déclencheur de la grève de 1984-1985.
A la même époque, les cas de VIH explosent au Royaume-Uni – sans susciter la moindre réaction du gouvernement, dont la politique alimente l’homophobie. Le collectif LGSM naît de ce constat : les grévistes et les personnes LGBT sont attaqués par la même police, calomniés par les mêmes journalistes, méprisés par le même gouvernement. Après une collecte pour les mineurs lors de la Marche des fiertés de Londres, en 1984, Mark Ashton et ses amis décident de fonder LGSM en juillet de la même année, puis se rendent dans la vallée galloise de Dulais.
Soutenir les mineurs – d’abord financièrement – était une évidence pour LGSM. La grève était menacée par son isolement. La responsabilité en revenait alors aux dirigeants officiels du mouvement ouvrier. Si les dirigeants de la NUM étaient très combatifs, on ne pouvait pas en dire autant des autres. Par exemple, Neil Kinnock, le dirigeant du Parti travailliste de l’époque, renvoyait dos à dos la « violence » des piquets de grève et celle de la police ! Cette passivité fut l’une des causes centrales de la défaite des mineurs, au terme d’un an de lutte.
Unité de classe
Pride donne à voir de grands moments de ce combat, et notamment le rôle joué par les femmes dans la grève, magnifié dans une scène où les femmes de mineurs chantent « Bread and Roses ». Le propos central – et tout à fait juste – du film, c’est que la lutte commune et la solidarité concrète permettent de dépasser les préjugés, voire de vaincre les discriminations. Mais au passage, Pride force le trait : il exagère l’antagonisme initial entre les mineurs et les membres de LGSM. Comme l’expliquait Ray Goodspeed, membre fondateur de LGSM, lors d’une Ecole organisée par notre section britannique en 2015 : « Bien que le film mette en scène la NUM refusant les dons de LGSM pour des raisons homophobes, cela n’est jamais arrivé. [...] En réalité, les grévistes d’Onllwyn ont accueilli LGSM avec enthousiasme ».
Il arrive que les événements de Pride soient décrits comme une « rencontre improbable ». Mais la rencontre que montre ce film n’est pas tant celle de deux communautés différentes que celle de militants dévoués à l’unité de la classe ouvrière. Travaillant d’arrache-pied, LGSM a récolté 20 000 livres sterling pour les grévistes. Dans sa scène finale, le film montre comment les mineurs ont répondu à cette solidarité : après la défaite de leur grève, les mineurs ont organisé un cortège massif en tête de la Marche des fiertés de Londres, en 1985. Par la suite, la NUM a continué d’être à l’avant-poste de la lutte pour les droits LGBT, notamment au sein du Parti travailliste.
Des leçons pour la lutte
L’homophobie et la transphobie n’ont pas disparu. La réalité, c’est que le capitalisme ne peut pas permettre l’émancipation véritable des personnes LGBT. Ce système a besoin de l’homophobie et de la transphobie pour diviser la classe ouvrière et détourner la colère vers des boucs émissaires. Les politiciens réactionnaires ne cesseront jamais de cibler les personnes LGBT au nom de la défense du « modèle » de la « famille traditionnelle », ce vieux pilier de l’ordre établi.
Malgré leur récupération par la bourgeoisie « libérale », les Marches des fiertés réunissent chaque année des millions de jeunes et de travailleurs à travers le monde. Elles permettent aux opprimés et aux travailleurs d’exprimer leur colère contre le système dans son ensemble. La grande leçon de Pride, c’est que pour lutter concrètement contre les oppressions, l’unité de tous les exploités et tous les opprimés est essentielle. Ajoutons que pour se débarrasser définitivement de la misère et des oppressions, cette unité doit se réaliser sur un programme révolutionnaire, c’est-à-dire communiste.