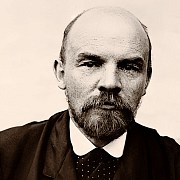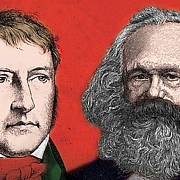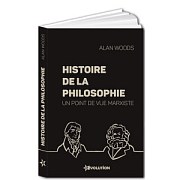Evaporation de la morale
On voit, dans les époques de réaction triomphante, MM. les démocrates, sociaux-démocrates, anarchistes et autres représentants de la gauche, sécréter de la morale en quantité double, de même que les gens transpirent davantage quand ils ont peur. Répétant à leur façon les dix commandements ou le sermon sur la montagne, ces moralistes s’adressent moins à la réaction triomphante qu’aux révolutionnaires traqués, dont les « excès » et les principes « amoraux » « provoquent » la réaction et lui fournissent une justification morale. Il y aurait cependant un moyen élémentaire, mais sûr, d’éviter la réaction : l’effort intérieur, la renaissance morale. Des échantillons de perfection éthique sont distribués gratuitement dans toutes les rédactions intéressées. Cette prédication aussi ampoulée que fausse a sa base sociale – de classe – dans la petite bourgeoisie intellectuelle. Sa base politique est dans l’impuissance et le désarroi devant la réaction. Base psychologique : le désir de surmonter sa propre inconsistance en se mettant une fausse barbe de prophète.
Le procédé favori du philistin moralisateur consiste à identifier les façons d’agir de la révolution et de la réaction. Des analogies formelles en assurent le succès. Le tsarisme et le bolchevisme deviennent des jumeaux. On peut découvrir également des jumeaux dans le fascisme et le communisme.
On peut dresser la liste des caractères communs au catholicisme ou au jésuitisme et au communisme. De leur côté, Hitler et Mussolini, usant d’une méthode tout à fait semblable, démontrent que le libéralisme, la démocratie et le bolchevisme ne sont que les diverses manifestations d’un même mal. L’idée que le stalinisme et le trotskysme sont « au fond identiques » rencontre aujourd’hui la plus large audience. Elle réunit les libéraux, les démocrates, les pieux catholiques, les idéalistes, les pragmatistes, les anarchistes et les fascistes. Si les staliniens n’ont pas la possibilité de se joindre à ce « Front populaire »-là, c’est seulement par un effet du hasard : ils sont précisément absorbés par l’extermination des trotskistes.
Ces rapprochements et ces identifications sont essentiellement caractérisés par l’ignorance complète des assises matérielles des diverses tendances, c’est-à-dire de leur nature sociale et, dès lors, de leur rôle historique objectif. On y apprécie et classe par contre les diverses tendances d’après des indices extérieurs et secondaires, le plus souvent d’après leur attitude envers tel ou tel principe abstrait auquel le classificateur attribue professionnellement une signification particulière. Pour le pape, les francs-maçons, les darwinistes, les marxistes et les anarchistes sont frères en le sacrilège puisqu’ils repoussent tous l’Immaculée Conception. Pour Hitler, le libéralisme et le marxisme, ignorant l’un et l’autre « le sang et l’honneur », sont des jumeaux. Jumeaux pour le démocrate, le fascisme et le bolchevisme puisqu’ils refusent de s’incliner devant le suffrage universel. Et cætera.
Les traits communs aux tendances ainsi rapprochées sont indéniables. Mais le développement de l’espèce humaine n’est épuisé ni par le suffrage universel ni par « le sang et l’honneur », ni par le dogme de l’Immaculée Conception ; – tout est là. Le devenir historique est avant tout lutte des classes, et il arrive que des classes différentes usent, à des fins différentes, de moyens analogues. Il ne saurait en être autrement. Les armées belligérantes sont toujours plus ou moins symétriques ; s’il n’y avait rien de commun dans leurs façons de combattre, elles ne pourraient pas se heurter.
Le paysan ou le boutiquier inculte, s’il se trouve entre deux feux, sans comprendre les causes et la portée du combat engagé entre le prolétariat et la bourgeoisie, considère les deux partis en présence avec une haine égale. Mais que sont tous ces moralistes démocrates ? Les idéologues des couches moyennes tombées, ou qui craignent de tomber, entre deux feux. Les prophètes de ce genre sont surtout caractérisés par leur éloignement des grands mouvements de l’histoire, par le conservatisme rétrograde de leur pensée, par le contentement de leur médiocrité et par la pusillanimité politique la plus primitive. Les moralistes souhaitent par-dessus tout que l’histoire les laisse en paix avec leurs bouquins, leurs petites revues, leurs abonnés, leur bon sens et leurs règles. Mais l’histoire ne les laisse pas en paix. Tantôt de gauche, tantôt de droite, elle leur bourre les côtes. Evidemment : révolution et réaction, tsarisme et bolchevisme, stalinisme et trotskysme sont frères jumeaux ! Que celui qui en doute veuille bien palper, sur les crânes des moralistes, les bosses symétriques de droite et de gauche...
Amoralisme marxiste et vérités éternelles
Le reproche le plus commun et le plus impressionnant que l’on adresse à l’« amoralisme » bolchevik emprunte sa force à la prétendue règle jésuitique du bolchevisme : La fin justifie les moyens. De là, aisément, la conclusion suivante : les trotskistes, comme tous les bolcheviks (ou marxistes), n’admettant pas les principes de la morale, il n’y a pas de différence essentielle entre trotskysme et stalinisme. Ce qu’il fallait démontrer.
Un hebdomadaire américain, passablement vulgaire et cynique par ailleurs, a ouvert sur la morale du bolchevisme une petite enquête destinée, selon l’usage, à servir à la fois la morale et la publicité. L’inimitable Herbert Wells, dont l’homérique suffisance dépassa toujours l’imagination extraordinaire, s’est empressé de se solidariser avec les snobs réactionnaires de « Common Sense ». C’est dans l’ordre des choses. Mais ceux-là mêmes qui ont répondu à l’enquête en prenant la défense du bolchevisme ne l’ont pas fait sans de timides réserves. Les principes marxistes sont, bien sûr, mauvais, mais on trouve néanmoins parmi les bolcheviks des hommes excellents (Eastman). En vérité, il est des « amis » plus dangereux que les ennemis.
Si nous voulions prendre MM. nos censeurs au sérieux, nous devrions tout d’abord leur demander quels sont leurs propres principes de morale. Question qui resterait sans doute sans réponse... Admettons que ni la fin personnelle ni la fin sociale ne puissent justifier les moyens. Il faudrait alors chercher d’autres critériums en dehors de la société telle que l’histoire la fait et des fins suscitées par son développement. Où ? Au ciel si ce n’est sur la terre. Les prêtres ont depuis longtemps découvert dans la révélation divine les canons infaillibles de la morale. Les petits prêtres laïcs traitent des vérités éternelles de la morale sans indiquer leur référence première. Nous sommes en droit de conclure que si ces vérités sont éternelles, elles sont antérieures à l’apparition du pithécanthrope sur la terre et même à la formation du système solaire. Mais d’où viennent-elles donc ? La théorie de la morale éternelle ne peut pas se passer de Dieu.
Les moralistes du type anglo-saxon, dans la mesure où ils ne se contentent pas d’un utilitarisme rationaliste – de l’éthique du comptable bourgeois – se présentent comme les disciples conscients ou inconscients du vicomte de Shaftesbury qui – au début du XVIIIe siècle – déduisait les jugements moraux d’un sens particulier, le sens moral inné à l’homme. Située au-dessus des classes, la morale conduit inévitablement à l’admission d’une substance particulière, d’un sens moral absolu qui n’est que le timide pseudonyme philosophique de Dieu. La morale indépendante des « fins », c’est-à-dire de la société – qu’on la déduise des vérités éternelles ou de la « nature humaine » – n’est au bout du compte qu’un aspect de la « théologie naturelle ». Les cieux demeurent la seule position fortifiée d’où l’on puisse combattre le matérialisme dialectique.
Toute une école « marxiste » se forma en Russie à la fin du siècle dernier, qui entendait compléter la doctrine de Marx en lui ajoutant un principe moral autonome, supérieur aux classes (Strouve, Berdiaeff, Boulgakov et autres...). Ses tenants commençaient naturellement par Kant et son impératif catégorique. Comment finirent-ils ? Strouve est aujourd’hui un ancien ministre du baron de Wrangel et un bon fils de l’Eglise ; Boulgakov est prêtre orthodoxe ; Berdiaeff interprète en plusieurs langues l’Apocalypse. Des métamorphoses aussi inattendues à première vue ne s’expliquent pas par « l’âme slave » – l’âme de Strouve étant du reste germanique – mais par l’envergure de la lutte sociale en Russie. L’orientation essentielle de cette métamorphose est en réalité internationale.
L’idéalisme classique en philosophie, dans la mesure où il tendait à séculariser la morale, c’est-à-dire à l’émanciper de la sanction religieuse, fut un immense progrès (Hegel). Mais, détachée des cieux, la morale avait besoin de racines terrestres. La découverte de ces racines fut l’une des tâches du matérialisme. Après Shaftesbury, il y eut Darwin, après Hegel, Marx. Invoquer de nos jours les « vérités éternelles » de la morale, c’est tenter de faire rétrograder la pensée. L’idéalisme philosophique n’est qu’une étape : de la religion au matérialisme ou, au contraire, du matérialisme à la religion.
« La fin justifie les moyens »
L’ordre des Jésuites, fondé dans la première moitié du XVIe siècle pour combattre le protestantisme, n’enseigna jamais que « tout » moyen, fut-il criminel du point de vue de la morale catholique, est admissible pourvu qu’il mène au but, c’est-à-dire au triomphe du catholicisme. Cette doctrine contradictoire et psychologiquement inconcevable fut malignement attribuée aux Jésuites par leurs adversaires protestants – et parfois catholiques – qui, eux, ne s’embarrassaient pas du choix des moyens pour atteindre « leurs » fins. Les théologiens jésuites, préoccupés, comme ceux des autres écoles, par le problème du libre arbitre, enseignaient en réalité qu’un moyen peut être indifférent par lui-même, mais que la justification ou la condamnation d’un moyen donné est commandée par la fin. Un coup de feu est par lui-même indifférent ; tiré sur le chien enragé qui menace un enfant, c’est une bonne action ; tiré pour tuer ou faire violence, c’est un crime. Les théologiens de l’ordre ne voulaient rien dire de plus que ces lieux communs. Quant à leur morale pratique, les Jésuites formaient une organisation militante, fermée, rigoureusement centralisée, offensive, dangereuse non seulement pour ses ennemis, mais encore pour ses alliés. Par leur psychologie et leurs méthodes d’action, les Jésuites de l’époque « héroïque » se distinguaient du curé ordinaire comme les guerriers de l’Eglise se distinguent de ses boutiquiers. Nous n’avons pas de raison d’idéaliser les uns ou les autres. Mais il serait tout à fait indigne de considérer le guerrier fanatique avec les yeux du boutiquier stupide et paresseux.
Demeurant dans le domaine des comparaisons purement formelles ou psychologiques, on peut dire que les bolcheviks sont aux démocrates et aux sociaux-démocrates de toutes nuances ce que les Jésuites étaient à la paisible hiérarchie ecclésiastique. A côté des marxistes révolutionnaires, les sociaux-démocrates et les socialistes centristes paraissent des arriérés ou, comparés aux médecins, des rebouteux. Pas une question qu’ils n’aient scrutée à fond ; ils croient à la puissance des exorcismes et tournent craintivement les difficultés en attendant le miracle. Les opportunistes sont les paisibles boutiquiers de l’idée socialiste tandis que les bolcheviks en sont les militants convaincus. De là la haine qu’on leur porte et la calomnie dont les abreuvent les hommes qui ont à profusion les mêmes défauts qu’eux – conditionnés par l’histoire – sans avoir une seule de leurs qualités.
La comparaison des Jésuites et des bolcheviks reste pourtant fort unilatérale et superficielle ; elle appartient plutôt à la littérature qu’à l’histoire. Selon les caractères et les intérêts des classes qui les appuyaient, les Jésuites représentaient la réaction, les protestants le progrès. Les limites de ce progrès s’exprimaient à leur tour, immédiatement, dans la parole protestante. La doctrine du Christ, rendue « à sa pureté », n’empêcha nullement le bourgeois Luther d’exciter à l’extermination des paysans révoltés, ces « chiens enragés ». Le docteur Martin considérait visiblement que « la fin justifie les moyens » avant que cette règle n’eût été attribuée aux Jésuites. De leur côté, les Jésuites, rivalisant avec les protestants, s’adaptèrent de plus en plus à l’esprit de la société bourgeoise et ne conservèrent des trois vœux – de pauvreté, de chasteté et d’obéissance – que le dernier, sous une forme d’ailleurs bien atténuée. Du point de vue de l’idéal chrétien, la morale des Jésuites tomba d’autant plus bas qu’ils cessèrent d’être des Jésuites. Les guerriers de l’Eglise devinrent ses bureaucrates et, comme tous les bureaucrates, de fieffés coquins.
Jésuitisme et utilitarisme
Ces courtes remarques suffisent, semble-t-il, à faire ressortir ce qu’il faut d’ignorance et de médiocrité pour prendre au sérieux l’opposition au principe « jésuitique » : « la fin justifie les moyens » – D’un autre, inspiré d’une morale plus élevée, évidemment, selon lequel chaque « moyen » porte sa petite étiquette morale, de même que dans les magasins, les marchandises vendues à prix fixe. Il est frappant que le bon sens du philistin anglo-saxon réussisse à s’indigner du principe « jésuitique » tout en s’inspirant de l’utilitarisme, si caractéristique de la philosophie britannique. Or, le critérium de Bentham et de John Mill, « le plus grand bonheur possible du plus grand nombre » (« the greatest possible happiness of the greatest possible number »), signifie bien : les moyens qui servent au bien commun, fin suprême, sont moraux. De sorte que la formule philosophique de l’utilitarisme anglo-saxon coïncide tout à fait avec le principe « jésuitique » : que la fin justifie les moyens. L’empirisme, nous le voyons, existe ici-bas pour dégager les gens de la nécessité de joindre les deux bouts d’un raisonnement.
Herbert Spencer, dont l’empirisme avait bénéficié du vaccin évolutionniste de Darwin tout comme on se vaccine contre la variole, enseignait que l’évolution de la morale part des « sensations » et aboutit aux « idées ». Les sensations imposent le critérium « d’une satisfaction future plus durable et plus élevée ». Le critérium moral est ici encore celui du « plaisir » ou du « bonheur » ; mais le contenu en est élargi et approfondi avec le degré d’évolutions. Herbert Spencer montre de la sorte, par les méthodes de son utilitarisme « évolutionniste », que le principe : « la fin justifie les moyens » n’a rien d’immoral.
Il serait cependant naïf d’attendre de ce principe des lumières sur la question pratique suivante : que peut-on et que ne peut-on pas faire ? La fin qui justifie les moyens suscite d’ailleurs la question : et qu’est-ce qui justifie la fin ? Dans la vie pratique comme dans le mouvement de l’histoire, la fin et les moyens changent sans cesse de place. La machine en construction est la « fin » de la production pour ensuite devenir, installée dans l’usine, un « moyen » de production. La démocratie est à certaines époques la « fin » poursuivie dans la lutte des classes dont elle devient ensuite le « moyen ». Sans avoir rien d’immoral, le principe attribué aux Jésuites ne résout pas le problème moral.
L’utilitarisme « évolutionniste » de Spencer nous laisse aussi sans réponse, à mi-chemin, car il tente, après Darwin, de résorber la morale concrète, historique, dans les besoins biologiques ou les « instincts sociaux » propres à la vie animale grégaire, alors que la notion même de morale surgit dans un milieu divisé par des antagonismes sociaux, c’est-à-dire dans la société divisée en classes.
L’évolutionnisme bourgeois s’arrête, frappé d’impuissance, sur le seuil de la société historique, ne voulant pas admettre que la lutte des classes soit le ressort principal de l’évolution des formes sociales. La morale n’est qu’une des fonctions idéologiques de cette lutte. La classe dominante impose ses fins à la société et l’accoutume à considérer comme immoraux les moyens qui vont à l’encontre de ces fins. Telle est la mission essentielle de la morale officielle. Elle poursuit « le plus grand bonheur possible », non du plus grand nombre, mais d’une minorité sans cesse décroissante. Un semblable régime, fondé sur la seule contrainte, ne durerait pas une semaine. Le ciment de l’éthique lui est indispensable. La fabrication de ce ciment incombe aux théoriciens et aux moralistes petits-bourgeois. Ils peuvent faire jouer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ; ils ne sont, tout compte fait, que les apôtres de l’esclavage et de la soumission.
Des « règles obligatoires de la morale »
L’homme qui ne veut ni retourner à Moïse, au Christ ou à Mahomet, ni se contenter d’un arlequin éclectique doit reconnaître que la morale est le produit du développement social ; qu’elle n’a rien d’invariable ; qu’elle sert les intérêts de la société ; que ces intérêts sont contradictoires ; que la morale a, plus que toute autre forme d’idéologie, un caractère de classe.
N’y a-t-il pas pourtant des règles élémentaires de morale élaborées par le développement de l’humanité tout entière et nécessaires à la vie de toute collectivité ? Il y en a, certes, mais leur efficience est très instable et limitée. Les normes « impératives pour tous » sont d’autant moins efficientes que la lutte des classes devient plus âpre. La guerre civile, forme culminante de la lutte des classes, abolit violemment tous les liens moraux entre les classes ennemies.
Placé dans des conditions « normales », l’homme « normal » observe le commandement : « Tu ne tueras point ! » Mais s’il tue dans les circonstances exceptionnelles de la légitime défense, le jury l’acquitte. Si, au contraire, il tombe victime d’une agression, l’agresseur sera tué par décision de justice. La nécessité d’une justice et de la légitime défense découle de l’antagonisme des intérêts. Pour ce qui est de l’état, il se contente en temps de paix de légaliser les exécutions d’individus pour, en temps de guerre, transformer le « Tu ne tueras point » en un commandement diamétralement opposé. Les gouvernements les plus humains qui « détestent » la guerre en temps de paix font, en temps de guerre, de l’extermination d’une partie aussi grande que possible de l’humanité, le devoir de leurs armées.
Les règles « généralement reconnues » de la morale gardent le caractère algébrique, c’est-à-dire indéfini, qui leur est propre. Elles expriment seulement le fait que l’homme, dans son comportement individuel, est lié par certaines normes générales, puisqu’il appartient à la société. L’» impératif catégorique » de Kant est la plus haute généralisation de ces normes. Mais en dépit de la situation éminente que cet impératif occupe dans l’Olympe philosophique, il n’a rien, absolument rien de catégorique, n’ayant rien de concret. C’est une forme sans contenu.
La cause du vide des formes obligatoires pour tous c’est que, dans toutes les circonstances importantes, les hommes ont un sentiment beaucoup plus immédiat et plus profond de leur appartenance à une classe sociale qu’à la « société ». Les normes de morale « obligatoire pour tous » reçoivent en réalité un contenu de classe, en d’autres termes, antagonique. La norme morale est d’autant plus catégorique qu’elle est moins « obligatoire pour tous ». La solidarité ouvrière, surtout dans les grèves ou derrière les barricades, est infiniment plus catégorique que la solidarité humaine en général.
La bourgeoisie, dont la conscience de classe est très supérieure, par sa plénitude et son intransigeance, à celle du prolétariat, a un intérêt vital à imposer « sa » morale aux classes exploitées. Les normes concrètes du catéchisme bourgeois sont camouflées à l’aide d’abstractions morales placées elles-mêmes sous l’égide de la religion, de la philosophie ou de cette chose hybride qu’on appelle le « bon sens ». L’invocation des normes abstraites n’est pas une erreur désintéressée de la philosophie, mais un élément nécessaire du mécanisme de la lutte des classes. Faire ressortir cette duperie, dont la tradition remonte à des millénaires, est le premier devoir du révolutionnaire prolétarien.
La crise de la morale démocratique
Pour assurer le triomphe de leurs intérêts dans les grandes questions, les classes dominantes se voient obligées de céder quelque chose sur les questions secondaires – tant que, bien entendu, ces concessions demeurent avantageuses. Au temps de l’essor du capitalisme et surtout dans les dernières décades de l’avant-guerre, ces concessions, tout au moins à l’égard des couches supérieures du prolétariat, furent tout à fait réelles. L’industrie était en plein développement. Le bien-être des nations civilisées – et particulièrement de leurs masses ouvrières – s’accroissait. La démocratie paraissait inébranlable. Les organisations ouvrières grandissaient : les tendances réformistes aussi. Les rapports entre les classes s’adoucissaient, en tout cas extérieurement. Ainsi s’établissaient, dans les relations sociales, à côté des normes de la démocratie et des habitudes de paix sociale, des règles élémentaires de morale. On avait l’impression de vivre dans une société en train de devenir de plus en plus libre, juste et humaine. Le « bon sens » tenait pour infinie la courbe ascendante du progrès.
Elle ne l’était pas ; la guerre éclata, suivie de bouleversements, de crises, de catastrophes, d’épidémies, de retours à la barbarie. La vie économique de l’humanité se trouva dans une impasse. Les antagonismes de classes s’aggravèrent et se démasquèrent. L’un après l’autre, on vit sauter les mécanismes de sûreté de la démocratie. Les règles élémentaires de la morale se révélèrent plus fragiles encore que les institutions démocratiques et les illusions du réformisme. Le mensonge, la calomnie, la corruption, la violence, le meurtre prirent des proportions inouïes. Les esprits simples, confondus, crurent qu’il s’agissait là des conséquences momentanées de la guerre. Ces désagréments étaient et demeurent en réalité les manifestations du déclin de l’impérialisme [Le mot « impérialisme » est pris ici dans son acception marxiste : il désigne le capitalisme des monopoles, caractérisé par l’exportation des capitaux et le partage du monde. Voir Lénine, L’impérialisme, dernière phase du capitalisme. (Note de Victor Serge.)]. La gangrène du capitalisme entraîne celle de la société moderne, droit et morale compris.
Le fascisme, né de la banqueroute de la démocratie en présence des tâches assignées par l’impérialisme, est une « synthèse » des pires maux de cette époque. Des restes de démocratie ne se maintiennent que dans les aristocraties capitalistes les plus riches : pour chaque « démocrate » anglais, français, hollandais, belge, travaille un certain nombre d’esclaves coloniaux ; « soixante familles » gouvernent la démocratie aux Etats-Unis... Et les éléments du fascisme croissent rapidement dans toutes les démocraties. Le stalinisme est à son tour le produit de la pression de l’impérialisme sur un Etat ouvrier arriéré et isolé ; il complète ainsi, en quelque sorte symétriquement, le fascisme.
Tandis que les philistins idéalistes – et les anarchistes en premier lieu, naturellement – dénoncent sans se lasser l’» amoralité » marxiste, les trusts américains dépensent, d’après John Lewis, plus de quatre-vingt millions de dollars par an à combattre la « démoralisation » révolutionnaire, c’est-à-dire en frais d’espionnage, de corruption d’ouvriers, d’impostures judiciaires et d’assassinats ! L’impératif catégorique suit parfois, vers son triomphe, des voies bien sinueuses !
Notons, par souci d’équité, que les plus sincères et aussi les plus bornés des moralistes petits-bourgeois vivent aujourd’hui encore du souvenir idéalisé d’hier et de l’espérance d’un retour à cet hier. Ils ne comprennent pas que la morale est fonction de la lutte des classes ; que la morale démocratique répondait aux besoins du capitalisme libéral et progressiste ; que la lutte des classes acharnée qui domine la nouvelle époque a définitivement, irrévocablement détruit cette morale ; que la morale du fascisme d’une part, et de l’autre celle de la révolution prolétarienne, s’y substituent en deux sens opposés.
Le « Bon sens »
La démocratie et la morale « généralement admise » ne sont pas les seules victimes de l’impérialisme. Le bon sens « inné à tous les hommes » est sa troisième victime. Cette forme inférieure de l’intellect, nécessaire dans toutes les conditions, est aussi suffisante dans certaines conditions. Le capital principal du bon sens est fait de conclusions élémentaires tirées de l’expérience humaine : ne mettez pas vos doigts dans le feu, suivez de préférence la ligne droite, ne taquinez pas les chiens méchants... et cætera, et cætera. Dans un milieu social stable, le bon sens se révèle suffisant pour faire du commerce, soigner des malades, écrire des articles, diriger un syndicat, voter au parlement, fonder une famille, croître et multiplier. Mais sitôt qu’il tente de sortir de ses limites naturelles pour intervenir sur le terrain des généralisations plus complexes, il n’est plus que le conglomérat des préjugés d’une certaine classe à une certaine époque. La simple crise du capitalisme le décontenance ; devant les catastrophes telles que les révolutions, les contre-révolutions et les guerres, le bon sens n’est plus qu’un imbécile tout rond. Il faut, pour connaître les troubles « catastrophiques » du cours « normal » des choses de plus hautes qualités intellectuelles, dont l’expression philosophique n’a été donnée jusqu’ici que par le matérialisme dialectique.
Max Eastman, qui s’efforce avec succès de donner au « bon sens » l’apparence littéraire la plus séduisante, s’est fait de la lutte contre la dialectique matérialiste une sorte de profession. Les truismes conservateurs du bon sens unis au bon style d’Eastman passent pour former la « science de la révolution ». Venant à la rescousse des snobs réactionnaires du « Common Sense », Max Eastman enseigne avec une inimitable assurance que si Trotsky, au lieu de s’inspirer de la doctrine marxiste, s’était inspiré du bon sens, il... n’eût pas perdu le pouvoir. La dialectique intérieure qui s’est jusqu’ici manifestée dans la succession des phases de toutes les révolutions n’existe pas pour Eastman. Il tient que la réaction succède à la révolution parce que l’on ne respecte pas assez le bon sens. Eastman ne comprend pas que Staline s’est précisément trouvé, dans l’histoire, la « victime » du bon sens, car le pouvoir dont il dispose sert à des fins hostiles au bolchevisme. Au contraire, la doctrine marxiste nous a permis de rompre avec la bureaucratie thermidorienne et de continuer à servir le socialisme international.
Toute science – et ceci vaut pour la « science de la révolution » [Max Eastman est l’auteur d’un ouvrage intitulé : La science de la Révolution.] – est sujette à la vérification expérimentale. Eastman, qui sait comment l’on garde le pouvoir révolutionnaire quand la contre-révolution l’emporte dans le monde entier, doit bien savoir comment l’on peut conquérir le pouvoir. On souhaite qu’il consente enfin à livrer ses secrets. Le mieux serait qu’il le fît en nous donnant le programme d’un parti révolutionnaire sous ce titre : « Comment conquérir et garder le pouvoir ? » Mais nous craignons que le bon sens, précisément, n’empêche Eastman de se lancer dans une entreprise aussi risquée. Et cette fois, le bon sens aura raison.
La doctrine marxiste qu’Eastman ne comprit, hélas ! jamais, nous a permis de prévoir le Thermidor soviétique, inéluctable dans certaines conditions données par l’histoire, et toute sa suite de crimes. Le marxisme avait annoncé longtemps à l’avance l’inévitable effondrement de la démocratie bourgeoise et de sa morale. En revanche, les doctrinaires du « bon sens » ont été surpris par le fascisme et par le stalinisme. Le bon sens procède au moyen de grandeurs invariables dans un monde où il n’y a d’invariable que la variabilité. La dialectique, au contraire, considère les phénomènes, les institutions, les normes dans leur formation, leur développement et leur déclin. L’attitude dialectique envers la morale, produit fonctionnel et transitoire de la lutte des classes, parait « amorale » aux yeux du bon sens. Il n’y a pourtant rien de plus dur, de plus borné, de plus suffisant et cynique que la morale du bon sens !
Les moralistes et le Guépéou
Le prétexte à la croisade contre l’« amoralisme » bolchevik a été fourni par les procès de Moscou. La croisade n’a pas, toutefois, commencé sur l’heure. Car les moralistes étaient pour la plupart des amis du Kremlin. Comme tels, ils s’efforcèrent pendant un long moment de dissimuler leur stupeur et même de feindre que rien ne s’était passé.
Les procès de Moscou ne résultent cependant pas du hasard. La servilité, l’hypocrisie, le culte officiel du mensonge, l’achat des consciences et toutes les autres formes de la corruption s’épanouissaient richement à Moscou depuis 1924-1925. Les futures impostures judiciaires se préparaient au grand jour. Les avertissements ne manquèrent pas. Les « amis » ne voulaient rien remarquer. Et ce n’est pas étonnant : la plupart de ces messieurs avaient été foncièrement hostiles à la révolution d’Octobre et ne s’étaient rapprochés de l’Union soviétique qu’au fur et à mesure de la dégénérescence thermidorienne de celle-ci : la petite-bourgeoisie occidentale reconnut alors chez la petite-bourgeoisie orientale une âme sœur.
Ces hommes crurent-ils sincèrement aux accusations de Moscou ? N’y crurent que les plus inintelligents. Les autres ne voulurent pas se donner le mal d’une vérification. Etait-ce la peine de troubler l’amitié flatteuse, confortable et souvent profitable qu’ils entretenaient avec les ambassades soviétiques ? D’ailleurs – ils ne l’oublient pas –, l’imprudente vérité pouvait nuire au prestige de l’U.R.S.S. Ces hommes couvrirent le crime pour des raisons utilitaires, appliquant ainsi manifestement la règle : que la fin justifie les moyens.
M. Pritt, conseiller de S.M. britannique, qui avait eu l’occasion de jeter à Moscou un opportun coup d’œil sous la tunique de Thémis-stalinienne et avait trouvé ses dessous en bon ordre, M. Pritt prit sur lui de braver la honte. Romain Rolland, dont les comptables des Editions soviétiques apprécient fort l’autorité morale, s’empressa de publier un de ses manifestes dont lesquels le lyrisme mélancolique s’unit à un cynisme sénile. La Ligue française des Droits de l’Homme qui condamnait en 1917 l’« amoralisme » de Lénine et de Trotsky – quand nous rompions l’alliance militaire avec la France – se hâta de couvrir en 1936 les crimes de Staline, dans l’intérêt du pacte franco-soviétique.
On voit que la fin patriotique justifie tous les moyens. Aux Etats-Unis, « The Nation » et « The New Republic » fermèrent les yeux sur les exploits de Yagoda, l’» amitié » avec l’U.R.S.S. étant devenue le gage de leur propre autorité. Il y a seulement un an, ces messieurs ne disaient pas encore que le stalinisme et le trotskysme sont identiques. Ils étaient ouvertement avec Staline, pour son esprit réaliste, pour sa justice, pour son Yagoda. Ils maintinrent cette attitude aussi longtemps qu’ils le purent.
Jusqu’à l’exécution de Toukhatchevski, de Iakir et des autres généraux rouges, la grande bourgeoisie des pays démocratiques observa non sans satisfaction, quoiqu’en affectant une certaine répugnance, l’extermination des révolutionnaires en U.R.S.S. A cet égard, « The Nation » et « The New Republic », pour ne point parler des Duranty, Louis Fisher et autres plumes prostituées, allaient bien au-devant des intérêts de l’impérialisme « démocratique ». L’exécution des généraux troubla la bourgeoisie en l’obligeant à comprendre que la décomposition avancée du régime pouvait faciliter la tâche à Hitler, à Mussolini, au Mikado. Le « New York Times » se mit à rectifier prudemment mais opiniâtrement le tir de son Duranty. « Le Temps » laissa filtrer dans ses colonnes une faible lueur sur la situation réelle en U.R.S.S.. Quant aux moralistes et aux sycophantes petits-bourgeois, ils ne furent jamais que les auxiliaires des classes capitalistes. Enfin, lorsque la commission John Dewey [La Commission John Dewey, composée de personnalités éminentes appartenant à la société intellectuelle des Etats-Unis, étudia longuement les données des procès de Moscou, entendit Trotsky, consulta ses archives, et conclut formellement à l’innocence des deux principaux accusés, Trotsky et son fils Léon Sédov. (Note de Victor Serge.)] eut formulé sa sentence, il devint évident aux yeux de tout homme tant soit peu pensant que défendre encore en plein jour le Guépéou c’était risquer une mort politique et morale. A partir de ce moment, les « amis » résolurent d’invoquer les vérités éternelles de la morale, bref de se replier sur leurs tranchées de deuxième ligne.
Les staliniens et demi-staliniens effrayés n’occupent pas la dernière place parmi les moralistes. M. H. Lyons fit bon ménage pendant plusieurs années avec la bande thermidorienne de Moscou et se considéra lui-même comme un presque-bolchevik. S’étant brouillé avec le Kremlin – et il nous importe peu de savoir pourquoi – il se retrouva aussitôt sur les nuages de l’idéalisme. Liston Hook, naguère encore, jouissait d’un tel crédit auprès du Komintern qu’il fut chargé de diriger la propagande républicaine de langue anglaise pour l’Espagne. Ce qui ne l’empêcha pas, lorsqu’il eut démissionné, d’abjurer les premiers rudiments du marxisme. Walter Krivitsky, s’étant refusé à revenir en U.R.S.S. et ayant rompu avec le Guépéou, passa tout de suite à la démocratie bourgeoise. La métamorphose du septuagénaire Charles Rappoport parait analogue. Leur stalinisme jeté par-dessus bord, les gens de cette sorte – ils sont nombreux – ne peuvent manquer de chercher dans les arguments de la morale abstraite une compensation pour leur déception ou leur avilissement idéologique. Demandez-leur pourquoi ils ont passé du Komintern et du Guépéou à la bourgeoisie ? Leur réponse est prête : « Le trotskysme ne vaut pas mieux que le stalinisme. »
Disposition des figures du jeu politique
« Le trotskysme est romantisme révolutionnaire, le stalinisme politique réaliste. » Il ne reste pas trace de cette plate antinomie qui servait, hier encore, au philistin moyen, à justifier son amitié avec Thermidor contre la révolution. On n’oppose plus le trotskysme et le stalinisme, on les identifie. Dans la forme et non dans l’essence. Battant en retraite jusqu’au méridien de l’« impératif catégorique », les démocrates continuent en réalité à défendre le Guépéou, mais mieux masqués, plus traîtreusement. Qui calomnie les victimes collabore avec le bourreau. En ce cas comme en d’autres, la morale sert à la politique.
Le philistin démocratique et le bureaucrate stalinien sont sinon des jumeaux du moins des frères spirituels. En politique, ils sont en tout cas du même bord. Le système gouvernemental de la France est aujourd’hui fondé sur la collaboration des staliniens, des socialistes et des libéraux ; de même en Espagne, où les anarchistes s’y sont joints. Si l’Independent Labour Party a si pauvre apparence c’est que, des années durant, il n’est pas sorti des embrassades du Komintern. Le parti socialiste français a exclu les trotskistes au moment précis où il se préparait à l’unité organique avec les staliniens. Et si cette unité ne s’est pas réalisée, ce n’est pas à cause de divergences de principes – qu’en est-il resté ? – mais parce que les arrivistes socialistes ont eu peur pour leurs emplois.
Revenu d’Espagne, Norman Thomas a déclaré que les trotskistes aidaient « objectivement » Franco ; et grâce à cette absurdité, Norman Thomas lui-même a fourni une aide objective aux bourreaux du Guépéou. Cet apôtre excluait les trotskistes de son parti au moment précis où le Guépéou fusillait leurs camarades en U.R.S.S. et en Espagne. En bien des pays démocratiques, les staliniens pénètrent en dépit de leur « amoralisme », avec succès, dans les services de l’état. Dans les syndicats, ils font ménage excellent avec les bureaucrates de toutes les autres nuances. Les staliniens, il est vrai, traitent avec légèreté le code pénal, ce qui effraie un peu, dans les temps paisibles, leurs amis « démocrates » ; par contre, en des circonstances exceptionnelles, ils n’en deviennent que plus sûrement les chefs de la petite-bourgeoisie qu’ils mènent à la lutte contre le prolétariat : on l’a vu en Espagne.
La Deuxième Internationale et la F.S.I. d’Amsterdam n’ont naturellement pas assumé la responsabilité des faux – préférant la laisser au Komintern. Elles se sont tues. Dans les entretiens privés, leurs personnalités expliquaient qu’au point de vue moral elles condamnaient Staline, mais qu’au point de vue politique, elles l’approuvaient. Ce ne fut que lorsque le Front populaire français eut révélé d’irréparables lézardes, quand les socialistes français durent penser au lendemain, que Léon Blum trouva au fond de son encrier les indispensables formules de l’indignation morale.
Otto Bauer ne blâme avec modération la justice de Vychinski que pour soutenir avec plus d’» impartialité » la politique de Staline. La destinée du socialisme, d’après une récente déclaration de Bauer, serait liée à celle de l’U.R.S.S. « Et la destinée de l’U.R.S.S. est celle du stalinisme tant que (!) le développement intérieur de l’U.R.S.S. elle-même n’aura pas surmonté la phase stalinienne... » Tout Bauer, tout l’austro-marxisme, tout le mensonge, toute la pourriture de la social-démocratie sont dans cette phrase magnifique ! « Tant que » la bureaucratie stalinienne est assez forte pour exterminer les représentants avancés du « développement intérieur » de l’U.R.S.S., Bauer reste avec Staline. Quand les forces révolutionnaires renverseront Staline, malgré Bauer, Bauer reconnaîtra généreusement – avec une dizaine d’années de retard tout au plus – ce « développement intérieur » !
Le Bureau de Londres des socialistes centristes, réunissant avec bonheur les aspects d’un jardin d’enfants, d’une école pour adolescents arriérés et d’une maison d’invalides, se traîne à la remorque des vieilles Internationales. Son secrétaire, Fermer Brockway, commença par déclarer que l’enquête sur les procès de Moscou pourrait « nuire à l’U.R.S.S. » et par contre proposer d’ouvrir plutôt une enquête sur... l’activité de Trotsky, en constituant une commission « impartiale » dans laquelle fussent entrés cinq adversaires irréconciliables de Trotsky... Brandler et Lovestone se solidarisèrent publiquement avec Yagoda ; ils ne reculèrent que devant Ejov ; Jacob Walcher refusa, sous un prétexte manifestement faux, de donner à la commission John Dewey un témoignage qui ne pouvait qu’être défavorable à Staline. La morale pourrie de ces hommes n’est que le produit de leur politique pourrie.
Mais le plus triste rôle revient sans doute aux anarchistes. Si le stalinisme et le trotskysme sont identiques, comme ils l’affirment à chaque ligne, pourquoi donc les anarchistes espagnols aident-ils les staliniens à égorger les trotskistes et par la même occasion les anarchistes demeurés révolutionnaires ? Les théoriciens libertaires les plus francs répondent que c’est là le prix des fournitures d’armes soviétiques. Bref, la fin justifie les moyens. Mais quelle est leur fin ? L’anarchie ? Le socialisme ? Non. Le salut de la démocratie bourgeoise qui a frayé la voie au fascisme. A une fin basse correspondent de sales moyens. Telle est la disposition réelle des figures du jeu politique sur l’échiquier du monde.
Que le stalinisme est un produit de la vieille société
La Russie a fait dans l’histoire le bond en avant le plus grandiose : les forces les plus progressistes du pays ont fourni cet effort. Dans la réaction actuelle, dont l’ampleur est proportionnée à celle de la révolution, l’inertie prend sa revanche. Cette réaction, le stalinisme en est devenu l’incarnation. La barbarie de la vieille histoire de Russie, resurgie sur de nouvelles bases sociales, parait plus écœurante encore, car elle doit user d’une hypocrisie telle que l’histoire n’en connut jamais jusqu’ici.
Les libéraux et les sociaux-démocrates d’Occident, que la révolution d’Octobre fit douter de leurs idées surannées, ont senti des forces leur revenir. La gangrène morale de la bureaucratie soviétique leur parait réhabiliter le libéralisme. On les voit sortir de vieux aphorismes éculés de ce genre : « Toute dictature porte en elle-même les germes de sa propre dissolution » ; « la démocratie, seule, assure le développement de la personnalité » et cætera. L’opposition de la démocratie à la dictature, impliquant en l’occurrence la condamnation du socialisme au nom du régime bourgeois, étonne, considérée sous l’angle de la théorie, par l’ignorance et la mauvaise foi dont elle procède.
L’infection du stalinisme, réalité historique, est mise en comparaison avec la démocratie, abstraction supra-historique. La démocratie a pourtant eu une histoire, elle aussi, et dans laquelle les abominations n’ont point manqué. Pour définir la bureaucratie soviétique, nous empruntons à l’histoire de la démocratie bourgeoise les termes de « Thermidor » et « bonapartisme », car – que les doctrinaires attardés du libéralisme en prennent note – la démocratie ne s’est pas établie par des méthodes démocratiques, loin de là. Les cuistres seuls peuvent se contenter des raisonnements sur le bonapartisme « fils légitime » du jacobinisme, châtiment historique des atteintes portées à la démocratie, etc. Sans la destruction de la féodalité par les méthodes jacobines, la démocratie bourgeoise eût été inconcevable. Il est aussi faux d’opposer aux étapes historiques réelles : jacobinisme, thermidor, bonapartisme, l’abstraction « démocratie » que d’opposer aux douleurs de l’enfantement le calme du nouveau-né.
Le stalinisme n’est pas, lui non plus, une « dictature » abstraite, c’est une vaste réaction bureaucratique contre la dictature prolétarienne dans un pays arriéré et isolé. La révolution d’Octobre a aboli les privilèges, déclaré la guerre à l’inégalité sociale, substitué à la bureaucratie le gouvernement des travailleurs par les travailleurs, supprimé la diplomatie secrète ; elle s’est efforcée de donner aux rapports sociaux une transparence complète. Le stalinisme a restauré les formes les plus offensantes du privilège, donné à l’inégalité un caractère provocant, étouffé au moyen de l’absolutisme policier l’activité spontanée des masses, fait de l’administration le monopole de l’oligarchie du Kremlin, rendu la vie au fétichisme du pouvoir sous des aspects dont la monarchie absolue n’eût pas osé rêver.
La réaction sociale, quelle qu’elle soit, est tenue de masquer ses fins véritables. Plus la transition de la révolution à la réaction est brutale, plus la réaction dépend des traditions de la révolution, – en d’autres termes plus elle craint les masses et plus elle est obligée de recourir au mensonge et à l’imposture dans sa lutte contre les tenants de la révolution. Les impostures staliniennes ne sont pas le fruit de l’amoralisme « bolchevik » ; comme tous les événements importants de l’histoire, ce sont les produits d’une lutte sociale concrète et de la plus perfide et cruelle qui soit : celle d’une nouvelle aristocratie contre les masses qui l’ont portée au pouvoir. Il faut, en vérité, une totale indigence intellectuelle et morale pour identifier la morale réactionnaire et policière du stalinisme avec la morale révolutionnaire des bolcheviks. Le parti de Lénine a cessé d’exister depuis longtemps ; les difficultés intérieures et l’impérialisme mondial l’ont brisé. La bureaucratie stalinienne lui a succédé et c’est un appareil de transmission de l’impérialisme. En politique mondiale, la bureaucratie a substitué la collaboration des classes à la lutte des classes, le social-patriotisme à l’internationalisme. Afin d’adapter le parti gouvernant aux besognes de la réaction, la bureaucratie en a « renouvelé » le personnel par l’extermination des révolutionnaires et le recrutement des arrivistes.
Toute réaction ressuscite, nourrit, renforce les éléments du passé historique que la révolution a frappés sans réussir à les anéantir. Les méthodes staliniennes achèvent, portent à la plus haute tension, et aussi à l’absurde, tous les procédés de mensonge, de cruauté et d’avilissement qui constituent le mécanisme du pouvoir dans toute société divisée en classes, sans en exclure la démocratie. Le stalinisme est un conglomérat des monstruosités de l’Etat tel que l’histoire l’a fait ; c’en est aussi la funeste caricature et la répugnante grimace. Quand les représentants de la vieille société opposent sentencieusement à la gangrène du stalinisme une abstraction démocratique stérilisée, nous avons bien le droit de leur recommander, comme à toute la vieille société, de s’admirer eux-mêmes dans le miroir déformant du Thermidor soviétique. Il est vrai que, par la franchise de ses crimes, le Guépéou dépasse de loin tous les autres régimes. C’est par suite de l’ampleur grandiose des événements qui ont bouleversé la Russie dans la démoralisation de l’ère impérialiste.
Morale et Révolution
Il ne manque pas, parmi les libéraux et les radicaux, de gens ayant assimilé les méthodes matérialistes de l’interprétation des événements et qui se considèrent comme marxistes, ce qui ne les empêche pas de demeurer des journalistes, des professeurs ou des hommes politiques bourgeois. Le bolchevik ne se conçoit pas, cela va sans dire, sans méthode matérialiste, en morale comme ailleurs. Mais cette méthode ne lui sert pas seulement à interpréter les événements, elle lui sert aussi à former le parti révolutionnaire du prolétariat, tâche qui ne peut être accomplie que dans une indépendance complète à l’égard de la bourgeoisie et de sa morale. Or l’opinion publique bourgeoise domine en fait, pleinement, le mouvement ouvrier officiel, de William Green aux Etats-Unis à Garcia Oliver en Espagne en passant par Léon Blum et Maurice Thorez en France. Le caractère réactionnaire de la période présente trouve dans ce fait son expression la plus profonde.
Le marxiste révolutionnaire ne saurait aborder sa tâche historique sans avoir rompu moralement avec l’opinion publique de la bourgeoisie et de ses agents au sein du prolétariat. Cette rupture-là exige un courage moral d’un autre calibre que celui des gens qui vont criant dans les réunions publiques : « A bas Hitler, à bas Franco ! » Et c’est justement cette rupture décisive, profondément réfléchie, irrévocable, des bolcheviks avec la morale conservatrice de la grande et aussi de la petite-bourgeoisie, qui cause une frayeur mortelle aux phraseurs de la démocratie, aux prophètes de salons, aux héros de couloirs. De là leurs lamentations sur l’» amoralisme » des bolcheviks.
Leur façon d’identifier la morale bourgeoise avec la morale « en général » se vérifie sans doute le mieux à l’extrême gauche de la petite-bourgeoisie, plus précisément dans les partis centristes du Bureau Socialiste International dit de Londres. Cette organisation « admettant » le programme de la révolution prolétarienne, nos divergences de vues avec elle paraissent à première vue secondaires. A la vérité, son admission du programme révolutionnaire est sans valeur aucune car elle ne l’oblige à rien. Les centristes « admettent » la révolution prolétarienne comme les kantiens l’impératif catégorique, c’est-à-dire comme un principe sacré inapplicable dans la vie quotidienne. En politique pratique, ils s’unissent aux pires ennemis de la révolution, réformistes et staliniens, contre nous. Leur pensée est pénétrée de duplicité et d’hypocrisie. S’ils ne s’élèvent pas, en règle générale, à des crimes saisissants, c’est parce qu’ils demeurent toujours à l’arrière-plan de la politique : ce sont en quelque sorte les pickpockets de l’histoire, et c’est justement pourquoi ils se croient appelés à doter le mouvement ouvrier d’une nouvelle morale.
A l’extrême gauche de cette confrérie « avancée » se situe un petit groupe, politiquement tout à fait insignifiant, d’émigrés allemands, qui publie la revue « Neuer Weg ». Penchons-nous un peu plus bas et prêtons l’oreille aux propos de ces détracteurs « révolutionnaires » de l’amoralisme bolchevik. La « Neuer Weg », adoptant le ton d’un éloge à double sens, écrit que les bolcheviks se distinguent avantageusement des autres partis en ce qu’ils n’ont point d’hypocrisie : ils proclament tout haut ce que les autres font en silence et, par exemple, appliquent ainsi le principe que « la fin justifie les moyens ». De l’avis de la « Neuer Weg », cette règle « bourgeoise » est incompatible avec un « mouvement socialiste sain ». « Le mensonge et pire encore ne sont pas moyens permis dans la lutte, comme le considérait encore Lénine. » « Encore » signifie ici que Lénine n’eut pas le temps de répudier cette erreur puisqu’il mourut avant la découverte de la « nouvelle voie » (« Neuer Weg »). Dans l’expression « le mensonge et pire encore », le second membre de phrase signifie évidemment : la violence, l’assassinat et cætera, car, toutes autres choses étant égales, la violence est pire que le mensonge et l’assassinat est la forme extrême de la violence.
Nous arrivons ainsi à conclure que le mensonge, la violence et l’assassinat sont incompatibles avec « un mouvement socialiste sain ». Mais que faire de la révolution ? La guerre civile est la plus cruelle des guerres. Elle ne se conçoit pas sans violences exercées sur des tiers et, tenant compte de la technique moderne, sans meurtre de vieillards et d’enfants. Devons-nous rappeler l’Espagne ? La seule réponse que pourraient nous faire les « amis » de l’Espagne républicaine, c’est que la guerre civile est préférable à l’esclavage fasciste. Mais cette réponse tout à fait juste signifie seulement que la fin (démocratie ou socialisme) justifie dans certaines circonstances « des moyens » tels que la violence et le meurtre. Point n’est besoin de parler du mensonge ! La guerre est aussi inconcevable sans mensonge que la machine sans graissage. A seule fin de protéger les Cortès contre les bombes fascistes, le gouvernement de Barcelone trompa plusieurs fois sciemment les journalistes et la population. Pouvait-il faire autre chose ? Qui veut la fin (la victoire sur Franco) doit vouloir les moyens (la guerre civile avec son cortège d’horreurs et de crimes).
Et pourtant le mensonge et la violence ne sont-ils pas à condamner en « eux-mêmes » ? Assurément, à condamner en même temps que la société, divisée en classes, qui les engendre. La société sans antagonismes sociaux sera, cela va de soi, sans mensonge et sans violence. Mais on ne peut jeter vers elle un pont que par les méthodes de violence. La révolution est elle-même le produit de la société divisée en classes dont elle porte nécessairement les marques. Du point de vue des « vérités éternelles » la révolution est naturellement « immorale ». Ce qui nous apprend seulement que la morale idéaliste est contre-révolutionnaire, c’est-à-dire au service des exploiteurs. « Mais la guerre civile, – dira peut-être le philosophe, pris de court – est une pénible exception. En temps de paix, un mouvement socialiste sain doit se passer de mensonge et de violence. » Ce n’est que piteuse dérobade. Il n’y a pas de frontières infranchissables entre la pacifique lutte des classes et la révolution. Chaque grève contient en germe tous les éléments de la guerre civile. Les deux partis en présence s’efforcent de se donner mutuellement une idée exagérée de leur degré de résolution et de leurs ressources. Grâce à leur presse, à leurs agents et à leurs mouchards, les capitalistes cherchent à intimider et démoraliser les grévistes. Lorsque la persuasion se révèle inopérante, les piquets de grève sont, de leur côté, réduits à recourir à la force. On voit ainsi que « le mensonge et pire encore » sont inséparables de la lutte des classes dès sa forme embryonnaire. Il reste à ajouter que les notions de vérité et de mensonge sont nées des contradictions sociales.
La Révolution et les otages
Staline fait arrêter et fusiller les enfants de ses adversaires, fusillés eux-mêmes sur des accusations fausses. Les familles lui servent d’otages pour contraindre les diplomates soviétiques, capables d’émettre un doute sur la probité de Yagoda ou de Ejov, à revenir de l’étranger. Les moralistes de la « Neuer Weg » croient devoir rappeler à ce propos que Trotsky usa « lui aussi » en 1919 d’une loi des otages. Mais il faut citer textuellement : « L’arrestation des familles innocentes par Staline est d’une barbarie révoltante. C’est encore une action barbare quand elle est commandée par Trotsky (1919). » Voilà bien la morale idéaliste dans toute sa beauté ! Ses critériums sont aussi mensongers que les normes de la démocratie bourgeoise : on suppose dans les deux cas l’égalité où il n’y a pas l’ombre d’égalité.
N’insistons pas ici sur le fait que le décret de 1919 ne fit très probablement fusiller personne d’entre les parents des officiers dont la trahison nous coûtait des vies sans nombre et menaçait de tuer la révolution. Au fond, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Si la révolution avait fait preuve dès le début de moins d’inutile générosité, des milliers de vies eussent été épargnées par la suite. Quoi qu’il en soit, je porte l’entière responsabilité du décret de 1919. Ce fut une mesure nécessaire dans la lutte contre les oppresseurs. Ce décret, comme toute la guerre civile, que l’on pourrait aussi appeler à juste titre une « révoltante barbarie », n’a d’autre justification que l’objet historique de la lutte.
Laissons à un Emil Ludwig et à ses pareils le soin de nous faire des portraits d’un Abraham Lincoln orné de petites ailes roses. L’importance de Lincoln vient de ce que, pour atteindre le grand but historique assigné par le développement du jeune peuple américain, il ne recula pas devant l’application des mesures les plus rigoureuses quand elles furent nécessaires. La question n’est même pas de savoir lequel des belligérants subit ou infligea les plus lourdes pertes. L’histoire a des mesures différentes pour les cruautés des sudistes et des nordistes dans la guerre de Sécession des Etats-Unis. Que de méprisables eunuques ne viennent pas soutenir que l’esclavagiste qui, par la ruse et la violence, enchaîne un esclave est devant la morale l’égal de l’esclave qui, par la ruse et la violence, brise ses chaînes !
Quand la Commune de Paris eut été noyée dans le sang et que la canaille réactionnaire du monde entier se mit à traîner son drapeau dans la boue, il se trouva de nombreux philistins démocrates pour flétrir, avec la réaction, les Communards qui avaient exécuté 64 otages et parmi eux l’archevêque de Paris. Marx n’hésita pas un instant à prendre la défense de cette sanglante action de la Commune. Dans une circulaire du Conseil Général de l’Internationale, Marx rappelle – et l’on croit entendre des laves bouillonner sous ces lignes – que la bourgeoisie usa du système des otages dans la lutte contre les peuples des colonies et dans la lutte contre son propre peuple. Parlant ensuite des exécutions méthodiques des Communards prisonniers, il écrit : « Il ne restait plus à la Commune, pour défendre la vie de ses combattants prisonniers, qu’à recourir à la prise des otages, coutumière chez les Prussiens. La vie des otages fut perdue et reperdue du fait que les Versaillais continuaient a fusiller leurs prisonniers. Eût-il été possible d’épargner les otages après l’horrible carnage dont les prétoriens de Mac-Mahon marquèrent leur entrée dans Paris ? Le dernier contrepoids à la sauvagerie du gouvernement bourgeois – la prise des otages – allait-il n’être que dérision ? » Tel fut le langage de Marx sur l’exécution des otages, bien qu’il eût derrière lui, au Conseil Général de l’Internationale, bon nombre de Fermer Brockway, de Norman Thomas et autres Otto Bauer. L’indignation du prolétariat mondial, devant les atrocités commises par les Versaillais, était encore si grande que les brouillons réactionnaires préférèrent se taire, en attendant des temps meilleurs pour eux – et ces temps, hélas ! ne tardèrent pas à venir. Les moralistes petits-bourgeois unis aux fonctionnaires de Trade Unions et aux phraseurs anarchistes ne torpillèrent la Première Internationale que lorsque la réaction eut décidément triomphé.
Quand la révolution d’Octobre résistait aux forces réunies de l’impérialisme sur un front de 8 000 kilomètres, les ouvriers de tous les pays suivaient cette lutte avec une sympathie si ardente qu’il eût été risqué de dénoncer devant eux comme une « révoltante barbarie » la prise des otages. Il a fallu la dégénérescence totale de l’Etat soviétique et le triomphe de la réaction en divers pays pour que les moralistes sortissent de leurs trous... et vinssent au secours de Staline. Car, si les mesures de répression prises pour défendre les privilèges de la nouvelle aristocratie ont la même valeur morale que les mesures révolutionnaires prises dans la lutte libératrice, Staline est pleinement justifié, à moins que... à moins que la révolution prolétarienne ne soit condamnée en bloc.
Messieurs les moralistes, tout en cherchant des exemples d’immoralité dans la guerre civile de Russie, sont obligés de fermer les yeux sur le fait que la guerre civile en Espagne a aussi rétabli la loi des otages, dans la période en tout cas où il y eut une véritable révolution des masses. Si les détracteurs ne se sont pas encore permis de condamner la « révoltante barbarie » des ouvriers d’Espagne, c’est seulement parce que le terrain de la péninsule ibérique est trop brûlant sous leurs pieds. Il leur est beaucoup plus commode de revenir à 1919. C’est déjà de l’histoire. Les vieux ont eu le temps d’oublier, les jeunes n’ont pas eu celui d’apprendre. Pour la même raison, les Pharisiens de toutes nuances reviennent avec tant d’opiniâtreté sur Cronstadt et Makhno : les sécrétions morales peuvent ici se donner libre cours !
La morale des Cafres
L’histoire prend des chemins cruels, il faut en convenir avec les moralistes. Mais quelle conclusion tirer de là pour l’activité pratique ? Léon Tolstoï recommandait aux hommes d’être plus simples et meilleurs. Le mahatma Gandhi leur conseilla de boire du lait de chèvre. Hélas ! Les moralistes de la « Neuer Weg » ne sont pas si loin de ces recettes. « Nous devons, prêchent-ils, nous libérer de cette morale de Cafres pour laquelle il n’est de mal que ce que fait l’ennemi... » Admirable conseil. « Nous devons nous libérer... » Tolstoï recommandait aussi de se libérer du péché de la chair. La statistique ne nous révèle pas que sa propagande ait eu du succès. Nos homunculus centristes ont réussi à s’élever jusqu’aux sommets de la morale supérieure aux classes dans une société divisée en classes. Mais voici déjà presque deux mille ans que l’on a dit « Aimez vos ennemis... » Et pourtant le Saint-Père de Rome, lui-même, ne s’est pas libéré de la haine de ses ennemis. Le Diable, ennemi du genre humain, est puissant, en vérité !
Appliquer des critériums différents aux actions des exploités, ce serait, de l’avis des pauvres homunculus, se mettre au niveau de la « morale des Cafres ». Demandons-nous tout d’abord s’il sied à des « socialistes » de professer un tel mépris des Cafres ? La morale des Cafres est-elle vraiment si détestable ? Voilà ce qu’en dit « l’Encyclopédie Britannique » :
« Ils font preuve, dans leurs rapports sociaux et politiques, de beaucoup de tact et d’intelligence ; ils sont extrêmement braves, belliqueux et hospitaliers : ils furent honnêtes et véridiques tant que le contact avec les Blancs ne les eut pas rendus soupçonneux, vindicatifs et voleurs, et qu’ils n’eurent pas en outre assimilé la plupart des vices des Européens. » On ne peut manquer de conclure que les missionnaires blancs, prédicateurs de la morale éternelle, ont contribué à la corruption des Cafres.
Si l’on racontait à un travailleur cafre que les ouvriers, s’étant insurgés quelque part sur la planète, ont surpris leurs oppresseurs, il s’en réjouirait. Il serait au contraire désolé d’apprendre que les oppresseurs ont réussi à tromper les opprimés. Le Cafre, que les missionnaires n’ont pas corrompu jusqu’à la moelle des os, ne consentira jamais à appliquer les mêmes normes de morale abstraite aux oppresseurs et aux opprimés. Il comprendra en revanche fort bien, si on le lui explique, que l’objet de ces normes est précisément d’entraver la révolte des opprimés contre les oppresseurs.
Edifiante coïncidence : les missionnaires de la « Neuer Weg » ont dû, pour calomnier les bolcheviks, calomnier par la même occasion les Cafres ; et dans les deux cas, la calomnie suit le cours du mensonge officiel bourgeois : contre les révolutionnaires et contre les races de couleur. Décidément, nous préférons les Cafres à tous les missionnaires religieux ou laïcs !
Mais ne surestimons pas le degré de conscience des moralistes de la « Neuer Weg » et autres impasses. Leurs intentions ne sont pas si mauvaises. C’est malgré elles qu’ils servent de leviers dans l’engrenage de la réaction. A une époque comme la nôtre, quand les partis petits-bourgeois se cramponnent à la bourgeoisie ou à son ombre (politique des Fronts populaires), paralysent le prolétariat et fraient la voie au fascisme (Espagne, France...), les bolcheviks, c’est-à-dire les marxistes révolutionnaires, deviennent particulièrement odieux à l’opinion publique bourgeoise. La pression politique la plus forte de nos jours s’exerce de droite à gauche. En dernier lieu, tout le poids de la réaction pèse sur les épaules d’une petite minorité révolutionnaire. Cette minorité révolutionnaire s’appelle la Quatrième Internationale. Voilà l’ennemi !
Le stalinisme occupe dans l’engrenage de la réaction bon nombre de positions dominantes. Ainsi ou autrement, tous les groupements de la société bourgeoise, anarchistes compris, recourent à son aide contre la révolution prolétarienne. Pendant ce temps, les démocrates petits-bourgeois tentent de rejeter, au moins dans la mesure de 50 %, l’odieux des crimes de leur allié moscovite sur l’irréductible minorité révolutionnaire. Telle est la signification du dicton désormais à la mode : « Trotskysme et stalinisme sont identiques. » Les adversaires des bolcheviks et des Cafres aident ainsi la réaction à couvrir de calomnie le parti de la révolution.
L’« amoralisme » de Lénine
Les socialistes-révolutionnaires russes furent toujours les hommes les plus moraux ; ils n’étaient au fond que pure éthique. Ce qui ne les empêcha pas de tromper les paysans pendant la révolution. L’un d’entre eux, Zenzinov, écrit dans l’organe parisien de Kérensky – de ce socialiste éthique qui fut le précurseur de Staline dans la fabrication de faux contre les bolcheviks : « Lénine enseigna, comme on sait, que, pour atteindre la fin qu’ils s’assignent, les bolcheviks peuvent et parfois doivent “user de divers stratagèmes, du silence et de la dissimulation de la vérité”... » (Novaya Rossiia, 17 février 1938.)
Par malheur, ce détracteur si moral ne sait même pas produire honnêtement une citation. Lénine a écrit : « Il faut savoir consentir à tout, à tous les sacrifices et même – en cas de nécessité – user de stratagèmes variés, de ruses, de procédés illégaux, du silence, de la dissimulation de la vérité pour pénétrer dans les syndicats, y demeurer, y poursuivre à tout prix l’action communiste. » La nécessité des stratagèmes et des ruses, d’après l’explication de Lénine, découlait du fait que la bureaucratie réformiste, livrant les ouvriers au capital, persécutait les révolutionnaires et en appelait même contre eux à la police bourgeoise. La « ruse » et « la dissimulation de la vérité » ne sont en l’occurrence que les moyens d’une légitime défense contre la perfidie de la bureaucratie réformiste.
Le parti de Zenzinov combattit autrefois, dans l’illégalité, l’ancien régime, puis le bolchevisme. Dans les deux cas, il usa de ruses, de stratagèmes, de faux passeports et d’autres formes de « dissimulation de la vérité ». Tous ces moyens étaient considérés par lui non seulement comme moraux, mais encore comme héroïques parce qu’ils correspondaient aux fins de la démocratie petite-bourgeoise. Mais leur situation change sitôt que les révolutionnaires prolétariens se voient obligés de recourir aux moyens de l’illégalité contre cette démocratie. La clé de l’éthique de ces messieurs est, on le voit, dans leur esprit de classe !
L’« amoraliste » Lénine recommande ouvertement, au grand jour de la presse, d’user de ruses de guerre à l’égard des leaders qui trahissent le mouvement ouvrier. Le moraliste Zenzinov tronque sciemment ce texte, de deux côtés, afin de tromper ses lecteurs. Le détracteur si moral n’est, comme de coutume, qu’un filou sans envergure. Lénine n’avait pas tort de répéter qu’il est terriblement difficile de rencontrer un adversaire de bonne foi !
L’ouvrier qui ne cache pas au capitaliste la « vérité » sur les intentions des grévistes est tout bonnement un traître qui ne mérite que mépris et boycottage. Le soldat qui communique la « vérité » à l’ennemi est puni comme espion. Kérensky lui-même tenta d’accuser frauduleusement les bolcheviks d’avoir communiqué la « vérité » à Ludendorff. Ainsi la « sainte vérité » ne serait pas une fin en soi ? Des critériums impératifs la dominent, qui, l’analyse le démontre, ressortirent de l’esprit de classe.
La lutte à mort ne se conçoit pas sans ruse de guerre, en d’autres termes sans mensonge et tromperie. Les prolétaires allemands peuvent-ils ne point tromper la police de Hitler ? Les bolcheviks soviétiques manqueraient-ils à la morale en trompant le Guépéou ? L’honnête bourgeois applaudit à l’habileté du policier qui réussit à s’emparer par la ruse d’un dangereux gangster. Et la ruse ne serait pas permise quand il s’agit de renverser les gangsters de l’impérialisme ?
Norman Thomas parle de « l’étranger amoralisme communiste qui ne tient compte de rien si ce n’est du parti et de son pouvoir » (« that strange Communist amorality in which nothing matters but the party and its power » – « Socialist Call », 12 mars 1938). Ce faisant, Thomas confond le Komintern actuel, c’est-à-dire le complot de la bureaucratie stalinienne contre la classe ouvrière, avec le parti bolchevik qui incarnait le complot des ouvriers avancés contre la bourgeoisie. Nous avons suffisamment réfuté plus haut cette identification totalement malhonnête. Le stalinisme ne fait que se camoufler au moyen du culte du parti ; en réalité, le parti, il le détruit et le piétine dans la boue. Mais il est vrai que le parti est tout pour le bolchevik. Cette attitude du révolutionnaire envers la révolution étonne et repousse le socialiste de salon qui n’est lui-même qu’un bourgeois pourvu d’idéal » socialiste.
Aux yeux de Norman Thomas et de ses pareils, le parti n’est que l’instrument de combinaisons électorales et autres. La vie privée de l’homme, ses relations, ses intérêts, sa morale sont en dehors du parti. N. Thomas considère avec une aversion mêlée de stupeur le bolchevik pour lequel le parti est l’instrument de la transformation révolutionnaire de la société, morale comprise. Il ne saurait y avoir, chez le révolutionnaire marxiste, de contradiction entre la morale personnelle et les intérêts du parti, car le parti embrasse dans sa conscience les tâches et les fins les plus hautes de l’humanité. Il serait naïf de croire après cela que M. Thomas a sur la morale des notions plus élevées que les marxistes. Il a seulement du parti une idée beaucoup plus basse.
« Tout ce qui naît est digne de périr », dit le dialecticien Hegel. La fin du parti bolchevik – épisode de la réaction mondiale – ne diminue pas l’importance de ce parti dans l’histoire du monde. A l’époque de son ascension révolutionnaire, c’est-à-dire quand il représenta réellement l’avant-garde prolétarienne, ce fut le parti le plus honnête de l’histoire. Quand il l’a pu, il a naturellement trompé les classes ennemies ; puis il a dit la vérité aux travailleurs, toute la vérité, rien que la vérité. Grâce à quoi, uniquement, il a conquis leur confiance comme nul autre parti au monde.
Les commis des classes dirigeantes traitent le bâtisseur de ce parti d’« immoraliste ». Aux yeux des ouvriers conscients, cette accusation lui fait honneur. Elle signifie que Lénine refusait hautement d’admettre les normes de morale établies par les esclavagistes pour les esclaves – et que les esclavagistes n’observèrent jamais eux-mêmes ; elle signifie que Lénine invitait le prolétariat à étendre la lutte des classes au domaine de la morale. Celui qui s’incline devant les règles établies par l’ennemi ne vaincra jamais !
L’« amoralisme » de Lénine, c’est-à-dire son refus d’admettre une morale supérieure aux classes, ne l’empêcha pas de demeurer toute sa vie fidèle au même idéal ; de se donner entièrement à la cause des opprimés ; de se montrer hautement scrupuleux dans la sphère des idées et intrépide dans l’action ; de n’avoir pas la moindre suffisance à l’égard du « simple ouvrier », de la femme sans défense et de l’enfant. Ne semble-t-il pas que l’amoralisme n’est dans ce cas que le synonyme d’une morale humaine plus élevée ?
Un épisode édifiant
Il est sans doute utile de relater ici un épisode qui, bien que de peu d’importance par lui-même, illustre assez bien la différence entre « leur » morale et « la nôtre ». Je développai en 1935 dans des lettres à mes amis belges l’idée qu’un jeune parti révolutionnaire qui tenterait de créer « ses propres » syndicats irait au suicide. Il faut aller trouver les ouvriers où ils sont. Mais c’est cotiser pour l’entretien d’un appareil opportuniste ? Evidemment, répondais-je, le droit de saper les réformistes, il faut le leur payer. Mais les réformistes ne nous permettront pas de faire contre eux un travail de sape ? Evidemment, répondais-je encore, le travail de sape exige quelques précautions conspiratives. Les réformistes forment la police politique de la bourgeoisie au sein de la classe ouvrière. Il faut savoir agir sans leur permission et malgré leurs interdictions... Au cours d’une perquisition faite par hasard chez le camarade D..., à la suite si je ne me trompe d’une affaire de fourniture d’armes à l’Espagne ouvrière, la police belge saisit ma lettre.
Quelques jours plus tard, cette lettre était publiée. La presse de Vandervelde, de Man et Spaak ne ménagea pas ses foudres à mon « machiavélisme » ou « jésuitisme ». Mais quels étaient mes censeurs ? Président de la Deuxième Internationale depuis de longues années, Vandervelde était depuis longtemps devenu l’homme de confiance du capital en Belgique. De Man, après avoir pendant des années employé des tomes massifs à ennoblir le socialisme en le gratifiant d’une morale idéaliste et en se rapprochant à la dérobée de la religion, mit à profit la première occasion pour tromper les ouvriers et devenir un ordinaire ministre de la bourgeoisie.
Pour Spaak, la chose est plus frappante encore. Dix-huit mois auparavant, ce monsieur, appartenant à l’opposition socialiste de gauche, était venu me demander conseil sur les méthodes de lutte à employer contre la bureaucratie de Vandervelde. Je lui avais exposé les idées qui par la suite se retrouvèrent dans ma lettre. Un an plus tard, il renonçait aux épines pour la rose. Trahissant ses amis de l’opposition, il devenait un des ministres les plus cyniques du capital belge. Dans les syndicats et dans leur parti, ces messieurs étouffent toute critique, démoralisent et corrompent systématiquement les travailleurs les plus avancés et excluent tout aussi systématiquement les indociles. Ils ne diffèrent du Guépéou qu’en ce qu’ils procèdent pour le moment sans effusion de sang ; en leur qualité de bons patriotes, ils réservent le sang ouvrier pour la prochaine guerre impérialiste. Et c’est clair : il faut être une émanation de l’enfer, un « Cafre », un bolchevik, pour donner aux ouvriers révolutionnaires le conseil d’observer dans la lutte contre ces messieurs les règles de la conspiration !
Du point de vue de la légalité belge, ma lettre ne contenait rien de délictueux. La police d’un pays démocratique eût été tenue de la restituer au destinataire, avec excuses. La presse du parti socialiste eût dû protester contre une perquisition dictée par le souci des intérêts du général Franco. Messieurs les socialistes n’éprouvèrent cependant pas la moindre gêne à tirer parti du service indiscret que leur offrait la police ; sans quoi ils n’eussent pas eu cette heureuse occasion de manifester une fois de plus la supériorité de leur morale sur l’amoralisme des bolcheviks.
Tout est symbolique dans cet épisode. Les socialistes belges m’ont accablé sous leur indignation juste au moment où leurs camarades de Norvège nous gardaient, ma femme et moi, sous les verrous, pour que nous ne puissions pas nous défendre contre les accusations du Guépéou. Le gouvernement norvégien savait parfaitement que les accusations de Moscou étaient forgées ; l’organe officiel de la social-démocratie norvégienne l’écrivit en toutes lettres dès les premiers jours. Mais Moscou frappa les armateurs et les marchands de poisson norvégiens au gousset – et messieurs les sociaux-démocrates se mirent aussitôt à plat ventre. Le chef du parti, Martin Tranmael, est plus qu’une autorité en matière de morale ; c’est un juste : il ne boit ni ne fume, est végétarien et se baigne l’hiver dans l’eau glacée. Cela ne l’empêcha pas, après nous avoir fait arrêter sur l’ordre du Guépéou, d’inviter l’agent norvégien du Guépéou, Jacob Friese, bourgeois sans honneur ni conscience, à me calomnier tout spécialement. Mais assez...
La morale de ces messieurs consiste en règles conventionnelles et en procédés oratoires destinés à couvrir leurs intérêts, leurs appétits, leurs craintes. Ils sont pour la plupart prêts à toutes les bassesses – au reniement, à la perfidie, à la trahison – par ambition et lucre. Dans la sphère sacrée des intérêts personnels, la fin justifie pour eux tous les moyens. C’est justement pourquoi il leur faut un code moral particulier, pratique et en même temps élastique, comme de bonnes bretelles. Ils détestent quiconque livre aux masses leurs secrets professionnels. En temps de paix, leur haine s’exprime par des injures, vulgaires ou « philosophiques ». Quand les conflits sociaux revêtent la forme la plus aiguë, comme en Espagne, ces moralistes, de conserve avec le Guépéou, exterminent les révolutionnaires. Puis, pour se justifier, ils répètent que « trotskysme et stalinisme sont une seule et même chose ».
Interdépendance dialectique de la fin et des moyens
Le moyen ne peut être justifié que par la fin. Mais la fin a aussi besoin de justification. Du point de vue du marxisme, qui exprime les intérêts historiques du prolétariat, la fin est justifiée si elle mène à l’accroissement du pouvoir de l’homme sur la nature et à l’abolition du pouvoir de l’homme sur l’homme.
Serait-ce que pour atteindre cette fin tout est permis ? nous demandera sarcastiquement le philistin, révélant qu’il n’a rien compris. Est permis, répondrons-nous, tout ce qui mène réellement à la libération des hommes. Cette fin ne pouvant être atteinte que par les voies révolutionnaires, la morale émancipatrice du prolétariat a nécessairement un caractère révolutionnaire. De même qu’aux dogmes de la religion, elle s’oppose irréductiblement aux fétiches, quels qu’ils soient, de l’idéalisme, ces gendarmes philosophiques de la classe dominante. Elle déduit les règles de la conduite des lois du développement social, c’est-à-dire avant tout de la lutte des classes, qui est la loi des lois.
Le moraliste insiste encore : serait-ce que dans la lutte des classes contre le capitalisme tous les moyens sont permis ? Le mensonge, le faux, la trahison, l’assassinat « et cætera » ? Nous lui répondons : ne sont admissibles et obligatoires que les moyens qui accroissent la cohésion du prolétariat, lui insufflent dans l’âme une haine inextinguible de l’oppression, lui apprennent à mépriser la morale officielle et ses suiveurs démocrates, le pénètrent de la conscience de sa propre mission historique, augmentent son courage et son abnégation. Il découle de là précisément que tous les moyens ne sont point permis. Quand nous disons que la fin justifie les moyens, il en résulte pour nous que la grande fin révolutionnaire repousse, d’entre ses moyens, les procédés et les méthodes indignes qui dressent une partie de la classe ouvrière contre les autres ; ou qui tentent de faire le bonheur des masses sans leur propre concours ; ou qui diminuent la confiance des masses en elles-mêmes et leur organisation en y substituant l’adoration des « chefs ». Par-dessous tout, irréductiblement, la morale révolutionnaire condamne la servilité à l’égard de la bourgeoisie et la hauteur à l’égard des travailleurs, c’est-à-dire un des traits les plus profonds de la mentalité des pédants et des moralistes petits-bourgeois.
Ces critériums ne disent pas, cela va de soi, ce qui est permis ou inadmissible dans une situation donnée. Il ne saurait y avoir de pareilles réponses automatiques. Les questions de morale révolutionnaire se confondent avec les questions de stratégie et de tactique révolutionnaire. L’expérience vivante du mouvement, éclairée par la théorie, leur donne la juste réponse.
Le matérialisme dialectique ne sépare par la fin des moyens. La fin se déduit tout naturellement du devenir historique. Les moyens sont organiquement subordonnés à la fin. La fin immédiate devient le moyen de la fin ultérieure... Ferdinand Lassalle fait dire dans son drame, « Franz van Sickingen », à l’un de ses personnages :
« Ne montre pas seulement le but, montre aussi le chemin,
Car le but et le chemin sont tellement unis
Que l’un change avec l’autre et se meut avec lui
Et qu’un nouveau chemin révèle un autre but. »
Les vers de Lassalle sont fort imparfaits. Lassalle lui-même, et c’est plus fâcheux encore, s’écarta dans sa politique pratique de la règle qu’il exprimait ainsi : on sait qu’il en arriva à des négociations occultes avec Bismarck. Mais l’interdépendance de la fin et des moyens est bien exprimée dans ces quatre vers. Il faut semer un grain de froment pour obtenir un épi de froment.
Le terrorisme individuel est-il ou non admissible du point de vue de la « morale pure » ? Sous cette forme abstraite, la question est pour nous tout à fait vaine. Les bourgeois conservateurs suisses décernent encore des éloges officiels au terroriste Guillaume Tell. Nos sympathies vont sans réserve aux terroristes irlandais, russes, polonais, hindous, combattant un joug politique et national. Kirov, satrape brutal, ne suscite en nous aucune compassion. Nous ne demeurons neutres à l’égard de celui qui l’a tué que parce que nous ignorons ses mobiles. Si nous apprenions que Nikolaev a frappé consciemment dans le dessein de venger les ouvriers dont Kirov piétinait les droits, nos sympathies iraient sans réserve au terroriste. Mais ce qui décide à nos yeux ce n’est pas le mobile subjectif, c’est l’utilité objective. Tel moyen peut-il nous mener au but ? Pour le terrorisme individuel, la théorie et l’expérience attestent le contraire. Nous disons au terroriste : il n’est pas possible de remplacer les masses ; ton héroïsme ne trouverait à s’appliquer utilement qu’au sein d’un mouvement de masses.
Dans les conditions d’une guerre civile, l’assassinat de certains oppresseurs cesse d’être du terrorisme individuel. Si un révolutionnaire faisait sauter le général Franco et son état-major, on doute que cet acte puisse susciter l’indignation morale, même chez les eunuques de la démocratie. En temps de guerre civile, un acte de ce genre serait politiquement utile. Ainsi dans la question la plus grave – celle de l’homicide – les règles morales absolues sont tout à fait inopérantes. Le jugement moral est conditionné, avec le jugement politique, par les nécessités intérieures de la lutte.
L’émancipation des ouvriers ne peut être l’œuvre que des ouvriers eux-mêmes. Il n’y a donc pas de plus grand crime que de tromper les masses, de faire passer des défaites pour des victoires, des amis pour des ennemis, d’acheter des chefs, de fabriquer des légendes, de monter des procès d’imposture – de faire en un mot ce que font les staliniens. Ces moyens ne peuvent servir qu’à une fin : prolonger la domination d’une coterie déjà condamnée par l’histoire. Ils ne peuvent pas servir à l’émancipation des masses. Voilà pourquoi la Quatrième Internationale soutient contre le stalinisme une lutte à mort.
Il va sans dire que les masses ne sont pas sans péché. Nous ne sommes pas enclins à les idéaliser. Nous les avons vues en des circonstances variées, à diverses étapes, au milieu des plus grands bouleversements. Nous avons observé leurs faiblesses et leurs qualités. Leurs qualités : la décision, l’abnégation, l’héroïsme trouvaient toujours leur plus haute expression dans les périodes d’essor de la révolution. A ces moments, les bolcheviks furent à la tête des masses. Un autre chapitre de l’histoire s’ouvrit ensuite, quand se révélèrent les faiblesses des opprimés : hétérogénéité, insuffisance de culture, manque d’horizon. Fatiguées, déçues, les masses s’affaissèrent, perdirent la foi en elles-mêmes et cédèrent la place à une nouvelle aristocratie.
Dans cette période les bolcheviks (les « trotskistes ») se trouvèrent isolés des masses. Nous avons pratiquement parcouru deux cycles semblables : 1897-1905, années de flux ; 1907-1913, années de reflux ; 1917-1923, années marquées par un essor sans précédent dans l’histoire ; puis une nouvelle période de réaction qui n’est pas encore finie. Grâce à ces événements, les « trotskistes » ont appris à connaître le rythme de l’histoire, en d’autres termes la dialectique de la lutte des classes. Ils ont appris et, me semble-t-il, réussi à subordonner à ce rythme objectif leurs desseins subjectifs et leurs programmes. Ils ont appris à ne point désespérer parce que les lois de l’histoire ne dépendent pas de nos goûts individuels ou de nos critériums moraux. Ils ont appris à subordonner leurs goûts individuels à ces lois. Ils ont appris à ne point craindre les ennemis les plus puissants, si la puissance de ces ennemis est en contradiction avec les exigences du développement historique. Ils savent remonter le courant avec la conviction profonde que l’afflux historique d’une puissance nouvelle les portera jusqu’à l’autre rive. Pas tous ; beaucoup se noieront en chemin. Mais participer au mouvement les yeux ouverts, avec une volonté tendue, telle est bien la satisfaction morale par excellence qui puisse être donnée à un être pensant !
Coyoacan, le 16 février 1938
PS : J’écrivais ces pages sans savoir que, ces jours-là, mon fils luttait avec la mort. Je dédie à sa mémoire ce court travail qui, je l’espère, eût trouvé son approbation : car Léon Sédov était un révolutionnaire authentique et méprisait les pharisiens.
Index biographique
Azana Manuel (1880-1939), homme politique de la gauche espagnole, Président de la République en 1936 lors du soulèvement militaire de Franco, mort en exil.
Basch Victor (1963-1944). président de la Ligue pour la défense des Droits de l'homme et du citoyen, assassiné pendant l'occupation par des miliciens français. Lors des « procès de Moscou », il fit publier dans le bulletin de la Ligue, Les Cahiers des droits de l'homme, un rapport de l'avocat Rosenmark favorable à Staline, puis il refusa tout autre article sur la question sous prétexte de « ne pas instituer de polémiques entre ligueurs », en donnant comme preuve de son impartialité qu'il avait condamné les « flots de sang » que la révolution russe avait fait couler du temps de Lénine et Trotsky.
Bauer Otto (1882-1939), principal dirigeant de la social-démocratie autrichienne après la première guerre mondiale, théoricien de ce qu'on appela « l'austro-marxisme », émigra après la défaite des travailleurs de Vienne en février 1934.
Bernstein Édouard (1850-1932), socialiste allemand, exécuteur testamentaire de Fr. Engels, proposa en 1899 une révision du marxisme consistant dans l'abandon de la perspective révolutionnaire en faveur d'un développement graduel vers le socialisme.
Brandler Henri, principal dirigeant du PC allemand en 1922-23, puis dirigeant de l'Opposition de droite, allié à Boukharine, exclu de l'Internationale communiste en 1929. Dénonça les condamnés des deux premiers « procès de Moscou », renversa sa position à la suite du troisième.
Brockway Fenner, député et dirigeant de l'Independent Labour Party de Grande-Bretagne lorsque celui-ci rompit dans les années 1930 avec le Labour Party ; réintégra le Labour Party après la deuxième guerre mondiale, actuellement Lord Brockway.
Caballero Largo (1869-1946), socialiste espagnol, fondateur et secrétaire de la centrale syndicale U.G.T. (Union générale des travailleurs), ministre et président du Conseil au cours de la guerre civile.
Dewey John (1859-1952), philosophe américain qui formula une conception proche du pragmatisme, l'instrumentalisme, et pédagogue de grande réputation. A 78 ans, il accepta de présider la commission d'enquête sur les procès de Moscou, en dépit de fortes pressions qui le contraignirent à démissionner du comité de rédaction du New Republic où, après avoir participé à sa fondation, il siégeait depuis vingt-cinq ans.
Duranty Walter, longtemps correspondant du New York Times à Moscou, fut favorable à Staline contre les oppositions.
Eastman Max, écrivain américain, défenseur de la révolution russe, puis de l'Opposition de gauche ; écrivit « La jeunesse de Trotsky », « Depuis la mort de Lénine ». A l'occasion des « procès de Moscou », il commença une évolution qui a abouti à des positions extrêmement conservatrices.
Fischer Louis, journaliste américain, auteur de livres sur les problèmes internationaux, longtemps correspondant à Moscou où il fut personnellement lié d'amitié avec Karl Radek, se montra favorable à Staline dans la période des « procès de Moscou », par la suite devint un partisan de Franklin D. Roosevelt, très hostile à l'Union soviétique quand commença la « guerre-froide ».
Green William (1873-1952), président de la centrale syndicale American Federation of Labour, notamment en 1936 lorsque se produisit la scission d'où naquit le C.I.O. (Congress of Industrial Organisations).
Hook Liston, correspondant de journaux américain§ à Moscou, dans la période de lutte entre Staline et les oppositions.
Iagoda Henri, dirigeant du Guépéou qui organisa le premier « procès » ; limogé un mois après, il fut à son tour arrêté, accusé au cours du troisième « procès » et exécuté en 1938.
Iezhov (Éjov), remplaça Iagoda à la tête du Guépéou en septembre 1936, immédiatement après le premier « procès de Moscou », resta en fonction à ce poste jusqu'au début de 1939 OÙ il fut remplacé par Beria et à son tour exécuté. La période pendant laquelle il fut à la tête du Guépéou a été celle des épurations les plus sanglantes du règne de Staline et est connue en Union soviétique sous le nom de « Iezhovtchina ».
Krivitsky Walter, haut fonctionnaire des services secrets soviétiques, rompit avec Moscou en 1937 après l'assassinat de son supérieur Ignace Reiss (Reiss avait rompu après le premier « procès » pour rejoindre la IVe Internationale). Krivitsky publia un livre « J'ai été un agent de Staline », il rejoignit les mencheviks en exil et fut trouvé assassiné dans une chambre d'hôtel à New York en 1942
Lewis John L., né en 1880, dirigeant de la Fédération des mineurs américaine, leader dans la centrale A.F.L. (American Federation of Labour) de l'opposition qui fit la scission pour fonder le C.I.O. (Congress of Industrial Organisations).
Lovestone Jay, dirigeant du PC américain de 1926 à 1928, exclu de l'Internationale communiste avec l'Opposition de droite en 1929, dirigea un groupe communiste indépendant jusqu'au début de la guerre mondiale. Il est devenu le chef du bureau des syndicats américains AFL-CIO chargé des relations internationales ; à ce titre, il a poursuivi dans le mouvement syndical international « la lutte internationale contre le communisme » et est à l'origine de plusieurs scissions syndicales.
Lyons Eugène, né en 1898, journaliste et écrivain américain, correspondant de l'United Press à Moscou de 1928 à 1934.
Makhno Nestor, anarchiste, chef de bandes paysannes qui lutta en Ukraine en 1918, à la fois contre la réaction ukrainienne, les troupes d'occupation allemandes et l'Armée rouge. Ses forces furent finalement dispersées par l'Armée rouge dans laquelle elles refusaient de s'intégrer.
de Man Henri (1885-1953), socialiste belge, classé à la gauche de la lie Internationale avant 1914, renonça au marxisme vers 1930 dans un livre « Au-delà du marxisme », collaborateur des nazis pendant la guerre, ce qui lui valut d'être condamné aux travaux forcés par contumace après la guerre.
Negrin Juan (1894-1956), socialiste espagnol, dernier chef du gouvernement de la République espagnole avant son départ pour l'exil en 1939, fut un des responsables de la répression dirigée contre les opposants de gauche antistaliniens.
Oliver Garcia, un des leaders de la Fédération Anarchiste Ibérique, devint ministre dans le gouvernement Caballero. Pendant les Journées de mai 1937 il se rendit à Barcelone pour obtenir des travailleurs la cessation du combat.
Paz Magdeleine, romancière française, exclue du PC en 1926 comme oppositionnelle, rompit avec Trotsky en 1929, rejoignit ensuite le Parti socialiste. Dénonça les « procès de Moscou » au Comité Central de la Ligue pour la défense des Droits de l'homme.
Pivert Marceau, leader de la gauche du Parti socialiste à partir de 1933 ; exclu du PS en 1938 il créa le P.S.O.P. (Parti socialiste ouvrier et paysan). Après la guerre, réintégra le Parti socialiste, mourut en 1958. Marceau Pivert affichait son appartenance à la franc-maçonnerie.
Pritt Denis Nowell, né en 1887, membre du Parlement britannique de 1933 à 1950, avocat membre du Conseil privé de la Couronne, président de la Société des relations culturelles avec l'URSS, prix Staline en 1954. Il fut un des deux avocats qui se trouvaient à Moscou lors de l'ouverture du premier « procès » et le défendit sur le plan juridique. Dans ses mémoires, récemment publiés, il se dérobe sur la question des « procès de Moscou ».
Rappoport Charles (1865-1940), né dans la Russie des tzars, émigra très tôt et s'intégra totalement dans le mouvement ouvrier français, membre du PC français depuis sa fondation au Congrès de Tours jusqu'au procès Boukharine.
Rosenmark Raymond, avocat français sans notoriété particulière. Invité à Moscou avec l'avocat britannique D.N. Pritt, alors que le premier « procès » et sa date étaient tenus secrets, il assista à ce procès et fit un rapport partial sur sa valeur juridique auprès de la Ligue pour la défense des Droits de l'homme.
Thomas Norman, leader socialiste américain.
Vandervelde Émile (1866-1938), leader du Parti Ouvrier Belge, président de la IIe Internationale avant 1914, ministre pendant la guerre 1914-1918.
Vorlander Karl, né en 1860, philosophe allemand ; en 1900, parallèlement à l'offensive révisionniste de Bernstein, il publia Kant und der Sozialismus.
Walcher Jacob, dirigeant syndicaliste du PC allemand, exclu de celui-ci en 1929 en même temps que Brandler, avec qui il rompit en 1932 pour adhérer au S.A.P. (Parti socialiste ouvrier) où il défendit une ligne prostaliniienne ; en 1945 il rejoignit en Allemagne orientale le S.E.D.