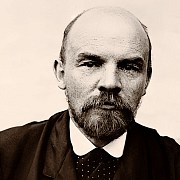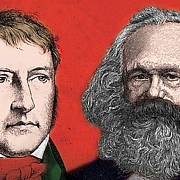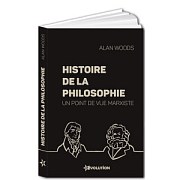Chapitre 9 – L’impasse de la philosophie kantienne
L’œuvre d’Emmanuel Kant (1724-1804) marque le début d’un tournant philosophique. Né à Kœnigsberg, en Prusse[1], il y passa la quasi-totalité de sa vie. En politique, c’était un libéral influencé par les idées de Rousseau, et il témoigna de la sympathie pour la Révolution française, tout au moins pour sa phase initiale. L’autre grande influence sur sa pensée fut celle de la science, qui à l’époque réalisait de spectaculaires progrès. Kant lui-même fut l’auteur d’importantes contributions scientifiques, en particulier dans son Histoire universelle de la nature et théorie du ciel (1755). Il y avance l’hypothèse nébulaire de la formation du système solaire, une théorie qui fut ensuite développée par Laplace – et reste généralement acceptée, de nos jours.
Lorsque Kant débuta son activité intellectuelle, la philosophie allemande était dans une impasse. Les brillantes intuitions de Leibniz ne suffisaient pas à constituer une école de pensée cohérente. Après sa mort, Christian Wolff essaya de les transformer en un système, mais ne parvint qu’à les vulgariser. Entre les mains de Wolff, les profondes intuitions de Leibniz furent transformées en un formalisme des plus arides. Kant était réfractaire à cette spéculation métaphysique qui tentait de résoudre les mystères de l’univers, non par l’observation de la nature, mais par le recours incessant au raisonnement abstrait. Or dans le monde réel, un nouvel esprit s’agitait. Les sciences naturelles se développaient rapidement, en particulier en Grande-Bretagne et en France. Même dans l’Allemagne assoupie, où la guerre de Trente Ans avait paralysé le progrès, un renouveau culturel s’exprimait dans l’Aufklärung, l’équivalent allemand des Lumières françaises. Kant était le produit de cette époque.
Son œuvre la plus importante, la Critique de la Raison pure, fut d’abord publiée en 1781, alors qu’il avait 57 ans, puis révisée dans une seconde édition, en 1787. Dans cette œuvre, Kant tente de résoudre le problème de la connaissance, qui avait provoqué une crise dans la philosophie, dont la plus claire expression était l’idéalisme subjectif de Berkeley et le scepticisme de Hume. Le but déclaré de Kant était d’en finir avec la vieille métaphysique, qui « semble être une arène tout particulièrement destinée à exercer les forces des lutteurs en des combats de parade et où jamais un champion n’a pu se rendre maître de la plus petite place et fonder sur sa victoire une possession durable » (Critique de la Raison pure, deuxième préface, PUF).
Les grands succès des sciences de la nature, particulièrement en Grande-Bretagne, signifiaient que la connaissance ne pouvait pas rester confinée à la pure spéculation abstraite, sortie du chapeau. Déterminé à rompre avec cette « métaphysique », Kant décida qu’il était nécessaire de revenir aux fondements. Il s’attaqua à l’épineuse question de savoir comment une connaissance vraie peut être obtenue. Les progrès frappants des sciences de la nature montraient la voie. Toutes les questions sur la nature de l’univers et la place qu’y occupe l’homme ne pouvaient pas être résolues par la spéculation abstraite, mais seulement par l’observation et l’expérimentation.
La tâche des sciences n’est pas uniquement d’accumuler un certain nombre de faits. Elle consiste à pénétrer les processus naturels. Or pour ce faire, de simples généralisations ne suffisent pas. Comme l’a bien vu Kant, la pensée ne doit pas rester passive ; elle doit être active. Ce n’est pas un hasard si le titre de son œuvre majeure se rapporte à la Raison (Vernunft), qu’il distingue clairement du simple Entendement (Verstand). Mais les formes de la raison sont-elles adéquates pour comprendre la réalité ? Kant soumit ces formes logiques à une recherche critique et montra que la logique traditionnelle tombe dans la contradiction (« antinomie »). Il démontra qu’il est possible de tirer des conclusions diamétralement opposées à partir des mêmes propositions. Mais chez Kant, ces contradictions demeurent sans solution.
La théorie kantienne de la connaissance
La relation du sujet à l’objet était, depuis des siècles, une question centrale de la philosophie. Pour simplifier, les matérialistes mécanistes mettaient uniquement l’accent sur l’objet (la réalité matérielle, la nature), ne laissant aucun rôle au sujet pensant, qui était dépeint comme un réceptacle passif, tandis que les idéalistes mettaient au contraire l’accent sur le sujet (l’esprit, l’Idée, etc.).
Kant demande ce qu’il nous est possible de connaître, et comment nous pouvons le connaître. C’est l’une des parties centrales de la philosophie : la théorie de la connaissance (ou « épistémologie »). Nous tirons la plus grande part de notre savoir de l’observation du monde réel. Depuis le plus jeune âge, nous voyons des choses, nous les entendons, nous les touchons, etc. Progressivement, nous construisons une image du monde dans lequel nous vivons. Cette sorte de savoir est celui de la perception sensorielle. Pour des empiristes comme Locke, il n’y en a pas d’autres. C’est là que Kant n’est pas d’accord. Dans la connaissance qu’il prend du monde, l’esprit n’est pas uniquement un contenant vide, susceptible d’être rempli par n’importe quoi (Locke le décrit comme une tabula rasa – une table rase). Pour Kant, il y a un acte de connaître. Nous ne faisons pas simplement une liste des choses que nous voyons ; nous les sélectionnons, nous les ordonnons et nous les interprétons consciemment. Pour cela, l’esprit a sa propre méthode et ses propres règles. Il y a des formes de la pensée que nous appliquons, consciemment ou non, lorsque nous tentons de comprendre l’information fournie par nos sens (les données sensorielles).
Kant soutient qu’il y a deux types de savoir. Si la majeure partie du savoir est tirée de l’expérience, il y a une partie de notre connaissance qui est a priori, qui ne provient pas de l’expérience. Nous ne pouvons connaître que ce qui nous est donné dans notre expérience perceptive, mais les « choses en soi », qui sont à l’origine de nos perceptions, ne peuvent pas être connues. Ici, Kant patine sur une glace très fine. Bien qu’il s’en soit défendu, ces idées se rapprochent de l’idéalisme subjectif de Hume et Berkeley. Précisément pour éviter cette conclusion, Kant modifia certaines formulations dans la seconde édition de sa Critique de la raison pure. Dans la première édition, certaines formulations pouvaient suggérer que, pour Kant, le sujet pensant était la même chose que l’objet perçu. Plus tard, il insista sur le fait que les choses hors de nous existent certainement, mais qu’elles se manifestent à nous seulement selon leur apparence – et non pas telles qu’elles sont en elles-mêmes.
A l’inverse de Locke, pour qui l’intégralité de la connaissance provient de nos sens, Kant soutient que certaines idées ne proviennent pas de la perception. Selon lui, certaines de nos connaissances sont innées, et notamment la connaissance du temps et de l’espace. Si nous faisons abstraction de tous les aspects physiques des phénomènes, dit-il, il ne nous reste plus que deux choses : le temps et l’espace. Or en réalité, le temps et l’espace, ainsi que le mouvement, sont les propriétés les plus générales et fondamentales de la matière. On ne peut les comprendre qu’en relation aux choses matérielles. Mais Kant était un idéaliste, et il insistait sur le fait que les notions de temps et d’espace étaient innées, qu’elles ne provenaient pas de l’expérience et qu’elles étaient, selon ses termes, « a priori ».
Pour soutenir cette idée que l’espace et le temps sont « des formes a priori de notre sensibilité », Kant use d’une façon très particulière de raisonner. Il soutient que, tandis qu’il est impossible de penser à des objets en dehors du temps, il est tout à fait possible de penser à un temps sans objets. Il développe le même argument à propos de l’espace. Or en réalité, l’espace et le temps sont inséparables de la matière, et il est impossible de les concevoir indépendamment de la matière. Contrairement à ce qu’affirme Kant, l’espace sans la matière est une abstraction vide – aussi vide que la matière sans espace. De fait, le temps, l’espace et le mouvement sont les modes d’existence de la matière, et ils ne peuvent être conçus d’aucune autre manière. L’idée de Kant selon laquelle le temps et l’espace sont des phénomènes subjectifs a été réfutée par les découvertes de la science.
Dans son Anti-Dühring, Engels souligne la fausseté du concept de connaissance a priori. En dernière analyse, toutes nos idées sont tirées de la réalité, y compris les axiomes des mathématiques. Il est vrai que si nous faisons abstraction de toutes les qualités matérielles d’une chose, il ne reste que l’espace et le temps. Toutefois, ce ne sont plus là que des abstractions vides. Espace et temps ne peuvent exister par eux-mêmes, pas plus qu’il ne peut y avoir de « fruit » sans qu’il y ait aussi des pommes, des poires, des oranges, etc., ou d’humanité sans êtres humains. La seule différence est que l’idée de fruit, ou d’humanité, sont les abstractions d’un genre particulier de matière, tandis que le temps et l’espace sont les traits les plus généraux, ou, mieux, les modes d’existence, de la matière en général.
La chose en soi
Toute connaissance humaine est le produit de deux facteurs : le sujet connaissant et l’objet de la connaissance. La matière première de la connaissance est fournie par l’objet extérieur (le monde physique), tandis que le sujet pensant donne une forme et une signification à l’information des sens. A la différence de Berkeley, Kant accepte l’existence d’un monde extérieur, sans lequel il n’y aurait pas de possibilité de connaître, autrement dit pas d’expérience. Néanmoins, Kant récuse la possibilité de connaître les choses telles qu’elles sont « en soi ». Nous pourrions seulement en connaître les apparences. Son erreur fondamentale consiste à ne pas voir la relation entre l’apparence et l’essence. Il n’est pas vrai que nous puissions seulement connaître des « apparences ». Quand je connais la propriété d’une chose, je connais la chose en elle-même. Il n’y a rien d’autre à connaître ; il n’y a pas d’« au-delà », pas de « chose en soi ».
A toute époque a régné la conviction que la seule façon d’arriver à connaître une chose consiste précisément à partir du matériel qui nous est livré par les sens et à l’analyser par le moyen de la réflexion. C’est cela, et rien d’autre, qui constitue le processus de la connaissance. Or avec Kant, nous sommes confrontés à l’affirmation selon laquelle il y aurait une certaine différence entre ce que nous pouvons voir, ce dont nous faisons l’expérience – et ce qu’est la nature « réelle » des choses. Cette thèse contredit toute l’expérience humaine et exige donc d’être justifiée très clairement. Mais le fait est que Kant ne la justifie pas du tout. Il l’affirme d’une manière dogmatique, en contradiction avec sa propre méthode (qui rejette le dogmatisme).
« C’est la maladie de notre époque », remarquait Hegel, « qui en est venue au désespoir pour lequel notre connaissance serait seulement une connaissance subjective et ce subjectif ce qu’il y a d’ultime » (Logique de 1830, addition au §22, Vrin, p.473). Hegel, comme Kant, était un idéaliste, mais il était un idéaliste objectif qui rejetait vigoureusement la thèse selon laquelle il était impossible de connaître le monde réel. Malgré tous ses défauts, un tel idéalisme est de loin supérieur au confusionnisme complet qui découle de l’idéalisme subjectif. Il n’est donc pas surprenant que dans « la maladie » de notre propre époque, ce soit Kant, et non Hegel, que chérissent les philosophes et les savants occupés à nous convaincre que nous ne pouvons pas réellement affirmer l’existence du monde physique, ou que nous ne pouvons pas connaître ce qui est arrivé avant le « big-bang » (et ne devons pas nous le demander), ou que le comportement des particules subatomiques dépend exclusivement du fait que nous soyons présents pour les observer.
Contre cette idée, nous sommes cent fois d’accord avec Hegel quand il dit que « les objets, la nature extérieure et la nature intérieure, d’une façon générale l’objet, ce qu’il est en soi, est tel qu’il est en tant que quelque chose de pensé, qu’ainsi la pensée est la vérité de l’être objectif. La tâche de la philosophie consiste seulement à amener expressément à la conscience ce qui, relativement à la pensée, a eu de tout temps pour les hommes une valeur. La philosophie n’établit donc rien de nouveau ; ce qui est ici amené au jour moyennant notre réflexion est déjà préjugé immédiat d’un chacun » (Logique de 1830, addition au §24, op. cit., p.474).
Il est évident qu’à tel ou tel moment donné nous ne pouvons pas tout connaître d’un phénomène. La vérité est aussi infinie que l’univers lui-même. Mais toute l’histoire de la pensée humaine se caractérise par un mouvement constant de l’ignorance vers le savoir. Ce que nous ne savons pas aujourd’hui, nous le découvrirons demain. Par conséquent, il est profondément erroné de confondre ce que nous ne savons pas avec ce qui ne peut pas être connu. La « chose en soi » de Kant n’est qu’une façon d’indiquer nos limitations présentes ; elle n’est pas un mystère, mais un problème à résoudre. Ce qui est aujourd’hui une chose-en-soi deviendra demain une chose-pour-nous. Tel est le message de toute l’histoire de la pensée en général, et de la science en particulier.
En réalité, la chose en soi est une abstraction vide. Si nous retirons toutes les propriétés connaissables d’un objet, il ne nous reste précisément plus rien. Comme l’observe justement J. N. Findlay, faisant écho à Hegel :« La Chose en soi, que Kant tient pour inconnaissable, est en réalité la plus complètement connaissable des abstractions ; elle est ce que nous obtenons quand nous abandonnons délibérément tout contenu empirique et toute trace de structure catégoriale » (préface à son édition anglaise de la Logique de Hegel, p. XII). Il y a une différence fondamentale entre ce qui n’est pas connu et ce qui est inconnaissable. Ici, Kant glisse vers l’agnosticisme, cette doctrine impuissante qui affirme qu’il y a certaines choses qui ne peuvent pas être connues, et qu’en conséquence il y a certaines questions qui ne doivent pas être posées. Findlay est sévère, mais pas injuste, lorsqu’il conclut que « Kant, en bref, est dans une confusion philosophique permanente, et ne sait jamais où il en est ni où il va » (ibid. p. XIV). La notion de chose en soi inconnaissable est incontestablement le point le plus faible de la philosophie de Kant, et c’est précisément cette faiblesse que retiennent et approuvent nombre de philosophes et savants modernes.
L’erreur de Kant découle du fait qu’il considère l’apparence et l’essence comme des choses mutuellement exclusives. La pensée n’est pas conçue comme un pont réunissant le sujet pensant au monde, mais comme une barrière entre le sujet et l’objet. Il est vrai que Kant présente aussi la pensée comme un instrument que nous employons pour comprendre le monde. Mais c’est là une formulation insatisfaisante, comme l’explique Hegel :
« Un thème principal de la philosophie critique [c.-à-d. : kantienne] est qu’avant d’entreprendre de connaître Dieu, l’essence des choses, etc., il y aurait à examiner préalablement la faculté de connaître elle-même, pour savoir si elle est capable de s’acquitter d’une telle tâche ; on devrait préalablement apprendre à connaître l’instrument, avant d’entreprendre le travail qui doit être réalisé par le moyen de ce dernier ; sinon, au cas où il serait insuffisant, toute la peine prise serait dépensée en pure perte. Cette pensée a paru si plausible qu’elle a suscité la plus grande admiration et approbation, et a ramené la connaissance, de son intérêt pour les objets et de son occupation avec eux, à elle-même, à l’élément formel » (Logique de 1830, op. cit., p.174).
Hegel souligne que la pensée n’est pas un « instrument », comme le serait un outil qu’on pourrait examiner avant de se mettre à la tâche. S’il en était ainsi, nous serions confrontés au paradoxe suivant : l’« outil » aurait à s’examiner lui-même, puisque la pensée ne peut être examinée qu’en pensant. Chercher à savoir avant de savoir est une conduite semblable à celle d’un homme qui refuserait d’entrer dans l’eau tant qu’il n’a pas appris à nager. Les hommes et les femmes ont pensé bien avant que la logique ne soit conçue. En réalité, les formes de la pensée, y compris la logique, sont le produit d’une très longue période de développement humain, à la fois mental et pratique. Les objets du monde physique nous sont immédiatement donnés dans la perception sensorielle, mais l’affaire ne s’arrête pas là. L’entendement se met à analyser l’information livrée par les sens, c’est-à-dire à la décomposer en ses parties. C’est ce qui est connu sous le nom de « médiation », en philosophie.
En dépit de son indéniable génie, Kant a rendu un mauvais service à la philosophie et à la science en fixant implicitement une limite à la connaissance humaine. La théorie de l’inconnaissable, cette partie de la philosophie de Kant qui aurait dû sombrer dans l’oubli, est précisément la seule chose de Kant qui ait été reprise de nos jours par ceux qui, comme Heisenberg, souhaitent introduire le mysticisme dans la science. Alors que Kant a tenté une critique des formes de la logique (et ce fut son grand mérite), il a fait preuve d’une certaine incohérence – par exemple en acceptant le principe de contradiction. Ce qui l’a confronté à de nouveaux problèmes.
Les formes de la logique
L’aspect le plus important de la Critique de la Raison pure réside dans sa critique de la logique, dont il disait que, depuis Aristote, « elle n’a pas eu besoin de faire un pas en arrière », mais « n’a pu faire un seul pas en avant », non plus, de sorte que « selon toute apparence, elle semble arrêtée et achevée. » (Critique de la Raison pure, préface à la deuxième édition).
Une part importante des recherches de Kant porte sur la nature des formes de la pensée en général, et en particulier des formes de la logique. D’où viennent-elles ? Que représentent-elles ? Dans quelle mesure reflètent-elles la vérité ? Il faut porter au crédit de Kant d’avoir posé ces questions, même s’il n’a pas fourni une réponse adéquate. On est là au cœur du questionnement fondamental de toute philosophie, à savoir la relation entre l’être et la pensée, entre la matière et l’esprit. Comme Hegel, Kant tenait en piètre estime la logique formelle, « un art spécieux (…) qui donne à toutes nos connaissances la forme de l’entendement ».
Kant fut le premier à distinguer entre entendement (Verstand) et raison (Vernunft). Bien qu’il joue un rôle important, pour Kant, l’entendement est la forme de pensée rationnelle la plus basse. Il prend les choses comme elles sont ; il se borne à enregistrer le simple fait de l’existence. C’est la base de la logique formelle – et aussi du sens commun, qui considère les choses telles qu’elles semblent être.
Mais le processus de la pensée ne s’arrête pas au niveau de l’entendement et de l’expérience sensible immédiate. Pour parvenir à une compréhension dialectique du réel, il faut l’intervention de la raison, qui va au-delà de ce qui est donné immédiatement à nos sens, le décompose en ses éléments constituants et le recompose à nouveau. C’est le rôle de la dialectique. Jusqu’à Kant, l’art de la dialectique avait été pratiquement oublié ; la dialectique était considérée comme un sophisme, une « logique de l’illusion ». C’est le grand mérite de Kant d’avoir remis la dialectique à sa juste place en philosophie, comme une forme supérieure de logique.
Kant cherche à placer la connaissance sur des bases solides, et il insiste sur le fait qu’elle doit reposer sur l’expérience. C’est cependant insuffisant. Dans la phase initiale de la connaissance, nous sommes assaillis par une masse confuse de données, sans liens logiques ni connexions nécessaires. On ne peut pas alors parler à ce stade de connaissance réelle, et encore moins de savoir scientifique. On attend quelque chose de plus. Pour donner une signification aux données sensorielles, il faut que la raison soit active, et non simplement passive :
« Ils comprirent [les physiciens] que la raison n’aperçoit que ce qu’elle produit elle-même d’après ses propres plans, qu’elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois constantes, et forcer la nature à répondre à ses questions, au lieu de se laisser conduire par elle comme à la lisière ; car autrement des observations accidentelles et faites sans aucun plan tracé d’avance ne sauraient se rattacher à une loi nécessaire, ce que cherche pourtant et ce qu’exige la raison. Celle-ci doit se présenter à la nature tenant d’une main ses principes, qui seuls peuvent donner à des phénomènes concordants l’autorité de lois, et de l’autre les expériences qu’elle a instituées d’après ces mêmes principes. Elle lui demande de l’instruire, non pas comme un écolier qui se laisse dire tout ce qui plaît au maître, mais comme un juge qui a le droit de contraindre les témoins à répondre aux questions qu’il leur adresse ». (Critique de la Raison pure, seconde préface).
Il y a une différence importante entre la façon dont Kant et Aristote comprenaient les lois de la logique. Pour Aristote, elles étaient les lois mêmes des choses, tandis que pour Kant, l’idéaliste, elles ne sont que les lois de la pensée. Le nœud du problème est que, pour Kant, le principe d’identité, par exemple, ne peut pas être trouvé dans les choses elles-mêmes. Il est seulement appliqué aux choses par la conscience. Ainsi, pour Kant, la logique n’est qu’une méthode utile pour ordonner et classer les choses, alors que la dialectique – telle que les marxistes la comprennent – dérive ses lois du monde réel et les lui applique en retour. Cette conception erronée de Kant a été reprise par la logique et les mathématiques modernes, où il est souvent affirmé que les lois, les théorèmes, etc., ne sont que des idées formelles dont il est fait usage pour leur commodité, mais qui n’ont aucune relation avec le monde objectif.
Les « antinomies »
La partie la plus intéressante de la Critique de la Raison pure est celle qui porte sur les « antinomies ». Kant y montre les contradictions qui existent dans la pensée. Ainsi, commençant par les lois de la logique formelle et les appliquant au monde de l’expérience, Kant met en lumière les contradictions qui ne manquent pas d’apparaître. Il y voit une preuve de l’inconnaissabilité de la chose-en-soi, au lieu de voir que les contradictions sont objectives et présentes dans les phénomènes eux-mêmes.
Le problème fondamental est celui-ci : comment les formes de la logique s’appliquent-elles au monde réel ? Les catégories de la logique formelle ne nous disent absolument rien du monde réel. C’est à la science qu’incombe la tâche de découvrir les lois du monde réel grâce à l’observation et à l’expérimentation. Toutefois, le tableau du monde n’est jamais complet, puisque la science découvre sans cesse de nouveaux domaines et doit constamment réajuster ses théories. Tel est le processus réel. Cependant, Kant en a tiré des conclusions toutes différentes, comme on l’a vu.
Il a fallu attendre Hegel pour faire avancer cette question. Le problème, expliquait-il, vient de la nature de la logique formelle elle-même, qui conçoit les opposés comme mutuellement exclusifs. Or ils ne le sont pas. Par exemple, la catégorie logique d’identité présuppose son opposition à la différence. Quand nous disons qu’une chose est, nous pensons que nous avons identifié cette chose, mais en fait elle n’a d’identité qu’en comparaison à d’autres choses. Jean est Jean parce qu’il n’est pas Pierre, ni Paul, etc. Ainsi, l’identité présuppose la différence et n’a aucune signification prise isolément. En général, les choses n’ont de signification que dans une relation d’opposition à d’autres choses. La vie ne peut être comprise sans la mort. Nord et sud, droite et gauche, mâle et femelle, bien et mal, ne peuvent avoir de sens qu’en relation à leur opposé. L’unité des contraires est un fait fondamental de l’existence.
Dans sa Logique, Hegel expliquait que l’être pur et indifférencié est la même chose que le néant. Si nous nous bornons à l’affirmation selon laquelle une chose est, sans expliquer ses propriétés concrètes, ses contradictions internes, son mouvement, ses changements et ses multiples relations, nous ne saisissons pas la vérité de cette chose. En l’absence de toute concrétisation, l’être simple n’est qu’une abstraction vide. Pour résoudre cette contradiction particulière (« antinomie »), il faut comprendre que l’être et le non-être ne s’excluent pas l’un l’autre, mais se combinent dans le processus du devenir.
De même, les pôles opposés de la cause et de l’effet doivent être unis pour entrer en interaction. Si nous tentons d’isoler une cause et un effet particuliers, nous tombons immédiatement dans la contradiction, puisqu’il y a toujours un nombre infini de causes qui précède le cas donné ; en fait, derrière chaque fait isolé il y a toute l’histoire de l’univers. De la même façon, si l’on tente d’isoler tel fait particulier comme cause, on entre dans une chaîne indéfinie de phénomènes qui se succèdent.
Comment résoudre cette contradiction ? Si l’on s’en tient aux règles de la logique formelle, la seule solution aux antinomies de Kant consiste à récuser la validité d’une moitié de ses catégories – et d’en admettre uniquement l’autre moitié. Les scolastiques médiévaux, par exemple, déclaraient que le hasard (l’accident) n’était qu’un concept subjectif, un produit de l’ignorance des causes. Tout, dans l’univers, serait absolument déterminé et, en fait, pré-ordonné depuis le début par l’Etre Suprême. De même, la logique traditionnelle proclamait que l’Identité était absolue – et que la Contradiction devait être rigoureusement proscrite.
Dans la section sur les antinomies, Kant souligne que la contradiction n’est pas qu’une ruse de sophiste, car elle est inévitable. Les antinomies, qui développent deux séries de preuves à l’appui de deux propositions contraires, ne sont pas de purs sophismes ; elles ne sont pas fallacieuses, dit Kant, car elles sont fondées sur la nature de la raison :
« Malheureusement pour la spéculation (mais heureusement peut-être pour la destination pratique de l’homme), la raison se voit, au milieu de ses plus grandes espérances, si embarrassée d’arguments pour et contre, que ne pouvant, tant par honneur que dans l’intérêt même de sa sûreté, ni reculer, ni regarder avec indifférence ce procès comme un jeu, ni moins encore demander la paix, lorsque l’objet de la dispute est d’un si haut prix, il ne lui reste qu’à réfléchir sur l’origine de cette lutte avec elle-même, pour voir si par hasard un simple malentendu n’en serait pas la cause, et si, ce malentendu une fois dissipé, les prétentions orgueilleuses de part et d’autre ne feraient pas place au règne tranquille et durable de la raison sur l’entendement » (Critique de la Raison pure, Antinomie de la raison pure, 3e section).
La solution réelle réside dans l’approfondissement sans fin de la connaissance, car la raison ne peut « donner aucune réponse aux questions qui s’élèvent sur les conditions de sa synthèse, réponse qui nous dispense de les poser toujours sans fin. Suivant elle, il faut s’élever d’un commencement donné à un commencement antérieur, chaque partie conduit à une partie encore plus petite, chaque événement a toujours pour cause un autre événement, au-dessus de lui, et les conditions de l’existence en général s’appuient toujours sur d’autres, sans jamais trouver un soutien ni un point d’appui absolu dans une chose existant par elle-même comme être premier » (Ibid.).
Chaque réponse donne lieu à une nouvelle question, et ainsi de suite à l’infini. Il n’y a pas de réponses finales, pas de fin au processus. Autrement dit, la pensée dialectique est ouverte, non dogmatique. La solution des problèmes prétendument insolubles est donnée par le processus sans fin de l’histoire de la science et de la pensée en général. La seule façon de résoudre les contradictions dans la pensée ne pouvait résider que dans un complet remaniement de la logique, en brisant les vieux schémas rigides et incapables de refléter correctement la réalité d’un monde mouvant, changeant, vivant et contradictoire.
Hegel a rendu hommage à Kant pour avoir réintroduit la notion de contradiction au cœur de la logique :
« Cette pensée, que la contradiction qui est posée à même le rationnel par le fait des déterminations d’entendement, est essentielle et nécessaire, est à considérer comme l’un des plus importants et plus profonds progrès de la philosophie des temps modernes ». Néanmoins, ayant posé la question, Kant ne put ou ne voulut pas lui donner une réponse valable. « Aussi profond est ce point de vue, aussi triviale est la solution », souligne Hegel (Logique de 1830, §48, op. cit., p.308).
Kant n’a pas accompli cette révolution, mais son grand mérite fut de montrer la voie à suivre. Il a donné à la philosophie un regain de vitalité. En soumettant les vieilles formes de la pensée à une critique approfondie, qui a révélé leur nature intrinsèquement insatisfaisante et contradictoire, la Critique de la Raison pure a montré que les contradictions étaient inhérentes à la pensée. Ce faisant, Kant a réintroduit la dialectique en philosophie. Jusque-là, la dialectique était considérée comme une méthode de raisonnement purement subjective (au sens de « sophistique »). Il a montré que la dialectique n’était ni arbitraire, ni subjective, mais qu’elle était une méthode de raisonnement entièrement valide.
Bien que révolutionnaire en son temps, la philosophie de Kant n’apporte pas de solution satisfaisante aux problèmes qu’elle pose. Plus qu’à toute autre chose, la dialectique de Kant ressemble à la vieille dialectique socratique. Celle-ci n’est pas sans mérite. La lutte entre des conceptions opposées, dans laquelle une juste valeur est accordée aux arguments de l’autre partie, et dans laquelle des arguments « pour » et « contre » sont avancés d’une façon rigoureuse, peut mener à un approfondissement des questions soulevées. Il y a toutefois quelque chose d’insatisfaisant : une forme d’agnosticisme, l’idée superficielle que « la vérité n’est jamais tout entière d’un seul côté », et ainsi de suite.
Les antinomies de Kant ne sont qu’au nombre de quatre. Il revint à Hegel de mettre en lumière qu’il y a une « antinomie » (contradiction) en toute chose :
« La signification vraie et positive des antinomies consiste d’une façon générale en ce que toute réalité effective contient en elle des déterminations opposées et qu’ainsi la connaissance et plus précisément la conception d’un objet ne signifient justement rien de plus qu’être conscient de lui comme d’une unité concrète de déterminations opposées » (Logique de 1830, addition au §48, op. cit., p.504).
Le mérite de Kant a consisté à soumettre les formes traditionnelles de la logique à une critique minutieuse. Son défaut réside dans le caractère subjectiviste de sa théorie de la connaissance. Là fut la source de ses principales faiblesses, à savoir l’ambiguïté, l’incohérence et l’agnosticisme. En échouant à opérer une rupture claire avec la logique traditionnelle, tout en exposant ses limites, Kant s’est révélé incapable de résoudre ses propres contradictions. Le problème de la relation entre sujet et objet (la pensée et l’être) ne fut résolu que par Marx et Engels. Ils montrèrent qu’en dernière instance tous les problèmes de la philosophie se résolvent dans la pratique :
« Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique » (Marx, Thèses sur Feuerbach, Thèse 8, in L’Idéologie Allemande, Ed. Sociales, p.3).
[1] Depuis 1945, Kœnigsberg est devenu Kaliningrad, dans l’enclave russe qui se situe entre la Pologne et la Lituanie. C’était autrefois l’un des ports allemands les plus importants sur la Baltique.