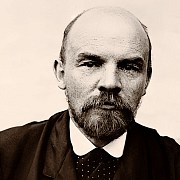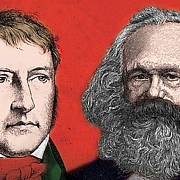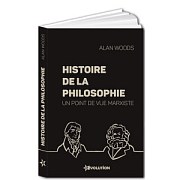Chapitre 10 – La révolution hégélienne
« Du reste, il n’est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation et de transition vers une nouvelle période ; l’esprit a rompu avec le monde de son être-là et de la représentation qui a duré jusqu’à maintenant ; il est sur le point d’enfouir ce monde dans le passé, et il est dans le travail de sa propre transformation. En vérité, l’esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, mais il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif ; seulement il en est ici comme dans le cas de l’enfant ; après une longue et silencieuse nutrition, la première respiration, dans un saut qualitatif, interrompt brusquement la continuité de la croissance seulement quantitative, et c’est alors que l’enfant est né ; ainsi l’esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu’à sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l’édifice de son monde précédent ; l’ébranlement de ce monde est seulement indiqué par des symptômes sporadiques ; la frivolité et l’ennui qui envahissent ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d’un inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d’autre qui est en marche. Cet émiettement continu qui n’altérait pas la physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du soleil, qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde » (Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Préface, Aubier, p.12).
Le « voyage d’exploration » de Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel est né à Stuttgart en 1770. Il fut dans sa jeunesse un disciple puis un collaborateur de Schelling, dont les vues radicales lui valurent une certaine notoriété – mais qui, l’âge aidant, finit par se réconcilier avec les autorités prussiennes.
Hegel ne tarda pas à dépasser ses recherches initiales. Il contribua de façon très originale à la philosophie dès 1807, avec la publication de la Phénoménologie de l’Esprit. C’était une période de tensions et de tempêtes. Hegel n’avait que 19 ans lors du début de l’éruption révolutionnaire en France. La Révolution française et les guerres napoléoniennes marquèrent toute cette époque d’une empreinte indélébile. Comme Hegel lui-même le précise, « la composition du livre fut achevée à minuit la veille de la bataille de Iéna », c’est-à-dire le 14 octobre 1806.
Cette œuvre, que Hegel décrit comme son « voyage d’exploration », fut reçue froidement par ceux qui avaient été ses maîtres et ses amis.
La Phénoménologie retrace le développement de la pensée dans toutes ses phases, des formes les plus humbles, générales et abstraites à la forme supérieure, qu’il nomme le Concept. Chaque forme de connaissance est examinée à partir de ses propres conditions et limites, de façon à révéler sa relation dialectique aux autres formes de pensée. La particularité de la philosophie réside dans le fait qu’elle seule doit considérer et justifier ses propres conceptions – à la différence des mathématiques, par exemple, qui procèdent à partir d’axiomes donnés et admis de façon non critique. La philosophie ne présuppose rien, pas même elle-même.
Pour le lecteur moderne, les œuvres de Hegel présentent des difficultés considérables. Engels les qualifiait d’abstraites et abstruses. C’est le cas de la Phénoménologie. On a parfois l’impression que Hegel se fait délibérément obscur, qu’il met le lecteur au défi de pénétrer l’édifice complexe de la pensée dialectique. Une bonne partie de la difficulté, cependant, provient du fait que Hegel était un idéaliste. En conséquence, la dialectique apparaît chez lui sous une forme mystique. La Phénoménologie en est un bon exemple.
Le développement historique apparaît ici sous une forme idéaliste, comme développement de la conscience de soi de l’Esprit. Néanmoins, il est possible de lire Hegel, comme Marx l’a fait, d’un point de vue matérialiste, en révélant le noyau rationnel de sa pensée. Dans la Phénoménologie, la « conscience de soi » manifeste son activité sous de nombreuses formes, à travers la sensation et la perception aussi bien qu’à travers les idées. Dans toutes ces analyses de Hegel, on peut percevoir les pâles contours des processus réels qui se développent dans la nature, la société et l’esprit humain. Par opposition aux philosophies idéalistes antérieures, Hegel a fait preuve d’un vif intérêt pour la nature et l’histoire humaine. Derrière ses formulations abstraites, il y a un savoir extrêmement riche sur tous les aspects de l’histoire, de la philosophie et de la science contemporaine. Marx décrivait Hegel comme l’esprit le plus encyclopédique de son temps.
Derrière le langage « abstrait et abstrus », une fois dépouillée la mystification idéaliste, nous avons affaire à une véritable révolution dans la pensée humaine. Le démocrate radical russe Herzen considérait la dialectique hégélienne comme « l’algèbre de la révolution ». Dans une équation algébrique, il est nécessaire de pourvoir aux quantités manquantes. C’est ce qui fut accompli ultérieurement par Marx et Engels, qui sauvèrent le noyau rationnel de la philosophie de Hegel et, en la plaçant sur une base matérialiste, lui donnèrent un caractère scientifique. Engels écrivait :
« Cette philosophie allemande moderne a trouvé sa conclusion dans le système de Hegel, dans lequel, pour la première fois – et c’est son grand mérite – le monde entier de la nature, de l’histoire et de l’esprit était présenté comme un processus, c’est-à-dire comme étant engagé dans un mouvement, un changement, une transformation et une évolution constants, et où l’on tentait de démontrer l’enchaînement interne de ce mouvement et de cette évolution. De ce point de vue, l’histoire de l’humanité n’apparaissait plus comme un enchevêtrement chaotique de violences absurdes, toutes également condamnables devant le tribunal de la raison philosophique arrivée à maturité et qu’il est préférable d’oublier aussi rapidement que possible, mais comme le processus évolutif de l’humanité lui-même ; et la pensée avait maintenant pour tâche d’en suivre la lente marche progressive à travers tous ses détours et de démontrer en elle, à travers toutes les contingences apparentes, la présence de lois » (Anti-Dühring, Ed. Sociales, p.53).
Hegel aujourd’hui
Hegel était un génie très en avance sur son temps. Malheureusement, le niveau atteint par les sciences de la nature, au début du XIXe siècle, n’était pas suffisant pour lui permettre d’appliquer pleinement sa nouvelle méthode révolutionnaire – ce qui ne l’a pas empêché, cependant, de formuler un certain nombre d’anticipations brillantes, comme l’a souligné Ilya Prigogine. Plus tard, Engels appliqua cette même méthode aux sciences de la nature dans sa Dialectique de la nature, un chef-d’œuvre de la dialectique. Et de nos jours, la science fournit en abondance de quoi illustrer la valeur des idées fondamentales de Hegel. Il est tragique que le XXe siècle n’ait pas disposé d’un Hegel pour en réfléchir les grandes découvertes scientifiques.
De nos jours, de nombreux savants ont une attitude méprisante à l’égard de la philosophie, qu’ils considèrent comme inutile à leurs recherches. Ils s’imaginent que les récents progrès de la science les placent très au-dessus de la philosophie. Mais en réalité, ils sont très en dessous de la philosophie la plus primitive. On dit que la nature a horreur du vide. Et en effet, faute d’une philosophie consistante, de nombreux scientifiques sont la proie de toutes sortes de préjugés et d’idées fausses, qu’ils ont inconsciemment assimilés à partir des tendances et des humeurs dominantes dans la société. Cet ensemble hétéroclite, dont quelques vagues souvenirs d’une mauvaise philosophie recueillie à l’université, constitue la totalité du bagage intellectuel de nombreuses personnes supposément éduquées, y compris de savants. Comme Hegel le remarquait avec humour, ces préjugés philosophiques sont considérés « comme des équivalents parfaits, de très bons succédanés de ce long chemin de culture, de ce mouvement aussi riche que profond à travers lequel l’esprit parvient au savoir ; à peu près comme on vante la chicorée d’être un très bon succédané du café » (Phénoménologie de l’esprit, préface, op. cit., p.58).
De nos jours, lamentablement, Hegel est négligé. Les courants dominants de la philosophie occidentale – le postmodernisme, la philosophie analytique et le positivisme logique, ce dernier étant né, pour partie, d’une réaction contre l’hégélianisme – considèrent Hegel à la façon dont les extrémistes protestants considèrent le Pape. Par contrecoup, les idées du positivisme logique (entre autres) ont influencé nombre de savants. Le Belge Ilya Prigogine est l’un des très rares scientifiques modernes, en Europe, qui ait reconnu la valeur de Hegel. Prigogine a développé la théorie du chaos et de la complexité, qui a beaucoup de choses en commun avec la dialectique.
Il est très facile de récuser Hegel ou Engels, car leurs écrits sur la science étaient nécessairement limités par l’état de la science à leur époque. Ce qui est remarquable, en revanche, c’est de noter que certaines idées scientifiques de Hegel (et d’Engels) étaient très en avance sur leur temps. Par exemple, dans La Nouvelle alliance, Prigogine et Stengers soulignent que Hegel avait rejeté la méthode mécaniste de la physique classique newtonienne, et ce à une époque où les idées de Newton étaient universellement considérées comme sacro-saintes : « La philosophie hégélienne de la nature », écrivent Prigogine et Stengers, « fait système de tout ce que niait la science newtonienne et, en particulier, de la différence qualitative entre le comportement simple décrit par la mécanique et celui des êtres plus complexes. Elle oppose à l’idée de réduction, à l’idée que les différences ne sont qu’apparentes et que la nature est fondamentalement homogène et simple, l’idée d’une hiérarchie au sein de laquelle chaque niveau est conditionné par le niveau précédent, qu’il dépasse et dont il nie les limitations, pour, à son tour, conditionner le niveau suivant qui manifestera de manière plus adéquate, moins limitée, l’esprit à l’œuvre dans la nature » (La Nouvelle alliance, Folio, p.150).
Prigogine et Stengers évoquent la négligence injuste dont Hegel a souffert, précisément à une époque où sa critique du mécanisme de Newton s’est révélée correcte. Le système hégélien, écrivent-ils, « constitue une réponse philosophique extrêmement exigeante et rigoureusement articulée au problème crucial posé par le temps et la complexité. Mais il a incarné, aux yeux de générations de scientifiques, l’objet par excellence de répulsion et de dérision. En quelques années, les difficultés intrinsèques de la pensée hégélienne s’étaient d’ailleurs, en ce qui concerne la philosophie de la nature, doublées de la complète obscurité de la plupart des références scientifiques qui avaient permis à Hegel de décrire la logique du développement de l’esprit dans la nature. Car dans son opposition au système newtonien, Hegel s’était appuyé sur des hypothèses scientifiques de son époque. Mais ces hypothèses tombèrent dans l’oubli avec une rapidité exceptionnelle. Du point de vue de l’histoire des sciences, il est difficile d’imaginer pire moment que ce début du XIXe siècle pour chercher dans des connaissances scientifiques l’appui nécessaire à un projet d’alternative à la science newtonienne. A cette époque, les théories qui semblaient incompatibles avec la science newtonienne, et avec la mathématisation en général, s’étaient mises à proliférer, notamment en physique ; beaucoup allaient être abandonnées en quelques années. » (op. cit., p.151)
A cela, il ne reste qu’une ou deux choses à ajouter. Et d’abord : ce qui était valable dans la philosophie de Hegel n’était pas son système, mais sa méthode dialectique. L’une des raisons pour lesquelles les œuvres de Hegel sont obscures tient précisément au fait qu’il a essayé de forcer la dialectique – qu’il a brillamment développée – à entrer dans le carcan d’un système philosophique idéaliste et arbitraire. Et quand cela ne marchait pas, il recourait à toutes sortes de subterfuges et de raisonnements tortueux qui rendaient l’ensemble extrêmement alambiqué et obscur.
Cependant, nous sommes fermement convaincus que la principale raison de la honteuse conspiration contre Hegel n’a rien à voir avec l’obscurité de ses formulations ou de son style. Cela ne dérangeait pas les universitaires, il y a un siècle. Par ailleurs, l’obscurité de Hegel n’est rien comparée aux sinuosités linguistiques dépourvues de sens des positivistes logiques, qui sont pourtant tenus pour des modèles de « pensée cohérente » (sans qu’on sache bien pourquoi). Non : si Hegel est généralement méprisé, c’est surtout parce qu’on s’est rendu compte que sa philosophie dialectique était le point de départ des idées révolutionnaires de Marx et Engels. Le pauvre Hegel, si conservateur dans sa vraie vie, a été jugé par contumace et déclaré coupable par association.
La peur des idées de Hegel n’a rien d’un accident ou d’un malentendu. Même au XIXe siècle, certains esprits avaient compris le danger que représentait la dialectique. James Stirling, éminent « hégélien » anglais, écrivait en 1867 : « Cette dialectique, il me semble, a conduit à beaucoup d’équivoques tant chez Hegel que chez d’autres, et elle peut encore devenir une peste » (Note à L’Histoire de la philosophie de Schwegler, op. cit., p.415).
Même de son vivant, les implications révolutionnaires de la philosophie de Hegel ont commencé à déranger les autorités prussiennes. La défaite des armées napoléoniennes, en 1815, ouvrit une période de réaction dans toute l’Europe. Dans toutes les régions sous domination prussienne, les « décrets de Carlsbad » de 1819 soumirent les universités à un contrôle inquisitorial. La moindre non-conformité était regardée comme de la subversion. Une atmosphère étouffante de provincialisme mesquin prévalut sur les terres des hobereaux mangeurs de choux (« krautjunkers »), comme Marx désignait ironiquement les aristocrates féodaux prussiens.
A l’université de Berlin, où Hegel enseignait, des rumeurs malveillantes circulaient – à l’initiative de ses ennemis – selon lesquelles ses idées étaient non-chrétiennes, voire franchement athées. Attaqué à la fois par les rationalistes et les évangélistes, Hegel se défendit vigoureusement, faisant remarquer que « toute philosophie spéculative sur la religion peut être portée à l’athéisme ; tout dépend de qui l’y porte ; la piété particulière à notre temps, et la malveillance des démagogues, ne nous laisseront pas manquer de gens qui l’y portent » (Hegel, Logique).
L’atmosphère de persécution était telle que Hegel envisagea de s’établir en Belgique, comme Marx le fit plus tard. En 1827, il écrivit une lettre à sa femme où il lui indiquait qu’il avait songé aux universités de Liège et de Louvain, avec le sentiment qu’elles pourraient lui procurer un lieu de repos « pour le cas où à Berlin les porteurs de soutane me rendraient le séjour insupportable au Kupfergraben ». « La Curie de Rome », ajoutait-il, « serait en tout cas un adversaire plus honorable que la misérable cléricaille de Berlin » (Correspondance, III, p.176, Gallimard). L’ironie est qu’à la fin de sa vie, Hegel – conservateur et religieux – a été considéré comme un dangereux radical. Ceci dit, il y avait plus qu’un grain de vérité dans les soupçons des réactionnaires. Caché à l’intérieur de la philosophie de Hegel, il y avait le germe d’une idée révolutionnaire qui transformerait le monde. En soi, cela constitue le plus remarquable exemple d’une contradiction dialectique !
Dans son Histoire de la philosophie, Hegel a révélé la relation dialectique entre les différentes écoles de pensée. Il a montré que les différentes théories ont exprimé différents aspects de la vérité – et qu’elles se contredisent moins qu’elles ne se complètent les unes les autres. Dans l’Encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel tente, là aussi, de montrer que les sciences forment une totalité intégrée. Il ne s’agit pas seulement d’une collection de sciences ou d’un dictionnaire du savoir philosophique, mais de la science présentée comme une totalité en interrelation dialectique. C’est une conception très moderne.
Hegel n’entreprit pas de réfuter ou de démolir la philosophie de ses prédécesseurs, mais de reprendre toutes les écoles de pensée précédentes pour parvenir à une synthèse dialectique. Ce faisant, cependant, il a porté la philosophie à ses limites. Au-delà de ce point, il devint impossible de développer la philosophie sans la transformer en quelque chose de différent. On peut affirmer que, depuis Hegel, rien de neuf n’a réellement été dit sur les questions philosophiques majeures. Les écoles de philosophie qui suivirent, qui prétendaient être nouvelles et originales, se contentèrent de remâcher de vieilles idées d’une façon invariablement plus superficielle et insatisfaisante. La seule vraie révolution en philosophie depuis Hegel fut celle que Marx et Engels ont effectuée, qui dépasse les limites de la philosophie entendue comme exercice purement intellectuel, pour la conduire au royaume de la pratique et de la lutte pour transformer la société.
Dans l’une des introductions à son Histoire de la philosophie, Hegel dit que « l’être de l’esprit est dans son acte, et son acte consiste à être conscient de lui-même ». Mais chez Hegel, la pensée n’est pas seulement une contemplation. La plus haute forme de la pensée, la raison, ne se contente pas d’accepter les faits donnés ; elle les travaille et les transforme. La contradiction entre la pensée et l’être, entre le sujet et l’objet, est dépassée à travers le processus même de la connaissance, qui pénètre toujours plus loin dans le monde objectif. D’un point de vue matérialiste, cependant, la pensée n’est pas une activité isolée ; elle est inséparable de l’existence humaine en général. L’humanité développe sa pensée à travers l’activité concrète, et pas seulement à travers l’activité intellectuelle. En transformant le monde matériel par le travail, les hommes et les femmes se transforment aussi eux-mêmes et, ce faisant, élargissent l’horizon de leur pensée. De façon embryonnaire, les éléments de cette conception dialectique sont déjà présents chez Hegel. Mais Marx a ôté le travestissement idéaliste qu’elle avait chez Hegel – et l’a formulée d’une manière claire et scientifique.
La théorie de la connaissance
Comme nous l’avons vu, l’un des problèmes fondamentaux de la philosophie est la relation entre la pensée et l’être. Quelle est la relation entre la conscience (le savoir) et le monde objectif ? Kant prétend qu’il y a un fossé infranchissable entre le sujet pensant et la « chose en soi », qui dès lors est inconnaissable. Hegel pose la question différemment. Le processus de la pensée, explique-t-il, est l’unité du sujet et de l’objet. La pensée n’est pas une barrière séparant l’homme du monde objectif, mais, au contraire, un processus liant, « médiatisant », les deux. Prenant comme point de départ la réalité immédiatement livrée aux sens, la pensée humaine ne se contente pas de la recevoir passivement, comme l’imaginait Locke ; elle se met au travail, transforme cette information, l’analyse en ses composants et la reconstitue de nouveau. L’homme use de la pensée rationnelle pour dépasser la réalité immédiate. La pensée dialectique, en analysant un phénomène donné, met en évidence les caractéristiques et tendances contradictoires qui lui donnent vie et mouvement.
Le savoir scientifique ne consiste pas en un simple catalogue d’éléments particuliers. Si nous disons « tous les animaux », nous n’avons pas encore la zoologie. Au-dessus et au-delà des faits, il faut découvrir les lois et les processus objectifs. Il faut découvrir les relations objectives entre les choses – et expliquer les transitions d’un état à un autre. L’histoire des sciences, comme celle de la philosophie, est un processus permanent d’affirmation et de négation, un processus et un développement incessants, au cours duquel une idée en nie une autre, et, à son tour, est niée, en un processus sans fin d’approfondissement du savoir de soi et de l’univers. On peut observer le même type de processus dans le développement psychique de l’enfant.
Le grand mérite de Hegel fut de montrer le caractère dialectique du développement de la pensée, qui depuis sa phase embryonnaire passe par toute une série d’étapes, pour parvenir finalement au plus haut degré du savoir, le Concept. Dans le vocabulaire de Hegel, cela correspond au processus de passage de « l’en-soi » à « l’en-soi et pour-soi », c’est-à-dire au passage de l’être implicite, non encore développé, à l’être développé et explicite. Par exemple, l’embryon humain est, en puissance, un être humain, mais pas encore un être humain en-soi et pour-soi. Afin de réaliser tout son potentiel, une longue période de temps est requise, dont l’enfance, l’adolescence et la maturité constituent les étapes nécessaires. La pensée d’un enfant a évidemment un caractère d’immaturité. Une idée exprimée par un enfant, même correcte, n’a pas le même poids que la même idée exprimée par une personne âgée, qui a l’expérience de la vie et, par conséquent, une compréhension plus profonde de ce que ces mots signifient effectivement.
Chez Hegel, le développement réel des êtres humains est présenté sous une forme mystique, comme un développement de l’esprit. Parce qu’il était idéaliste, Hegel n’avait pas une solide conception du développement de la société – bien qu’il y ait, dans ses œuvres, de brillantes anticipations du matérialisme historique. La pensée apparaît chez lui comme l’expression de l’Idée Absolue, un concept mystique à propos duquel la seule chose que nous sachions, comme Engels le note ironiquement, c’est que Hegel ne nous en dit absolument rien. En réalité, d’un point de vue marxiste, la pensée est le produit du cerveau humain et du système nerveux. Elle est inséparable du corps humain qui, à son tour, dépend de la nourriture, laquelle présuppose encore la société humaine et les rapports de production.
La pensée est un produit de la matière qui pense, la réalisation la plus accomplie de la nature. La matière inanimée recèle en elle-même le potentiel pour produire la vie. Même les formes de vie les plus élémentaires possèdent la sensibilité et l’irritabilité. Elles ont potentiellement la capacité de produire, chez les animaux supérieurs, un système nerveux et un cerveau. La « conscience de soi » de Hegel n’est rien d’autre qu’une façon mystique d’exprimer le processus historique par lequel les êtres humains réels deviennent graduellement conscients d’eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent. Cela ne se produit pas facilement ni automatiquement, pas plus que l’être humain individuel n’acquiert automatiquement la conscience dans la transition qui le conduit de l’enfance à l’âge adulte. Dans les deux cas, le processus se produit à travers une longue série d’étapes souvent traumatisantes. Comme cela se reflète dans l’histoire de la philosophie, des sciences et de la culture en général, le développement de la pensée humaine est un processus contradictoire dans lequel chaque étape dépasse la précédente et se trouve à son tour dépassée. Ce n’est pas une ligne droite, mais plutôt une ligne continuellement interrompue, avec des périodes de stagnation, d’hésitation et même des régressions qui, cependant, ne font que préparer le terrain pour de nouveaux progrès.
Comment la pensée se développe
Les tout premiers commencements de la pensée humaine, l’esprit à son stade immédiat et primitif, c’est la perception sensible : l’homme primitif, à travers ses sens, commence par enregistrer et mémoriser les données immédiates livrées par son environnement, sans en comprendre la nature exacte, les relations causales et les lois sous-jacentes. A partir de l’observation et de l’expérience, l’esprit s’élève graduellement à un certain nombre de généralisations d’un caractère plus ou moins abstrait. Ce processus consiste en un long et laborieux voyage qui a duré des millions d’années ; très lent au départ, il a rapidement pris de l’élan au cours des dix derniers millénaires. Néanmoins, en dépit des efforts colossaux réalisés par la pensée et la science, la pensée ordinaire en reste à un niveau tout à fait primitif.
Quand nous considérons un objet pour la première fois, nous en formons d’abord une notion d’ensemble, sans saisir tout le contenu concret ni le détail des interconnexions. Il ne s’agit que d’une première vue générale, d’une pure abstraction. Ainsi, les philosophes ioniens et même le bouddhisme ont saisi l’univers, de manière intuitive, comme une totalité dialectique en changement permanent. Mais cette notion initiale n’est pas assez concrète. Il faut aller plus loin et donner au tableau d’ensemble une expression définie, en analysant et en déterminant les relations précises de son contenu. Il doit être analysé et quantifié ; sans cela, la science en général est impossible. C’est toute la différence entre la pensée brute, immédiate, non développée, et la science en tant que telle.
A l’aube de la pensée consciente, les hommes et les femmes ne se distinguaient pas clairement de la nature, exactement comme un nouveau-né ne fait pas la différence entre lui-même et sa mère. Progressivement, sur une longue période, les hommes ont appris à distinguer, à connaître le monde en isolant certains éléments dans le tissu déconcertant des phénomènes naturels. Ils ont appris à observer, comparer, généraliser et tirer des conclusions. De cette façon, au terme d’innombrables millénaires, toute une série de généralisations importantes ont émergé sur la base de l’expérience. Ces généralisations se sont progressivement cristallisées dans les formes familières de la pensée, formes que tenons pour acquises parce que, justement, elles nous sont familières.
La pensée commune, celle de tous les jours, dépend beaucoup de la perception sensible, de l’expérience immédiate, des apparences et de cette combinaison particulière d’expérience et de pensée superficielle que nous appelons le « bon sens ». Cela suffit, en général, pour les besoins de la vie courante, mais c’est très insuffisant pour développer une conception scientifique du monde. A un certain stade, ce type de pensée devient même inutile pour des fins pratiques. Il faut aller au-delà de l’expérience immédiate de la perception sensible ; il faut saisir les processus généraux, les lois et les relations cachées qui se situent au-delà d’une apparence souvent trompeuse.
La pensée ordinaire s’accroche à ce qui est concret et familier. Il est plus facile d’accepter ce qui est apparemment stable et bien connu que des idées nouvelles. La routine, la tradition, l’habitude et les conventions sociales constituent une force puissante dans la société, qu’on peut comparer à la force d’inertie en mécanique. Habituellement, la plupart des gens ne sont pas portés à remettre en cause la société dans laquelle ils vivent, sa morale, son idéologie et ses rapports de propriété. Toutes sortes de préjugés, d’idées politiques et d’orthodoxies « scientifiques » sont acceptés sans critique, jusqu’à ce qu’un profond changement, dans la vie des masses, les force à tout remettre en cause.
Le conformisme social et intellectuel est la forme d’illusion la plus commune. Les idées familières sont tenues pour vraies simplement parce qu’elles sont familières. Ainsi, l’idée selon laquelle la propriété privée, l’argent et la famille bourgeoise sont des faits éternels et constants de la vie a profondément pénétré la conscience populaire, alors que cette idée est complètement fausse. La dialectique est l’opposé direct de cette façon superficielle – et commune – de penser. Précisément parce qu’elle met en cause les idées familières, elle suscite souvent une opposition farouche. Comment peut-on remettre en cause le principe d’identité, selon lequel (comme cela semble évident) « A = A » ? Or cette prétendue loi n’est que le reflet, au plan logique, d’un préjugé populaire selon lequel chaque chose est ce qu’elle est – et rien d’autre – parce que rien ne change. La dialectique, au contraire, part du point de vue opposé, selon lequel toute chose naît, change et meurt.
Le penseur empiriste, qui affirme prendre les choses « comme elles sont », s’imagine être très pratique et concret. Mais en réalité, les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent, et fréquemment elles se révèlent être l’opposé de ce qu’elles semblaient. La connaissance sensible immédiate est la forme de savoir la plus basse, semblable à celle d’un bébé. Une compréhension scientifique de la réalité requiert l’analyse de l’information fournie par la perception sensible, afin de parvenir à la vraie nature des choses considérées. Une analyse en profondeur doit révéler les tendances contradictoires qui travaillent même les choses les plus fixes, solides et immuables (en apparence) – tendances qui, en fin de compte, conduisent ces choses à se transformer en leur contraire. Ce sont précisément ces contradictions qui sont la source de toute vie, de tout mouvement et de tout développement dans l’ensemble de la nature. Pour véritablement comprendre les choses, il faut les prendre non seulement comme elles sont, mais aussi comme elles ont été et comme elles deviendront nécessairement.
Pour les besoins du quotidien, la logique formelle et le « bon sens » sont suffisants. Mais au-delà de certaines limites, ils ne sont plus valables – et la dialectique devient absolument nécessaire. A la différence de la logique formelle, qui ne peut pas saisir les contradictions et cherche à les éliminer, la dialectique représente la logique de la contradiction, laquelle constitue un aspect fondamental de la nature et de la pensée. Procédant par analyse, la dialectique révèle ces contradictions et montre comment elles se résolvent. Cependant, de nouvelles contradictions apparaissent toujours, donnant ainsi naissance à une spirale de développement sans fin. On peut voir ce processus dans l’ensemble du développement de la science et de la philosophie, qui progressent à travers la contradiction. Ce n’est pas un hasard : cela reflète la nature de la connaissance humaine, qui est un processus sans fin au cours duquel la solution d’un problème donne immédiatement naissance à de nouveaux problèmes, qui sont à leur tour résolus, et ainsi de suite à l’infini.
Si nous partons de la forme la plus élémentaire de connaissance, au niveau de l’expérience sensible, les limites de la logique formelle et du « bon sens » apparaissent clairement. L’esprit enregistre simplement les faits tels qu’il les trouve. A première vue, les vérités de la perception sensible semblent simples et évidentes. On peut leur faire confiance. Mais un examen plus attentif révèle que les choses ne sont pas aussi simples. Ce qui semble solide et digne de confiance se révèle ne pas l’être. Le sol commence à se dérober sous nos pieds.
La certitude sensible part de l’ici et du maintenant. Or Hegel souligne que la certitude sensible doit elle-même être interrogée :
« qu’est-ce que le ceci ? Prenons-le sous le double aspect de son être comme le maintenant et comme l’ici, alors la dialectique qu’il a en lui prendra une forme aussi intelligible que le ceci même. A la question : qu’est-ce que le maintenant ? nous répondrons, par exemple : le maintenant est la nuit. Pour éprouver la vérité de cette certitude sensible une simple expérience sera suffisante. Nous notons par écrit cette vérité ; une vérité ne perd rien à être écrite et aussi peu à être conservée. Revoyons maintenant à midi cette vérité écrite, nous devrons dire alors qu’elle s’est éventée » (Phénoménologie de l’esprit, op. cit., tome 1, p.83).
Ce commentaire de Hegel rappelle les célèbres paradoxes de Zénon à propos du mouvement. Si par exemple nous cherchons à fixer la position d’une flèche en vol, à dire où elle est maintenant, le moment où nous l’avons pointée est déjà passé et par conséquent ce « maintenant » n’est pas quelque chose qui est, mais quelque chose qui a été. Ainsi, ce qui paraît initialement vrai se transforme en quelque chose de faux. On en trouve la raison dans la nature contradictoire du mouvement lui-même. Le mouvement est un processus, et non une collection de points séparés. De la même manière, le temps consiste en un nombre infini de « maintenant », tous rassemblés. Ou encore : l’« ici » se révèle ne pas être un simple « ici », mais un devant et un derrière, un dessus et un dessous, une droite et une gauche. Ce qui est ici, comme arbre, est la minute suivante ici comme maison, ou quelque chose d’autre.
Pensée dialectique et pensée formelle
L’application correcte de la méthode dialectique exige que le chercheur s’immerge complètement dans l’étude de son objet, en l’examinant de tous les côtés, afin de déterminer ses contradictions internes et les lois qui président à son mouvement. On trouve l’exemple classique de cette méthode dans les trois livres du Capital. Marx n’a pas arbitrairement inventé les lois qui gouvernent le mode de production capitaliste ; il les a tirées d’un effort considérable d’analyse de tous les aspects du capitalisme, en retraçant son développement historique et en suivant le processus de la production marchande dans toutes ses phases.
Dans ses Cahiers philosophiques, qui contiennent une étude détaillée de la Science de la logique de Hegel, Lénine souligne que la première condition de la pensée dialectique est la « détermination du concept à partir de lui-même (la chose elle-même doit être considérée dans ses relations et dans son développement) ». Autrement dit, la méthode dialectique part de « l’objectivité de l’examen (pas des exemples, pas des digressions, mais la chose en elle-même) » (Lénine, Œuvres complètes, tome 38, p.209).
La première et la plus basse forme de la pensée est la perception sensible, c’est-à-dire l’information immédiatement livrée par nos sens – ce que nous voyons, entendons, touchons, etc. Ce qui suit, c’est l’entendement (Verstand), qui tente d’expliquer la réalité d’une façon unilatérale, en enregistrant des faits isolés. En gros, l’entendement est le domaine de la logique formelle, de la pensée ordinaire, du « bon sens ». Nous voyons qu’une chose existe, qu’elle est ce qu’elle est – et rien d’autre. Il semble qu’il n’y ait rien à ajouter, mais, en réalité, il y a encore beaucoup de choses à dire. L’entendement présente les choses comme isolées, fixes et immuables, mais la réalité n’est rien de tout cela.
Il y a une forme plus élevée de la pensée : ce que Hegel (et Kant) nomme la raison (Vernunft). La raison cherche à aller au-delà de ce qu’établit l’entendement, pour dissoudre ce qu’il fige et révéler les contradictions internes derrière les apparences extérieures de solidité. Ces contradictions mèneront, tôt ou tard, à de profondes transformations. « Le combat de la raison consiste à surmonter ce que l’entendement a fixé » (Hegel, Logique de 1830, addition au §32, op. cit., p.487).
Le premier principe de la pensée dialectique est l’objectivité absolue. L’objet étudié doit être abordé objectivement et le résultat final ne doit pas être anticipé. Nous devons nous laisser absorber par l’objet jusqu’à ce que nous saisissions, non pas une série de faits isolés, mais leurs relations internes et les lois qui gouvernent ces relations. A la différence des lois de la logique formelle, les lois de la dialectique ne sont pas des constructions arbitraires susceptibles d’être appliquées de l’extérieur à n’importe quel contenu. Elles ont été tirées de l’observation attentive du développement de la nature, de la société et de la pensée humaine.
Les formes habituelles de pensée – celles de la logique formelle – peuvent être appliquées à n’importe quel objet d’une façon extérieure et arbitraire. Le contenu réel de l’objet leur est indifférent. La logique formelle, telle qu’elle s’exprime dans le principe abstrait d’identité (A = A), semble formuler une vérité indiscutable. Mais en réalité, c’est une tautologie vide, un formalisme monochrome – ou, comme le dit Hegel plaisamment, c’est « la nuit dans laquelle, comme on a coutume de dire, toutes les vaches sont noires – c’est là l’ingénuité du vide dans la connaissance » (Phénoménologie de l’esprit, Préface, op. cit., p.16).
Le principe d’identité est seulement une forme abstraite sans contenu réel, incapable de mouvement ou de développement. Il ne peut être appliqué à la réalité dynamique d’un univers sans repos, dans lequel tout change constamment, naît et meurt, et où aucune chose, par conséquent, ne peut être considérée comme égale à elle-même. De la même manière, le principe de contradiction est faux, parce que toute chose réellement existante contient à la fois le positif et le négatif. Elle est et n’est pas, parce qu’elle change constamment. La seule chose qui ne change pas, c’est le changement lui-même. Toutes les tentatives de figer la vérité, de la présenter comme unilatérale et statique, sont vouées à l’échec. Comme Hegel le disait en plaisantant, la vérité est une bacchanale. D’ailleurs, l’existence de la contradiction se reflète intuitivement dans la conscience populaire sous la forme de proverbes et de dictons (qui, néanmoins, du fait de leur caractère intuitif, non systématique, se contredisent les uns les autres). Par exemple : « la nourriture de l’un est le poison de l’autre ».
En science aussi nous voyons des contradictions à tous les niveaux : par exemple l’attraction et la répulsion, le Nord et le Sud magnétiques, le positif et le négatif en électricité, l’action et la réaction en mécanique, la contraction et l’expansion, etc. Par opposition à la logique formelle, la dialectique ne s’impose pas à la nature ; elle dérive ses catégories de la réalité elle-même. La vraie dialectique n’a rien en commun avec la caricature qu’en font ses détracteurs, qui la présentent comme une rhétorique subjective et arbitraire. Telle était la dialectique des Sophistes, qui, comme la logique formelle, s’applique de l’extérieur à tout contenu, avec l’intention de manipuler les contradictions d’une façon arbitraire. La dialectique n’a rien en commun, non plus, avec la simplification grossière de la « triade » (thèse, antithèse, synthèse), qui fut adoptée par Kant et transformée en une formule sans vie. La vraie dialectique cherche à découvrir, au moyen d’une analyse rigoureusement objective, la logique interne et les lois du mouvement des phénomènes.
La Logique
La Logique de Hegel est l’un des sommets de la pensée humaine. Elle est l’exposé systématique de toutes les formes de la pensée (et de leur développement), depuis les formes les plus primitives jusqu’à la plus haute forme du raisonnement dialectique, celle que Hegel appelle le Concept.
Il part de la proposition la plus générale possible, celle de « l’être pur », qui semble ne requérir aucune preuve. A partir de cette idée extrêmement abstraite, il procède, pas à pas, de l’abstrait au concret.
Ce processus procède par étapes, chaque étape constituant la négation de la précédente. L’histoire de la pensée, en particulier celle de la philosophie et de la science, montre que la connaissance s’acquiert précisément de cette façon, dans un processus incessant au cours duquel on obtient une idée de plus en plus précise des mécanismes de l’univers. Chez Hegel, chaque étape n’est pas plus tôt énoncée qu’elle est niée, et le résultat en est une idée plus élevée, plus riche, plus concrète.
En gros, la Logique de Hegel peut être divisée en trois parties : la Doctrine de l’Être, la Doctrine de l’Essence et la Doctrine du Concept.
Hegel commence par la catégorie la plus fondamentale de la pensée : la catégorie de l’Être. Il est évident que tout ce que nous considérons doit, en premier lieu, exister. Cela semble la base de toute connaissance. Mais les choses ne sont pas si simples. La pure affirmation de l’existence, sans autre détail, ne nous mène pas bien loin. Nous voulons en savoir plus. Mais dès que l’on essaye de passer de l’idée abstraite de l’être à une idée plus concrète, on voit se transformer l’être en son contraire : le néant. Hegel montre que l’être en général – qui ne serait qu’être, donc ni ceci, ni cela, ni autre chose – revient à la même chose que le néant.
Cette idée semble étrange, mais elle se vérifie effectivement à différents niveaux. Si nous essayons d’éliminer des choses toute contradiction, et de nous en tenir à la seule idée qu’elles sont, nous arrivons à la conclusion opposée, parce qu’il ne peut y avoir aucun être sans non-être, de même qu’il ne peut y avoir de vie sans mort ou de lumière sans obscurité. Les gens qui ont passé un certain temps dans l’Arctique savent que l’effet, sur la vision humaine, d’une blancheur absolue, est le même que celui d’une obscurité complète.
On a là une abstraction vide, à laquelle manque tout caractère concret. En réalité, l’unité dialectique de l’être et du néant est le devenir, le processus du changement. C’est ce que voulait dire Héraclite lorsqu’il affirmait que « toute chose est et n’est pas, parce que tout est flux ». Chacun sait d’expérience que les choses sont souvent différentes de ce qu’elles semblent être. Les choses semblent être stables, de telle sorte que nous pouvons dire qu’« elles sont » – mais, à l’examen, elles se révèlent instables et se changent en quelque chose d’autre, de sorte qu’elles « ne sont pas ». De fait, cette contradiction entre l’être et le non-être est la base de toute vie et de tout mouvement.
Chez Hegel, la catégorie de l’être représente le stade primitif et non développé de la pensée. C’est la pensée seulement en puissance, comme la pensée d’un petit enfant. C’est la pensée embryonnaire. Un embryon commence par une seule cellule sans caractéristiques clairement définies. Il n’est pas nettement identifiable comme un être humain. Pour se développer, il doit d’abord se nier lui-même. A l’intérieur de la cellule, il y a des tendances contradictoires qui donnent naissance à un processus de différenciation interne. Quand le conflit de ces tendances atteint un certain point, la cellule se divise en deux. La cellule originale indifférenciée a cessé d’exister ; elle a été supprimée, niée. Et cependant, elle a aussi été conservée et portée à un degré supérieur. Le processus est répété de nombreuses fois ; il donne lieu à une organisation croissante et à une plus grande complexité, avec des caractéristiques plus clairement distinctes, et finalement à un être humain à part entière.
Le point essentiel est que, dans la vie réelle, le côté négatif des choses est aussi important que le côté positif. Nous avons l’habitude de considérer la vie et la mort comme des pôles complètement opposés. Mais en pratique, ce sont les deux parties – inséparables – d’un même processus. Le processus de la vie, de la croissance et du développement ne prend place qu’à travers le renouvellement constant de toutes les cellules de l’organisme, les unes mourant, les autres naissant. Même à son niveau le plus primitif, la vie implique un changement permanent au cours duquel l’organisme absorbe constamment de la nourriture à partir de son environnement et l’utilise pour se construire, en même temps qu’il se débarrasse de déchets. Par conséquent, toute chose vivante est et, en même temps, n’est pas, parce qu’elle est dans un flux constant. Etre exempt de contradiction, c’est être dépourvu de toute différenciation interne, n’avoir aucun mouvement, être dans un état d’équilibre statique – en un mot, être mort.
Comme l’écrivent Prigogine et Stengers : « La cellule vivante est le siège d’une activité métabolique incessante : des milliers de réactions chimiques se produisent simultanément, qui transforment la matière dont la cellule se nourrit, synthétisent ses constituants et rejettent à l’extérieur les produits inutilisables. Cette activité chimique est hautement ordonnée, tant du point de la coordination des différentes vitesses des réactions que de leur localisation dans la cellule. La structure biologique unit ainsi l’ordre et l’activité, en parfait contraste avec les états d’équilibre qui peuvent être ordonnés mais sont inertes » – comme par exemple des cristaux (Prigogine et Stengers, op. cit., p.202).
A première vue, ces observations peuvent apparaître comme d’inutiles subtilités. En réalité, ce sont des réflexions très profondes, qui s’appliquent aussi bien à la pensée qu’à la nature organique. Et bien que ce ne soit pas toujours évident, cela s’applique également à la matière inanimée. « Tout coule, rien ne demeure », disait Héraclite, ou encore : « on ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve ». Hegel dit la même chose. Au cœur de sa philosophie, il y a une vision dynamique de l’univers ; une vision qui traite des choses comme des processus vivants et non comme des objets morts ; qui les traite dans leurs relations essentielles, et non comme des entités indépendantes et autonomes, ou comme des collections arbitraires ; qui les traite comme un tout, qui est davantage que la somme de ses parties.
Quantité et qualité
Toute chose peut être considérée selon deux points de vue : celui de la qualité et celui de la quantité. Le fait que le monde consiste en une somme de processus qui sont en changement constant ne signifie pas que les choses réelles n’ont pas une forme d’existence définie, une identité. Un objet a beau changer, il demeure, dans certaines limites, une forme d’existence qualitativement distincte, différente d’une autre. C’est cette différence qualitative qui donne aux choses leur stabilité, qui les différencie et rend le monde infiniment riche, varié.
Les propriétés d’une chose sont ce qui fait d’elle ce qu’elle est. Mais cette qualité n’est pas réductible à l’addition de ses propriétés distinctes. Celles-ci sont liées à l’objet comme totalité. Ainsi, un être humain n’est pas qu’un assemblage de tissu osseux, de sang, de muscles, etc. La vie elle-même est un phénomène complexe qui ne peut pas être réduit à la somme totale de ses molécules individuelles ; la vie émane des interactions entre ces molécules. Pour user de la terminologie de la théorie de la complexité, la vie est un « phénomène émergent ».
Hegel a étudié en détail la relation du tout et des parties :
« Ainsi par exemple, les membres et les organes d’un corps vivant ne peuvent être considérés simplement comme ses parties, étant donné qu’ils ne sont ce qu’ils sont que dans leur unité et ne se comportent aucunement à l’égard de celle-ci comme indifférents. De simples parties, ces membres et ces organes ne le deviennent que sous les mains de l’anatomiste, qui toutefois n’a plus affaire alors à des corps vivants, mais à des cadavres. Il n’est pas dit par là qu’une telle décomposition, en général, ne devrait pas avoir lieu, mais bien que le rapport extérieur et mécanique du tout et des parties n’est pas suffisant pour la connaissance de la vie organique en sa vérité » (Hegel, Logique de 1830, addition au § 135, op. cit., p.568).
Il vaut la peine de noter que les idées qui ont récemment capté l’imagination d’une section importante de la communauté scientifique – les théories du chaos et de la complexité – furent anticipées de longue date par Hegel, et que, à de nombreux égards, elles reçurent un traitement beaucoup plus approfondi entre ses mains. On en trouve un bon exemple dans son explication de la transformation de la quantité en qualité, suivant laquelle une accumulation de petits changements quantitatifs finit par produire un changement qualitatif soudain.
En plus de la qualité qui définit les caractéristiques essentielles d’un objet, toutes les choses possèdent des caractéristiques quantitatives : un nombre, un volume, une vitesse de ses processus, un certain degré de développement de ses propriétés, etc. L’aspect quantitatif des choses est ce qui permet de les diviser (effectivement ou par raisonnement) en leurs parties constitutives et de les reconstituer de nouveau. Par opposition à la qualité, les changements quantitatifs n’altèrent pas la nature du tout, ni ne causent sa destruction. C’est seulement lorsqu’une certaine limite est franchie – laquelle est différente en chaque cas – que le changement quantitatif cause une brusque transformation qualitative.
En mathématiques, l’aspect quantitatif des choses est séparé de leur contenu et considéré comme indépendant. Le champ d’application extrêmement large des mathématiques à des domaines des sciences de la nature et de la technologie aux contenus très différents s’explique par le fait qu’elles traitent uniquement de relations quantitatives. Là, prétend-on, il est possible de réduire la qualité à la quantité. C’est une erreur fondamentale de la « pensée métaphysique », selon l’expression de Marx et Engels ; et c’est ce que l’on nomme aujourd’hui le réductionnisme. Il n’y a rien dans le monde réel qui consiste seulement en quantité, de même qu’il n’y a rien qui consiste seulement en pure qualité. Tout consiste en réalité dans l’unité de la quantité et de la qualité, que Hegel nomme la mesure.
La mesure est l’unité organique de la quantité et de la qualité. Chaque objet qualitativement distinct, comme on l’a vu, contient des éléments quantitatifs qui sont mobiles et variables. Les organismes vivants croissent dans une certaine limite. Les gaz et les liquides sont affectés par les variations de température. Le comportement d’une gouttelette d’eau ou d’un tas de sable est déterminé par sa taille, et ainsi de suite. Ces changements, toutefois, s’effectuent nécessairement dans certaines limites, différentes en chaque cas, mais qui peuvent ordinairement être découvertes. Au-delà de ces limites, le changement quantitatif entraîne une transformation qualitative. A son tour, le changement qualitatif entraîne un changement des caractères quantitatifs. Il n’y a pas seulement des changements de quantité en qualité, mais aussi l’inverse : des changements qualitatifs produisent des changements quantitatifs. Les points critiques de la transition d’un état à l’autre sont exprimés comme des points nodaux sur la ligne de mesure nodale de Hegel.
L’Essence
La Doctrine de l’Essence est la partie la plus importante de la philosophie de Hegel, car il y explique la dialectique en détail. La pensée humaine ne s’arrête pas à ce qui est immédiatement livré à la perception sensible, mais cherche à aller au-delà et à saisir la chose en soi. Au-delà de son apparence, nous cherchons l’essence d’une chose, mais elle n’est pas immédiatement accessible. Nous pouvons voir le soleil et la lune, mais nous ne pouvons pas « voir » les lois de la gravité. Pour aller au-delà de l’apparence, l’esprit doit être actif et ne pas se contenter de ce qui a d’abord été analysé et figé par l’entendement. Le raisonnement dialectique dissout ce qui « est ». Il révèle les contradictions internes qui détruiront inévitablement la chose.
La contradiction qui gît au cœur de toutes choses est exprimée par l’idée de l’unité des contraires. Dialectiquement, des phénomènes qui semblent mutuellement exclusifs sont en réalité inséparables, comme l’explique Hegel :
« Dans le positif et le négatif, on croit avoir une différence absolue. Tous deux sont cependant en soi la même chose, et c’est pourquoi l’on pourrait appeler le positif aussi le négatif, et de même, inversement, le négatif le positif. Ainsi, biens et dettes eux aussi ne sont pas deux espèces de biens particulières, subsistant pour elles-mêmes. Cela même qui chez l’un, en tant que débiteur, est un négatif, est chez l’autre, le créancier, un positif. Il en est de même avec un chemin allant vers l’est, qui est en même temps un chemin allant vers l’ouest. Positif et négatif sont donc essentiellement conditionnés l’un par l’autre, et ne sont donc que dans leur relation l’un à l’autre. Le pôle nord dans l’aimant ne peut être sans le pôle sud, et le pôle sud sans le pôle nord. Si l’on partage un aimant, on n’a pas en l’un des morceaux le pôle nord et en l’autre le pôle sud. De même ensuite aussi en électricité, l’électricité positive et l’électricité négative ne sont pas deux fluides divers, subsistant pour eux-mêmes » (Logique de 1830, addition au §119, op. cit., p.554).
Dans le processus de l’analyse, Hegel énumère une série d’étapes importantes : positif et négatif ; nécessité et accident ; quantité et qualité ; forme et contenu ; action et répulsion, etc. L’un des caractères centraux de l’Essence est qu’elle est relative : chaque chose est reliée à une autre chose, dans un réseau d’interaction universel. La loi fondamentale de la connaissance élémentaire (celle de l’entendement) est le principe d’identité (A = A). C’est généralement considéré comme la base de tout ce que nous savons, et, jusqu’à un certain point, c’est exact. Sans le principe d’identité, la pensée cohérente serait impossible. Grâce à ce principe, nous vérifions le fait fondamental de l’existence et focalisons notre attention sur une chose particulière. Toutefois, l’identité présuppose la différence. Un chat est un chat parce qu’il n’est pas un chien, une souris, un éléphant, et ainsi de suite. Afin d’établir l’identité d’une chose, nous devons la comparer à une autre.
Dans la vie réelle, rien n’est purement soi-même – contrairement à ce que suppose le caractère apparemment absolu du principe d’identité. Toute chose est déterminée par quelque chose d’autre. En ce sens, toute chose est relative. Comme Engels le remarquait :
« La vraie nature des déterminations de “l’essence” est énoncée par Hegel lui-même (Logique de 1830, addition au §111) : “Dans l’essence tout est relatif” (par exemple, le positif et le négatif qui n’ont un sens que dans leur rapport, et non chacun pour soi) » (Dialectique de la nature, Ed. Sociales, p.215).
Ce n’est pas tout. Rien n’est simple, contrairement à ce qu’implique le principe d’identité. Nous le voyons à propos de la simple cellule ou de l’embryon : l’être concret, en tant qu’il s’oppose à l’être purement abstrait de la simple « identité », doit contenir une différenciation interne. De plus, cette différenciation contient les germes de la contradiction. Afin de se développer et de vivre, la cellule doit contenir la tendance à l’auto-dissolution, à la division, à la négation. Cette tension interne est en fait la base de toute vie, mais on la trouve aussi dans des objets inorganiques, comme par exemple le phénomène de surface de tension dans une goutte d’eau, qui retient les molécules en un certain ordre. On pourrait citer bien d’autres exemples.
L’effort pour bannir la contradiction de la pensée a obsédé les logiciens pendant des siècles. Hegel fut le premier à montrer qu’en fait la contradiction gît au cœur de toute chose réellement existante. Si nous essayons de penser le monde sans contradiction, comme la logique traditionnelle tente de le faire, nous ne parvenons qu’à introduire d’insolubles contradictions dans la pensée. Telle fut la véritable signification des « antinomies » kantiennes. Séparer identité et différence, chercher à nier l’existence de la contradiction, conduit la pensée à un formalisme stérile et vide.
L’apparence et l’essence
Beaucoup de gens s’aperçoivent que « l’apparence est trompeuse ». Cependant, ce n’est que relativement vrai. Pour parvenir à la compréhension de l’essence d’une chose, on doit précisément commencer par prendre une connaissance complète de son apparence, c’est-à-dire de toutes les caractéristiques physiques, propriétés et tendances que l’on peut observer. Au cours d’une telle analyse, il devient clair que certains éléments peuvent être omis comme inessentiels, et progressivement on arrivera aux caractéristiques les plus fondamentales de l’objet considéré.
Il est courant de dire à propos de quelqu’un : « soit, mais il n’est pas réellement comme cela ». On veut dire par là que les gens ne sont pas en réalité ce qu’ils paraissent. L’apparence est une chose, mais l’essence est supposée en être une autre toute différente. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai. Si nous connaissons très mal une personne, il est vrai qu’il n’est pas possible de nous en faire une idée exacte sur la base de sa conduite – qui peut, à l’occasion, ne pas lui ressembler du tout. Mais lorsque nous connaissons les gens depuis longtemps, nous avons un motif suffisant de croire que nous les connaissons tels qu’ils sont. Nous nous fondons précisément sur les « apparences », parce qu’il n’y a rien d’autre sur quoi nous fonder. La Bible dit : « à leurs fruits, vous les reconnaîtrez », et c’est juste. Un homme ou une femme sont tels qu’ils vivent et agissent. Il n’y a rien d’autre à rechercher.
L’erreur fondamentale de Kant, précisément, résidait dans le fait de dresser une frontière entre les apparences et une mystérieuse « chose en soi » se situant au-delà de l’expérience – et censée être pour toujours inaccessible au savoir humain. En réalité, dès que nous connaissons toutes les propriétés d’une chose, nous connaissons la chose elle-même. Nous pouvons très bien être limités à un certain moment par notre manque d’informations, mais, en principe, rien n’est à jamais inaccessible à la connaissance humaine, sauf une chose : tout connaître d’un univers infini. Il n’y a pas de limitation intrinsèque à la connaissance, mais simplement une relation dialectique entre la nature finie des individus et un univers infini qui est constamment en train de révéler de nouveaux secrets. Et bien que le savoir particulier d’une personne soit fini, d’une génération à l’autre la somme totale de la connaissance et de la compréhension de l’humanité s’accroît. Le processus d’apprentissage est sans fin. C’est précisément en cela que résident sa beauté et son caractère fascinant.
Nous partons de ce qui est connu pour découvrir ce qui ne l’est pas. Une chose mène à une autre. Un médecin, s’appuyant sur tout son savoir médical et son expérience passée, examine soigneusement tous les symptômes visibles et parvient à un diagnostic. Un marin étudiera le vent et les marées afin d’évaluer les possibilités de sortir en mer. En ce sens, l’essence se manifeste à travers l’apparence, même s’il faut de l’habileté et de l’intelligence pour passer de l’une à l’autre.
Lorsqu’on étudie des phénomènes sociaux, l’une des plus graves erreurs consiste à les aborder comme s’ils étaient statiques et figés – autrement dit, du point de vue de la logique formelle. On rencontre souvent des gens qui font une « sagesse pratique » de leurs préjugés et de leur étroitesse d’esprit. Ils affirment que « les gens ne changeront jamais », que « les choses seront toujours comme elles sont » et qu’« il n’y a rien de neuf sous le soleil ». Cette pensée superficielle se donne des airs de profondeur, mais ne signale en réalité que de l’ignorance satisfaite d’elle-même. Aucune justification rationnelle n’est donnée à l’appui de ces affirmations. Occasionnellement, il y a une tentative de leur donner une base biologique, avec de vagues références à quelque chose qu’on appelle la « nature humaine ». Mais tout ce que de telles idées révèlent, c’est que leurs auteurs ne connaissent ni les hommes, ni leur nature.
Cette mentalité est strictement limitée par une expérience étroite du monde des apparences au sens le plus superficiel. C’est tout à fait comme un homme qui patinerait sans cesse à la surface d’un lac gelé, sans jamais s’enquérir de l’épaisseur de la glace. Il pourrait s’en tirer la plupart du temps – jusqu’à ce qu’il se noie dans l’eau glacée. A ce moment précis, il se rendra compte que, peut-être, la glace n’était pas aussi solide qu’elle semblait l’être.
« A = A ». Vous êtes vous. Je suis moi. Les gens sont les gens. Un dollar est un dollar. La société est la société. Les syndicats sont les syndicats. De telles phrases semblent rassurantes, mais en fait elles sont vides de tout contenu. Si tant est qu’elles signifient quoi que ce soit, elles expriment l’idée que tout est ce qu’il est et que rien ne change. Or l’expérience nous apprend qu’il n’en va pas ainsi. Les choses changent constamment et, à un certain point critique, de petits changements quantitatifs peuvent produire des transformations massives.
La forme et le contenu
Il y a de nombreuses contradictions au sein des choses. Par exemple, la contradiction entre la forme et le contenu. N’importe quel jardinier sait qu’une graine soigneusement plantée dans un pot produira une plante. Initialement, le pot protège le jeune plant et l’aide à prospérer. Mais à un certain stade, les racines prennent trop de place. Le jardinier doit retirer la plante du pot, faute de quoi elle périra. De même, l’embryon humain est protégé par le ventre maternel pendant neuf mois. Au terme du neuvième mois, un stade critique est atteint : soit le bébé est séparé du corps de sa mère, soit les deux sont condamnés à périr. Ce sont là des exemples assez simples, faciles à comprendre, de la contradiction entre forme et contenu. Un autre exemple est la façon dont les forces telluriques s’accumulent, sous la croûte terrestre, jusqu’à produire un tremblement de terre.
Des forces similaires s’accumulent au sein de la société, qui a elle aussi ses « lignes de faille ». L’action de ces forces n’est pas plus visible, en surface, que celle qui cause un séisme. Aux yeux de l’observateur superficiel, rien ne se passe. Tout est « normal ». L’observateur avisé, cependant, est capable de détecter les symptômes de l’activité souterraine de la société, exactement comme un géologue compétent peut lire un sismographe. Trotsky disait de la théorie qu’elle est la supériorité de la prévision sur l’étonnement. Le sort de la pensée superficielle, empirique, est d’être constamment étonnée – à la façon du patineur que nous évoquions, ci-dessus, sous le poids duquel la glace finit par céder. C’est le prix à payer pour confondre l’apparence avec l’essence, ou la forme avec le contenu.
L’essence d’une chose est la totalité organique de ses propriétés les plus fondamentales. La tâche de l’analyse dialectique est de les déterminer. En chaque cas on trouvera qu’il existe une contradiction potentielle entre l’état présent et ce qui tend à le dissoudre. En mécanique classique, l’idée d’un équilibre parfait joue un rôle central. Les choses tendent à retourner à l’équilibre. C’est, du moins, ce qui vaut en théorie. Dans la vie réelle, un équilibre parfait est quelque chose de rare. A chaque fois qu’un équilibre est atteint, il tend à n’être que temporaire et instable. C’est ce que présupposent le développement et le changement. Au service de soins intensifs d’un hôpital, lorsque l’électrocardiogramme d’un patient atteint un état d’« équilibre » (une ligne droite), celle signifie la mort de l’organisme.
Quand on se réfère aux propriétés d’une chose, l’usage est d’employer le verbe « avoir » (le feu « a » la propriété de brûler ; un être humain « a » les propriétés de respirer, de penser, de manger, etc.). C’est là une source d’erreurs. Un enfant « a » une glace. Une femme « a » un chien. La relation est ici accidentelle et extérieure, puisque l’enfant et la femme pourraient aussi bien ne pas « avoir » ces choses – et néanmoins demeurer un enfant et une femme. Une chose n’« a » pas des propriétés ; elle est l’ensemble de ses propriétés. Si elles sont ôtées, il ne reste plus rien, et c’est à ce rien que correspond, finalement, la « chose-en-soi » de Kant. C’est là une idée extrêmement importante, qui commence tout juste à être comprise des scientifiques. Le tout ne peut pas être réduit à la somme de ses parties, car en entrant dans une relation dynamique, les parties elles-mêmes se transforment et donnent naissance à une situation entièrement nouvelle, gouvernée par des lois qualitativement différentes.
On peut vérifier ce phénomène dans le champ social. Trotsky remarquait que la classe ouvrière, sans organisation, n’est que de « la matière brute à exploiter ». Cela se voit très bien de nos jours, lorsque les syndicats sont éliminés ou affaiblis sur de nombreux lieux de travail. Historiquement, le mouvement des travailleurs en vue de leur organisation entraîne une transformation complète de la situation. La quantité se transforme en qualité. Alors que les travailleurs sont, à titre individuel, impuissants, la classe organisée comme classe dispose d’une puissance colossale, au moins potentiellement. Pas une roue ne tourne, pas un téléphone ne sonne, pas une ampoule ne brille sans l’aimable permission de la classe ouvrière. En termes hégéliens, la classe ouvrière, avant qu’elle ne s’organise, n’est qu’une classe « en soi » (un potentiel non réalisé). Une fois qu’elle est organisée et consciente de sa force, elle devient une classe « pour soi ». Bien sûr, Hegel était loin de tirer des conclusions aussi explicitement révolutionnaires de sa méthode dialectique. Idéaliste, son souci majeur était de présenter la dialectique comme le processus de développement de l’Esprit. Chez lui, les relations réelles sont mises à l’envers, et le monde réel est présenté sous une forme mystifiée. Mais le vrai contenu trouve constamment son chemin à travers le dense brouillard de l’idéalisme, comme les rayons du soleil à travers les nuages.
Par essence, tout est relatif, comme le soulignait Engels. Les choses sont ce qu’elles sont grâce à leurs rapports avec d’autres choses. On peut le voir dans la société. Des choses que l’on tient couramment pour des entités réelles sont, en fait, le produit de relations particulières qui ont imprégné si profondément la conscience populaire qu’elles acquièrent la force d’un préjugé. C’est le cas, par exemple, de l’institution monarchique :
« Les esprits naïfs », écrivait Trotsky, « pensent que le titre de roi tient dans la personne même du roi, dans son manteau d’hermine et sa couronne, dans sa chair et son sang. En fait, le titre de roi naît des rapports entre les hommes. Le roi n’est roi que parce qu’à travers sa personne se réfractent les intérêts et les préjugés de millions d’hommes. Quand ces rapports sont érodés par le torrent du développement, le roi n’est plus qu’un homme usé, à la lèvre inférieure pendante. Celui qui s’appelait jadis Alphonse XIII pourrait nous fait part de ses impressions toutes fraîches sur ce sujet.
« Le chef par la grâce du peuple se distingue du chef par la grâce de Dieu, en ce qu’il est obligé de se frayer lui-même un chemin ou, du moins, d’aider les circonstances à le lui ouvrir. Mais le chef est toujours un rapport entre les hommes, une offre individuelle en réponse à une demande collective. Les discussions sur la personnalité d’Hitler sont d’autant plus animées qu’elles cherchent avec plus de zèle le secret de sa réussite en lui-même. Il est pourtant difficile de trouver une autre figure politique qui soit, dans la même mesure, le point convergent de forces historiques impersonnelles. N’importe quel petit bourgeois enragé ne pouvait pas devenir Hitler, mais une partie d’Hitler est contenue dans chaque petit bourgeois enragé. » (Qu’est-ce que le national-socialisme ?)
Nécessité et accident
En analysant la nature de l’être dans toutes ses manifestations, Hegel traite de la relation entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, ou encore entre la nécessité et l’accident (la « contingence »). Ici, pour commencer, il faut clarifier l’une des formules les plus célèbres de Hegel : « ce qui est rationnel est réel et ce qui réel (effectif) est rationnel » (Préface des Principes de la Philosophie du droit).
A première vue, cette affirmation a tout l’air d’être une mystification réactionnaire, puisqu’elle semble impliquer que tout ce qui existe est rationnel – et donc justifié. Ce n’était pourtant pas ce que Hegel voulait dire, comme Engels l’a expliqué :
« Or, la réalité n’est aucunement, d’après Hegel, un attribut qui revient de droit en toutes circonstances et en tout temps à un état de choses social ou politique donné. Tout au contraire. La République romaine était réelle, mais l’Empire romain qui la supplanta ne l’était pas moins. La monarchie française de 1789 était devenue si irréelle, c’est-à-dire si dénuée de toute nécessité, si irrationnelle, qu’elle dut être nécessairement abolie par la grande Révolution dont Hegel parle toujours avec le plus grand enthousiasme. Ici la monarchie était par conséquent l’irréel et la Révolution le réel. Et ainsi, au cours du développement, tout ce qui précédemment était réel devient irréel, perd sa nécessité, son droit à l’existence, son caractère rationnel ; à la réalité mourante se substitue une réalité nouvelle et viable, d’une manière pacifique, si l’ancien état de choses est assez raisonnable pour mourir sans résistance, violente s’il se regimbe contre cette nécessité. Et ainsi la thèse de Hegel se tourne, par le jeu de la dialectique hégélienne elle-même, en son contraire : tout ce qui est réel dans le domaine de l’histoire humaine devient, avec le temps, irrationnel, est donc déjà par destination irrationnel, entaché d’avance d’irrationalité : et tout ce qui est rationnel dans la tête des hommes est destiné à devenir réel, aussi en contradiction que cela puisse être avec la réalité apparemment existante. La thèse de la rationalité de tout le réel se résout, selon toutes les règles de la dialectique hégélienne, en cette autre : Tout ce qui existe mérite de périr » (Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, I).
Une forme déterminée de société est « rationnelle » dans la mesure où elle atteint ses buts, développe les forces productives, élève le niveau de culture, et dès lors fait progresser l’humanité. Si elle n’est plus à même de jouer ce rôle, elle entre en contradiction avec elle-même, c’est-à-dire qu’elle devient dépourvue de rationalité et de réalité ; elle n’a plus désormais aucun droit d’exister. Ainsi, même dans les formules apparemment les plus réactionnaires de Hegel, une idée révolutionnaire se cache.
Tout ce qui existe, existe évidemment par nécessité. Mais tout ne peut pas exister. L’existence potentielle n’est pas l’existence en acte. Dans la Science de la logique, Hegel retrace avec soin le processus par lequel quelque chose passe du stade de simple possible à celui où la possibilité devient probabilité, pour arriver à ce point où elle devient inévitable (« nécessité »). Au vu de l’énorme confusion qui règne dans la science moderne à propos de la « probabilité », il est hautement instructif d’étudier la façon – sérieuse et profonde – dont Hegel traite cette question.
La possibilité et l’actualité désignent le développement dialectique du monde réel, les différentes étapes de l’émergence et du développement des objets. Une chose qui existe en puissance contient en elle-même la tendance objective de son développement, ou du moins l’absence de conditions qui empêcheraient son apparition. Cependant, il existe une différence entre la possibilité abstraite et le potentiel réel, et les deux choses sont souvent confondues. La possibilité abstraite ou formelle exprime simplement l’absence de toute condition qui pourrait exclure un phénomène particulier, mais elle ne suppose pas la présence de conditions qui rendraient son apparition inévitable.
Cela conduit à une totale confusion qui sert à justifier toutes sortes d’idées absurdes et arbitraires. Par exemple, on dit que si un singe pouvait marteler une machine à écrire pendant un temps indéfini, il finirait par produire l’un des sonnets de Shakespeare. Cet objectif semble trop modeste. Pourquoi un seul sonnet ? Pourquoi pas les œuvres complètes de Shakespeare ? Et tant qu’à faire, pourquoi pas l’ensemble de la littérature mondiale, avec la théorie de la relativité générale et, pour faire bonne mesure, les symphonies de Beethoven ? La simple affirmation que c’est « statistiquement possible » ne nous fait pas avancer d’un seul pas. Les processus complexes de la nature, de la société et de la pensée humaine ne sont pas tous susceptibles d’un simple traitement statistique, et de grandes œuvres littéraires ne peuvent pas émerger d’un simple accident, quel que soit le temps qu’on accorde à notre singe pour les écrire.
Pour que le potentiel devienne réel, un enchaînement particulier de circonstances est requis. De plus, ce n’est pas un processus simple et linéaire, mais un processus dialectique, dans lequel une accumulation de petits changements quantitatifs finit par produire un saut qualitatif. La possibilité réelle, par opposition à l’abstraite, implique la présence de tous les facteurs nécessaires au moyen desquels le potentiel perdra son caractère de potentialité et deviendra actuel. Et comme l’explique Hegel, il ne restera actuel qu’aussi longtemps que ces conditions existent, et pas davantage. C’est vrai de la vie d’un individu, d’une forme socio-économique donnée, d’une théorie scientifique ou de n’importe quel phénomène naturel. Le point à partir duquel un changement devient inévitable peut être déterminé par la méthode inventée par Hegel et connue sous le nom de « ligne nodale de mesure ». Si nous considérons un processus comme une ligne, on verra qu’il y a des points spécifiques (« points nodaux »), sur la ligne de développement, où le processus connaît une accélération soudaine, un saut qualitatif.
Il est facile d’identifier la cause et l’effet dans des cas isolés, comme quand on frappe une balle avec son pied. Mais en un sens plus large, la notion de causalité devient beaucoup plus compliquée. Les causes et les effets individuels se perdent dans un vaste océan d’interactions, où la cause se transforme en effet et vice versa. Essayez simplement de remonter de l’événement le plus simple jusqu’à ses « causes ultimes » et vous verrez que l’éternité n’y suffira pas. Il y aura toujours une nouvelle cause, qui à son tour devra être expliquée, et ainsi de suite à l’infini. Ce paradoxe est entré dans la conscience populaire à travers des dictons tels que celui-ci : « Parce qu’un clou manqua, un fer fut perdu ; parce qu’un fer manqua, un cheval fut perdu ; parce qu’un cheval manqua, un cavalier fut perdu ; parce qu’un cavalier manqua, une bataille fut perdue ; parce qu’une bataille fut manquée, un royaume fut perdu ; ... et tout cela parce qu’un clou avait manqué. »
L’impossibilité d’établir une « cause finale » a conduit certains à abandonner complètement l’idée de cause. Tout est alors considéré comme aléatoire et accidentel. Au XXe siècle, cette position a été adoptée, au moins en théorie, par un grand nombre de scientifiques, sur la base d’une interprétation incorrecte des résultats de la physique quantique. C’est le cas, en particulier, de la position philosophique de Werner Heisenberg, que nous avons longuement critiquée dans La Raison en révolte. Ici, il suffit de souligner que Hegel a répondu à l’avance aux arguments de Heisenberg, en expliquant la relation dialectique entre accident et nécessité.
Hegel explique qu’il n’existe pas de véritable causalité au sens d’une cause et d’un effet isolés. Chaque effet a un contre-effet, chaque action une contre-action. L’idée d’une cause et d’un effet isolés est une abstraction tirée de la physique newtonienne classique, à l’égard de laquelle Hegel était très critique, alors qu’elle jouissait d’un énorme prestige à son époque. Là encore, Hegel était en avance sur son temps. Au lieu de l’action-réaction de la mécanique, il a avancé la notion de réciprocité, d’interaction universelle. Tout influence tout, et tout est à son tour influencé, déterminé par tout. Ainsi, Hegel a réintroduit le concept d’accident, qui avait été rigoureusement banni de la science par la philosophie mécaniste de Newton et Laplace.
A première vue, nous semblons être noyés dans une masse d’accidents. Mais cette confusion n’est qu’apparente. L’ordre émerge du chaos. Les phénomènes accidentels qui apparaissent et disparaissent constamment, comme les vagues à la surface d’un océan, expriment un processus plus profond, qui n’est pas accidentel, lui, mais nécessaire. A un moment décisif, la nécessité se révèle à travers l’accident.
Cette idée de l’unité dialectique de la nécessité et de l’accident peut paraître étrange, mais elle est remarquablement confirmée par toute une série d’observations dans les domaines les plus variés de la science et de la société. Le mécanisme de sélection naturelle, dans la théorie de l’évolution, en est l’exemple le plus connu. Mais il y en a beaucoup d’autres. Ces 50 dernières années, il y a eu de nombreuses découvertes, dans le domaine des théories du chaos et de la complexité, qui détaillent précisément comment « l’ordre naît du chaos », soit exactement ce que Hegel a élaboré un siècle et demi plus tôt.
Les réactions chimiques « classiques » sont considérées comme des processus très aléatoires. Les molécules impliquées sont uniformément réparties dans l’espace, et leur propagation est distribuée « normalement », c’est-à-dire selon une courbe de Gauss. Ces types de réactions sont conformes au concept de Boltzmann, selon lequel toutes les réactions en chaîne latérales disparaîtront et la réaction se terminera par une réaction stable, un équilibre immobile. Cependant, au cours des dernières décennies, des réactions chimiques ont été découvertes qui s’écartent de ce concept idéal et simplifié. Elles sont connues sous le nom d’« horloges chimiques ». Les exemples les plus connus en sont la réaction Belousov-Zhabotinsky et le modèle bruxellois imaginé par Ilya Prigogine.
La thermodynamique linéaire décrit un comportement stable et prévisible des systèmes qui tendent vers le niveau minimum d’activité possible. Cependant, lorsque les forces thermodynamiques agissant sur un système atteignent le point où la région linéaire est dépassée, la stabilité ne peut plus être supposée. De la turbulence se produit. Longtemps, la turbulence a été considérée comme synonyme de désordre ou de chaos. Mais depuis peu, on a découvert que ce qui semble n’être qu’un désordre chaotique au niveau macroscopique (à grande échelle) est, en fait, très organisé au niveau microscopique (à petite échelle).
Aujourd’hui, l’étude des instabilités chimiques est devenue courante. Tout particulièrement intéressantes sont les recherches menées à Bruxelles par Ilya Prigogine, théoricien du chaos, sur le phénomène des « horloges chimiques ». L’étude de ce qui se passe au-delà du point critique où commence l’instabilité chimique présente un énorme intérêt du point de vue de la dialectique. Le modèle bruxellois (surnommé le « Brusselator » par les scientifiques américains) décrit le comportement des molécules de gaz. Supposons qu’il existe deux types de molécules, « rouge » et « bleue », dans un état de mouvement chaotique et totalement aléatoire. On s’attendrait à ce qu’à un moment donné, il y ait une distribution irrégulière des molécules, produisant une couleur « violette », avec des éclairs occasionnels de rouge ou de bleu. Mais dans une horloge chimique, cela ne se produit pas au-delà du point critique. Le système est tout bleu, puis tout rouge, et ces changements se produisent à intervalles réguliers.
Prigogine et Stengers écrivent :
« Un tel degré d’ordre issu de l’activité de milliards de molécules semble incroyable, et en effet, si l’horloge chimique n’avait pas été observée, personne ne croirait qu’un tel processus est possible. Pour changer de couleur d’un seul coup, les molécules doivent avoir un moyen de “communiquer”. Le système doit agir dans son ensemble. Nous reviendrons à plusieurs reprises sur ce mot clé, communiquer, qui revêt une importance évidente dans tant de domaines, de la chimie à la neurophysiologie. Les structures dissipatives introduisent probablement l’un des mécanismes physiques de communication les plus simples. » (Prigogine et Stengers, op cit. p.148 de l’édition anglaise).
Le phénomène de « l’horloge chimique » montre comment, dans la nature, l’ordre peut surgir spontanément du chaos, à un certain stade. C’est une observation importante, particulièrement en relation avec la manière dont la vie naît de la matière inorganique. « Les modèles de “l’ordre à travers les fluctuations” introduisent à un monde instable où les petites causes peuvent avoir de grands effets, mais ce monde n’est pas arbitraire. Au contraire, les raisons de l’amplification d’un petit événement sont une question légitime pour une enquête rationnelle » (op cit., p.206).
Nous devons nous rappeler que Hegel écrivait au début du XIXe siècle, lorsque la science était complètement dominée par la physique mécanique classique, et un demi-siècle avant que Darwin ne développe l’idée de la sélection naturelle par le biais de mutations aléatoires. Il n’avait aucune preuve scientifique pour étayer sa théorie selon laquelle la nécessité s’exprime à travers l’accident. Or c’est l’idée centrale de la pensée novatrice la plus récente, en science.
Cette loi profonde est également fondamentale pour la compréhension de l’histoire. Comme Marx l’écrivait à Kugelmann en 1871 :
« Il serait certes fort commode de faire l’histoire universelle si on n’engageait la lutte qu’à condition d’avoir des chances infailliblement favorables. Cette histoire serait par ailleurs de nature fort mystique si les “hasards” n’y jouaient aucun rôle. Naturellement, ces hasards entrent dans le cadre de la marche générale de l’évolution et sont compensés à leur tour par d’autres hasards. Mais l’accélération ou le ralentissement du mouvement dépendent beaucoup de “hasards” de ce genre – et parmi eux figure aussi cet autre “hasard” : le caractère des gens qui se trouvent d’abord à la tête du mouvement. » (Lettres à Kugelmann, Editions sociales 1976, lettre du 17 avril 1871).
Engels a fait la même remarque quelques années plus tard à propos du rôle des « grands hommes » en histoire :
« Les hommes font eux-mêmes leur histoire, mais jusqu’ici pas avec une volonté générale suivant un plan d’ensemble, même lorsqu’il s’agit d’une société donnée et tout à fait isolée. Leurs efforts s’entrecroisent et, justement à cause de cela, dans toutes ces sociétés domine la nécessité dont le hasard est le complément et la manifestation. La nécessité qui se fait jour à travers tous les hasards, c’est de nouveau finalement la nécessité économique. Ici il nous faut parler des soi-disant grands hommes. Que tel grand homme et précisément celui-ci apparaisse à tel moment, dans tel pays, cela n’est évidemment que pur hasard. Mais supprimons-le, il y a demande pour son remplacement et ce remplacement se fait tant bien que mal, mais il se fait à la longue. » (Lettre à Borgius du 25 janvier 1894).
Le Concept
Dans la dialectique de Hegel, la réalisation suprême de la pensée est le Concept. Le développement du concept est décrit par Hegel comme un processus qui va de l’abstrait au concret. Cela signifie un approfondissement des connaissances et un développement d’un degré inférieur à un degré supérieur de compréhension. Au début, le concept est dit « en soi », ou implicite. Il est développé plus tard et devient le concept « pour soi », ou explicite. Dans sa forme la plus élevée, c’est l’union des deux aspects : « en et pour soi ». Dans le concept, le processus de développement atteint son point culminant. Ce qui n’était qu’implicite, au début, devient alors explicite. C’est un retour au point de départ, mais à un niveau qualitativement plus élevé.
Dans son œuvre majeure, la Science de la logique, Hegel ne s’arrête pas au concept, mais passe à l’Idée Absolue – dont tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il ne nous en dit absolument rien. Cela est typique des contradictions dans lesquelles l’idéalisme de Hegel l’a amené. La dialectique ne peut conduire à une idée absolue, ni à aucune autre solution ultime. L’idée qu’il y aurait une fin au processus de connaissance humaine entre en conflit avec la lettre et l’esprit de la dialectique. La philosophie hégélienne est donc tombée dans une contradiction insoluble. Celle-ci ne pouvait être résolue que par une rupture radicale avec toute la philosophie précédente.
La valeur historique de la philosophie de Hegel réside dans le fait qu’en résumant toute l’histoire de la philosophie d’une manière aussi complète, il a rendu impossible d’aller plus loin dans les cadres philosophiques traditionnels. Deuxièmement, la méthode dialectique, qu’il a perfectionnée, a fourni la base d’une toute nouvelle vision du monde, qui ne se limitait pas à l’analyse et à la critique des idées, mais rendait possibles une analyse de l’histoire de la société et une critique révolutionnaire de l’ordre social existant.
Dans son Anti-Dühring, Engels écrivait :
« Que Hegel n’ait pas résolu le problème qu’il s’était posé importe peu ici. Son mérite, qui fait époque, est de l’avoir posé. Ce problème est précisément de ceux qu’aucun individu à lui seul ne pourra jamais résoudre. Bien que Hegel fût – avec Saint-Simon – la tête la plus encyclopédique de son temps, il était tout de même limité, d’abord par l’étendue nécessairement restreinte de ses propres connaissances, ensuite par l’étendue et la profondeur également restreintes des connaissances et des vues de son époque. Mais il faut tenir compte encore d’une troisième circonstance. Hegel était idéaliste, ce qui veut dire qu’au lieu de considérer les idées de son esprit comme les reflets plus ou moins abstraits des choses et des processus réels, il considérait à l’inverse les objets et leur développement comme de simples copies réalisées de l’“Idée” existant on ne sait où dès avant le monde. De ce fait, tout était mis sur la tête et l’enchaînement réel du monde entièrement inversé. Et bien que Hegel eût appréhendé mainte relation particulière avec tant de justesse et de génie, les raisons indiquées rendaient inévitable que le détail aussi tourne souvent au ravaudage, à l’artifice, à la construction, bref, à la perversion du vrai. Le système de Hegel comme tel a été un colossal avortement – bien que le dernier du genre. En effet, ne souffrait-il pas toujours d’une contradiction interne incurable ? D’une part, son postulat essentiel était la conception historique selon laquelle l’histoire de l’humanité est un processus évolutif qui, par nature, ne peut trouver sa conclusion intellectuelle dans la découverte d’une prétendue vérité absolue ; mais, d’autre part, il prétend être précisément la somme de cette vérité absolue. Un système de connaissance de la nature et de l’histoire embrassant tout et arrêté une fois pour toutes est en contradiction avec les lois fondamentales de la pensée dialectique ; ce qui toutefois n’exclut nullement, mais implique, au contraire, que la connaissance systématique de l’ensemble du monde extérieur puisse marcher à pas de géant de génération en génération. » (Anti-Dühring, Introduction, I – Généralités, op. cit.).
La dialectique de Hegel a été brillamment conçue, mais a finalement échoué, car elle était limitée au domaine de la pensée. Néanmoins, elle contenait le potentiel d’un changement majeur dans la pensée, qui allait modifier radicalement non seulement l’histoire de la philosophie, mais celle du monde. Pour paraphraser Hegel, ce qui était présent en soi (c’est-à-dire potentiellement) dans son œuvre est devenu une idée réalisée, une idée en soi et pour soi, dans la doctrine révolutionnaire du marxisme, où la philosophie abandonne finalement son caractère d’activité mentale unilatérale et abstraite, et entre dans le domaine de la pratique.
Aristote avait déjà expliqué la relation entre le potentiel et le réel. A tous les niveaux de la nature, de la société, de la pensée, et même au niveau du développement des êtres humains individuels, de l’enfance à la maturité, nous assistons au même processus. Tout ce qui existe contient en lui-même le potentiel d’un développement ultérieur, c’est-à-dire la faculté de se perfectionner, de devenir quelque chose de différent de ce qu’il est. Toute l’histoire humaine peut être vue comme la lutte de l’humanité pour réaliser son potentiel. En fin de compte, le but du socialisme est de créer les conditions nécessaires pour que cet objectif puisse être finalement réalisé, que les hommes et les femmes puissent réellement devenir ce qu’ils ont toujours été potentiellement. Ici, cependant, nous avons déjà quitté le bureau faiblement éclairé du philosophe – et sommes sortis au grand jour de la vie humaine, de l’activité et de la lutte.