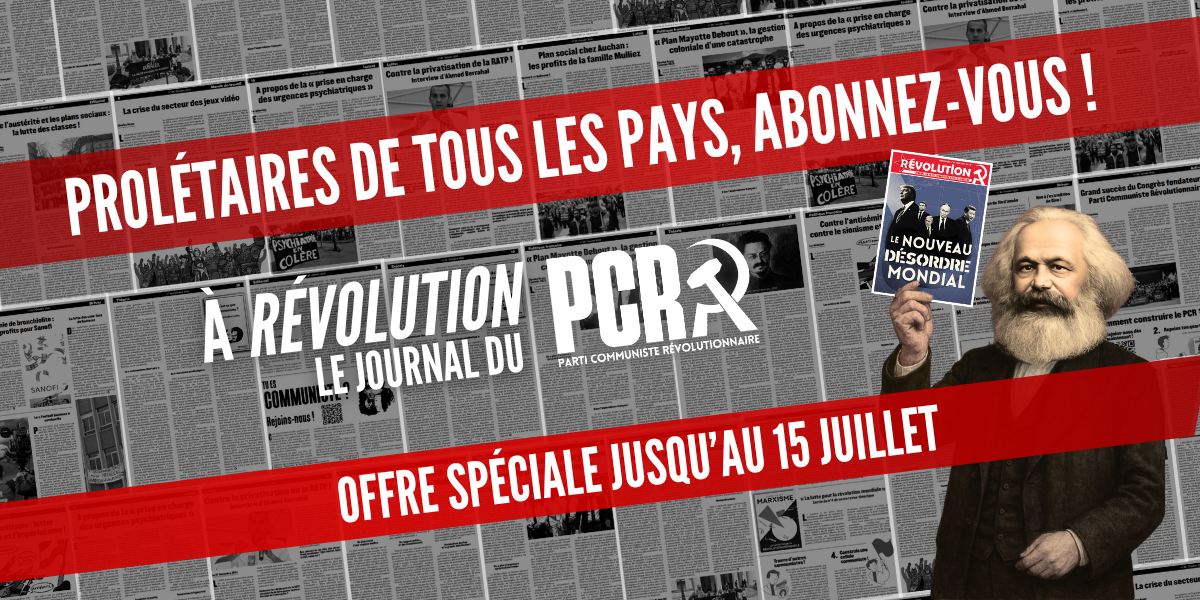20 Mars 2025
Le 18 février, le Sénat a voté une proposition de loi visant à interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Le sujet était sur la table depuis un moment, le port du foulard avait d’ailleurs été interdit aux sportives de la délégation française aux JO. Les ministres Retailleau et Darmanin font de cette mesure une question de première importance. Darmanin a même menacé de démissionner si elle n’était pas appliquée. De son côté, la ministre des Sports, Marie Barsacq, a vaguement protesté contre cette mesure, avant d’être rappelée à l’ordre par François Bayrou.
Le Premier ministre a en effet désespérément besoin du soutien du RN pour se maintenir à Matignon. Il multiplie donc les provocations racistes. Au passage, cela permet à la bourgeoisie de tenter de distraire l’attention des masses du chômage et de la crise économique. Michel Savin, le sénateur LR qui a déposé la proposition de loi, prétend que cette mesure vise à éviter des « problématiques » qui « créent des tensions, des divisions ». En réalité, sa proposition cherche précisément à alimenter les « divisions » au sein de la classe ouvrière, pour le plus grand bénéfice de la classe dirigeante !