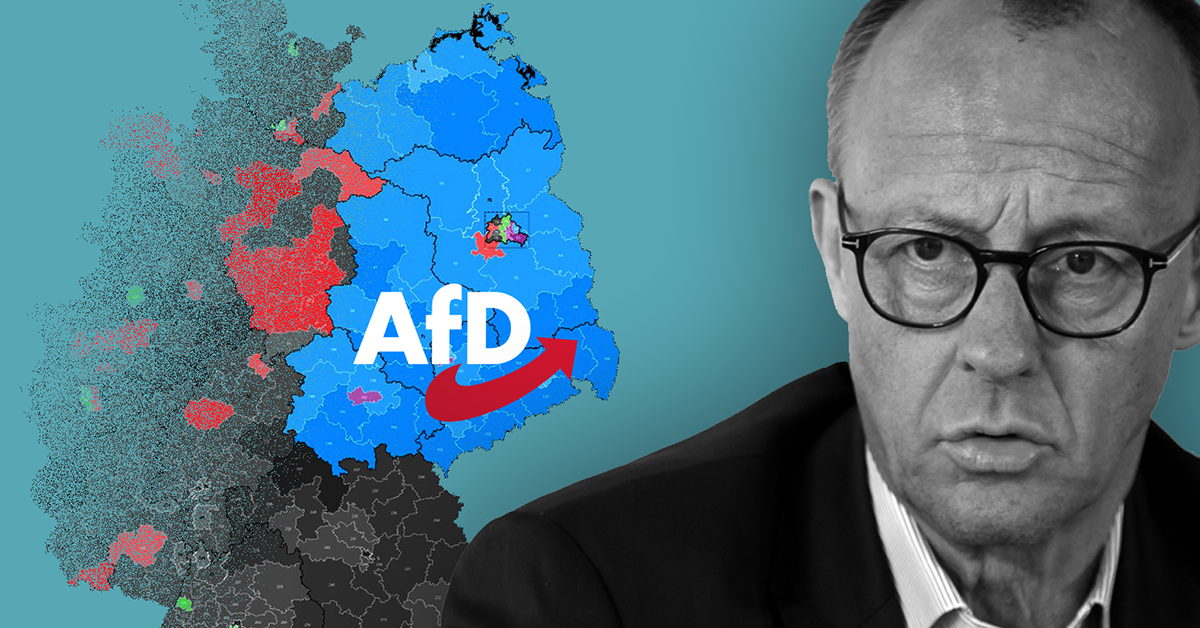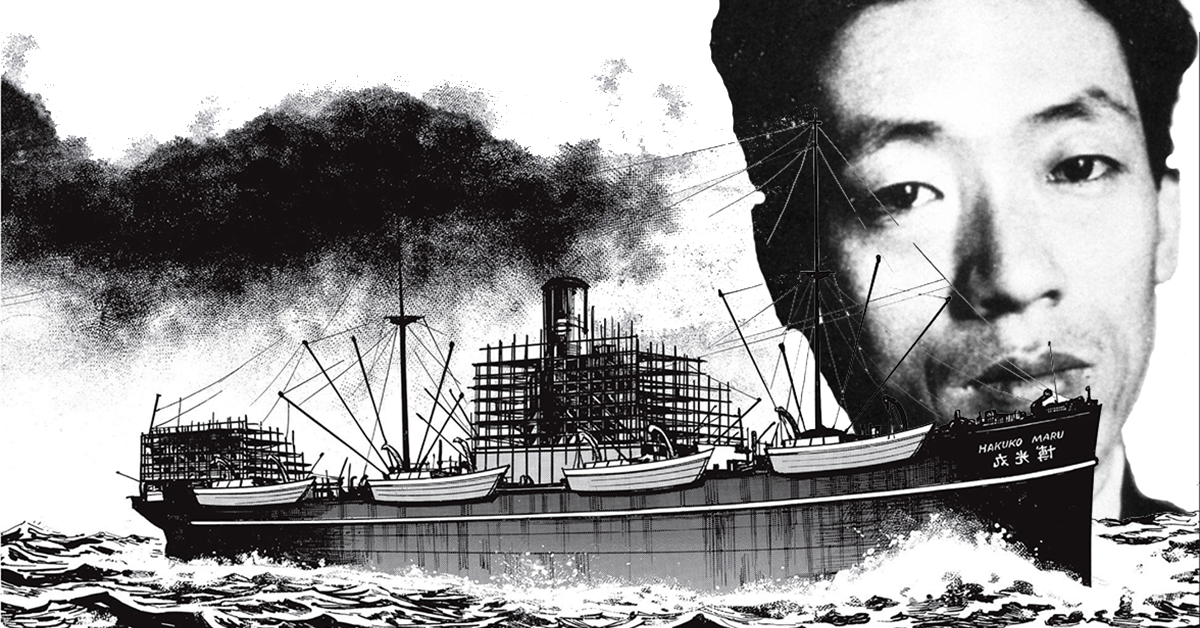03 Mars 2025
En l’espace de quelques jours, plusieurs attaques de groupes fascistes sur des militants de gauche ont été recensées.
Le 16 février, à Paris, une trentaine de fascistes ont envahi une projection organisée par les militants de Young Struggle et poignardé un militant de la CGT. Dans la nuit du 18 au 19 février, alors qu’il rentrait de la mobilisation à Sciences Po Bordeaux, un militant Insoumis a été lâchement pris en embuscade. Seul contre cinq, il a été frappé au sol. Le 22 février, près de Rennes, un conseiller municipal de gauche a été agressé par des individus qu’il a confrontés après que l’un d’entre eux a effectué un salut nazi. Plus tôt en janvier, quatre étudiants ont été passés à tabac dans le centre-ville d’Angers par un groupe néonazi qui leur a demandé s’ils étaient de gauche.
Interpellé sur l'attaque de Paris à l'Assemblée, Bruno Retailleau a dénoncé « la violence » en mettant l'accent sur la violence... de l'« ultra-gauche » ! Peu avant, le ministre de l'Intérieur félicitait le Collectif Némesis pour son « combat », rappelant une nouvelle fois l’accointance du gouvernement avec les groupuscules fascistes.